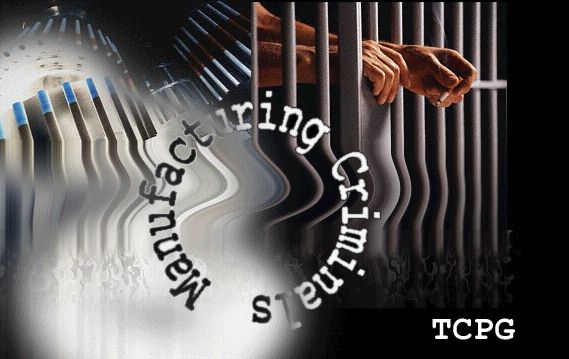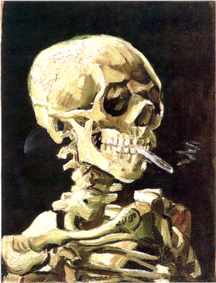Translations à babelfish.altavista.com/translate.dyn for Chinese - Deutsch - Español - Français - Italiano - Japanese - Korean - Portuguese or www.freetranslations.com for French - German - Italian - Norwegian - Portuguese - Spanish. |



| Bienvenu à le livre, Physiologie Sociale: Le Tabac, Qui Contient Le Plus Violent des Poisons, La Nicotine Abrége-t-il l'Existence? Est-il Cause de la Dégénérescence Physique et Morale des Sociétés Modernes? (1876), par Dr Hippolyte Adéon Depierris (1810-1889). Pour aller à la table des matières immédiatement, cliquetez ici. |
Physiologie Sociale: Le Tabac,
Qui Contient
Le Plus Violent des Poisons,
La Nicotine Abrége-t-il l'Existence?
Est-il Cause
de la Dégénérescence Physique et Morale
des Sociétés Modernes?
par Le Dr H. A. Depierris
(Paris: Dentu, 1876,
reprinted and edited,
E. Flammarion, 1898)
| Ed. Note: Exemples de sujets:
|
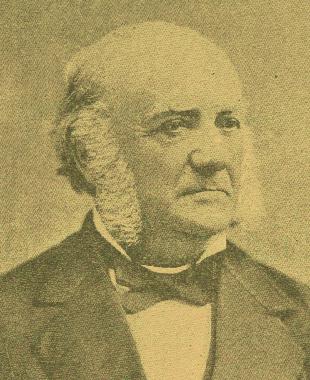

|
Depuis trois siècles, une foule de savants se sont occupés du tabac au point de vue social, économique, hygiénique, physiologique et pathologique; mais personne, croyons-nous, n'a étudié la question avec autant de persévérance, aucun auteur ne l'a traitée avec autant d'ampleur sous toutes ses faces, que le Dr A. Depierris, président d'honneur de la Société contre l'abus du tabac, dans son immortel ouvrage ayant pour titre: Physiologie sociale, et pour sous-titre: Le tabac, qui contient le plus violent des poisons, abrège-t-il l'existence? est-il cause de la dégénérescence physique et morale des sociétés modernes? La première édition, publiée en 1876 à 3000 exemplaires, est épuisée, et le moment est venu d'en publier une nouvelle en exécution du testament suivant:
Nous engageons vivement tous les amis de l'humanité et surtout de la jeunesse à propager ce remarquable ouvrage parmi leurs connaissances et à le faire entrer dans les bibliothèques publiques. Pour le Conseil d'administration de là Société contre
Le Président: E. DECROIX.
Pour traiter convenablement un sujet en apparence aussi superficiel et aussi ingrat que le tabac, il nous a fallu entrer dans des démonstrations d'anatomie et de physiologie que nous avons cherché à mettre à la portée de toutes les intelligences. Les docteurs nous excuseront la simplicité et parfois l'originalité de nos théories. Ce livre n'est point fait pour eux; car ils en savent, au moins, autant que nous sur le véritable rôle du tabac dans notre civilisation moderne. Nous avons écrit pour tout le monde; car notre sujet intéresse tout le monde. Et s'il s'offre à la méditation de tous, nous désirons surtout avoir, pour nous critiquer ou nous approuver, autant de lecteurs qu'il y a de consommateurs de tabac, sans distinction de sexe, d'âge ou de condition sociale. On fait des romans historiques pour graver plus profondément dans l'esprit, par le charme de l'intérêt et les séductions de la lecture, les grands enseignements de l'Histoire. Le tabac nous aura donne l'occasion d'essayer un roman physiologique, pour arriver à détruire un grand préjugé social. Nous avons cherché, par la variété des épisodes de ce travail, à en écarter la monotonie et l'ennui, et à contraindre le lecteur, fût-il un Nicotphile des plus endurcis, à nous lire jusqu'au bout. Car la curiosité, au moins, l'attachera à la réalité de nos révélations et de nos tableaux, où il aura bien souvent l'occasion de se reconnaître, comme si nous l'avions peint lui-même. Et s'il ne trouve pas dans ce livre des raisons suffisantes p'our lui faire renoncer au tabac, comme on renonce résolument à une mystification ou à une erreur, il y aura au moins recueilli quelques notions qui l'aideront parfois à se rendre compte à lui-même comment il vit, et à distinguer ce qui peut faire la force ou la faiblesse de son organisme. EFFETS DU TABAC SUR LES SOCIÉTÉS MODERNES De nos jours plus que jamais, depuis un demi-siècle, on répète partout ces paroles désespérantes pour l'avenir de nos sociétés:
Et, pour confirmer ces idées, les statisticiens nous disent:
Les commissions de recrutement constatent que la moyenne de la taille baisse, que la force physique s'étiole au point que la chance d'un bon numéro, si l'on tirait encore au sort, n'existerait pour ainsi dire plus, pour dispenser un conscrit du service militaire; le grand nombre des impropres à la carrière des armes obligeant à chercher des valides dans tous les jeunes gens de la classe. Les moralistes et les jurisconsultes affirment que les mœurs se relâchent, que les tendances au mal dominent les inspirations du bien, que la criminalité grandit. Les physiologistes constatent que la beauté du type physique, bien loin de s'élever, abaisse son niveau vers la déformation et le crétinisme, et que l'intelligence, servie par des organes imparfaits, s'abîme dans les mille formes de l'aliénation mentale et de l'idiotisme, dont nos établissements spéciaux deviennent de plus en plus insuffisants à contenir les innombrables victimes.
Il prend dans ses étables une race d'animaux appauvrie, il lui donne l'aliment nécessaire, il la préserve de l'intempérie des saisons, il la soigne, en un mot, et cette race se régénère; elle se développe en chair, en formes et en instincts dont nos plus simples éleveurs savent tirer, à leur profit, tous les avantages. Et les végétaux? Par des soins, de l'hygiène et de la culture, ne les faisons-nous pas parvenir à un luxe de développement, à une somme de qualités que leur nature primitive et modeste semblait leur avoir refusés? L'homme a donc la puissance d'améliorer tout ce qu'il cultive. Et pourtant sa civilisation, qui n'est autre chose que la culture de son être effectuée par lui-même, ne fait que s'appauvrir dans la manifestation des facultés primitives que Dieu lui a données.
désirs; c'est qu'à côté de la science et de l'enseignement qui donnent l'aliment à ses hautes aspirations artistiques, religieuses et morales, à côté de toutes ces sources de perfections où puisent largement ses deux éléments, corps et ame, qui, par l'harmonie de leurs rapports, font l'unité de son être, il existe une cause de perturbation organique et morale inconnue aux générations qui nous ont précédés, et qui pèse fatalement sur la nôtre.
Avant de nous arrêter à discuter la valeur de cette cause de notre abaissement moral, qui entraînerait alors, comme conséquence, notre abaissement physique, examinons d'abord si elle n'est pas plus fictive que réelle. La première réflexion qui s'offre tout naturellement à l'esprit, c'est que les religions et les cultes, dans l'humanité, sont bien variés; et si les ministres de la foi catholique se plaignent de l'irréligion de leurs adeptes, les ministres du culte protestant, les pasteurs de Moïse, de Mahomet, de Confucius, trouvent peut-être que leurs troupeaux marchent avec toute l'éner- gie de la foi, avec persévérance et succès, dans les voies qu'ils leur enseignent, pour arriver à Dieu. Ces récriminations du clergé catholique qui accuse d'irréligion ceux qu'il dirige, se fondent-elles bien sur une réalité palpable? Elles s'adressent surtout à la France, à l'Italie, à l'Espagne, ces trois filles de l'Église; et peut-on dire, avec raison, qu'en ces temps de décadence physique et morale, les églises soient moins fréquentées, qu'on s'y recueille avec moins de confiance et de piété, qu'on y prie avec moins de ferveur que dans les temps passés? Je ne connais pas assez la situation religieuse de l'Italie et de l'Espagne pour rien en dire; mais quant à mon pays, à la France, je vois que tout s'y passe aujourd'hui comme je le voyais il y a plus d'un demi-siècle, sous la Restauration, qu'on ne suspectera pas d'avoir été une époque d'impiété. Pas un enfant n'y naît, pas un être n'y meurt, sans que la cloche de l'égalise ne reporte vers Dieu, comme source de toute chose, la joie ou le deuil de la famille. Et si quelques intelligences, déviées par ce mal social dont nous recherchons ici la cause, s'abaissent dans la dégradationjusqu'à douter de Dieu, jusqu'à le nier même, combien, à côté de ces rares exceptions, ne voit-on pas de milliers d'individus qui, dans l'obscurité et l'ignorance des âges précédents, n'auraient connu du Créateur que le nom: mais qui, éclairés aujourd'hui du flambeau de l'instruction et par l'étude des sciences modernes, pénétrent dans l'intimité de l'essence et des œuvres de Dieu, comme cause première, comprennent l'immensité de sa grandeur, et s'inclinent humblement et religieusement devant elle?
Et que ceux qui en douteraient la suivent sur les nouveaux continents dont elle fait journellement la conquête, pour y régner en souveraine. Là, ils pourront constater que partout où un groupe d'hommes se rencontrent, en pleine liberté de faire le bien ou le mal, sans organisation sociale, sans lois, à quelque nation, à quelque culte qu'ils appartiennent, leur première aspiration est de bâtir la maison de Dieu. Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que l'on ne voit nulle part autant d'églises, toutes pieusement et assidûment fréquentées, que dans le Nouveau-Monde, où l'homme jouit, sans restriction, de la liberté de conscience ; où l'Église est entièrement en dehors de l'État, et où les fidèles seuls s'imposent spontanément pour les frais de la pratique de leur culte.
Là, rien ne les contraint, ni ne les pousse à des manifestations pieuses; ils obéissent au seul sentiment religieux de leur âme. Et là aussi pourtant, l'humanité dégénère! Ainsi se trouve confirmé ce fait: que la civilisation et le progrès, au lieu d'écarter l'homme de Dieu, l'en rapprochent; et ainsi s'atténue considérablement, si elle ne tombe pas en entier, cette affirmation venue de si haut, et édictée par le Syllabus: que notre dégénérescence n'est causée que par l'abandon que nous faisons de la Foi et du Culte de nos pères.
Cherchons la vérité, dans le vague de ces assertions. Il y a toujours eu, dans toutes les transformations politiques et sociales par où a passé l'humanité, des classes privilégiées par le rang et la fortune, qui ont eu en partage toutes les jouissances de la vie, quand toutes les misères étaient dévolues aux classes inférieures. A-t-on jamais dit que ces heureux d'alors dégénéraient, parce que, usant gaiment leur fortune à ce qu'on appelle vulgairement bien vivre, ils habitaient dans des hôtels somptueux, demandaient aux artistes des jouissances pour leurs sens, recherchaient les festins où la variété et la délicatesse des mets, le luxe des liqueurs excitaient journellement la lenteur de leur appétit; sacrifiant plus qu'on ne le fait aujourd'hui au culte de l'alcôve, partageant les moments perdus entre l'entraînement des salons et l'émotion des théâtres? Ce genre de vie, qui tout au plus pouvait les amollir, ne les abâtardissait pas; puisque c'était dans cette classe d'heureux que se recrutaient toutes les capacités nécessaires aux carrières privilégiées, aux professions libérales, à l'administration de l'État, à la Guerre. Qu'a fait le progrès dans la civilisation moderne? Il a élevé à la participation du bien-être le plus grand nombre des déshérités d'alors. A ceux qui avaient faim, qui avaient froid, il a donné des vivres sur la table, du feu dans le foyer. A la chaumière humide et obscure il a substitué l'habitation bourgeoise aérée et coquette. Dans la hiérarchie des classes, il a changé la bure pour le coton, le coton pour la soie. Dans la frivolité de la parure, il a substitué l'argent au cuivre, l'or à l'argent, le diamant à l'or. Il a substitué le moyen de transport à la marche forcée, l'assistance de la machine à l'épuisement du travail. Voilà, entre tant d'autres choses, ce qu'a fait le progrès pour la condition physique de l'homme. Qui pourrait dire que toutes ces modifications, au lieu de l'abâtardir, n'auraient pas dû l'élever dans la perfection matérielle?
L'homme, dans ce milieu d'instruction qui l'éclaire, grandit aux yeux de sa propre conscience, et ce qui l'élève si haut dans la connaissance et l'estime de lui-même ne saurait le faire dégénérer; c'est-à-dire descendre.
Ils disent: que les sociétés ne tuent pas les hommes, sous prétexte de les punir; que l'appareil légal de la mort, que le bourreau disparaissent ou se cachent, et le peuple n'ira plus se repaître de ce spectacle de meurtres juridiques qui, au lieu de l'arrêter devant l'idée du crime, par l'image sanglante du cnâtiment, ne fait que l'y pousser; car de semblables tableaux émoussent ses répugnances instinctives et innées, pour l'abandonner à ses mauvais instincts, sans terreur du sang qu'il va répandre, parce que ses yeux sont habitués à le voir couler sur les places, aux jours des exécutions publiques.
Si la vue des exécutions sanglantes pouvait pousser l'homme au meurtre et le rendre avide du sang et de la vie de ses semblables, à quelle élévation dans le crime n'auraient pas dû atteindre les sociétés formées à la civilisation païenne, alors que partout le peuple, a quelque classe, a quelque sexe, a quelque âge qu'il appartînt, venait, comme a des jours de fête, assister dans les amphithéâtres à des hécatombes d'hommes armés les uns contre les autres pour s'entre-détruire, pour le plus grand amusement d'un public enthousiaste? Les martyrs de ces orgies de sang n'étaient pas des criminels a qui la société demandait, par la mort, réparation du mal qu'ils lui avaient fait dans leur vie; c'étaient des vaincus que les chances de la guerre avaient livrés sans force à leurs vainqueurs. C'étaient les apôtres d'une foi nouvelle, disputant à tous les Dieux qu'adoraient les païens les droits du Dieu unique qu'adorent les Israélites, les Mahométans et les Chrétiens. Et, si nous marchons plus avant dans les siècles, ne voyons-nous pas les bûchers de l'inquisition chrétienne, remplaçant les amphithéâtres des païens, donner aux peuples, en spectacle, les cris et les douleurs d'êtres humains se tordant dans les flammes, pour expier sur un bûcher le crime d'hérésie ou de dissidence dans la foi; et d'autres crimes qui ne sont pourtant dans le cœur humain que des vertus; celui, par exemple, d'avoir, comme notre Jeanne d'Arc [1412-1431], qui fut aussi brûlée vive, bien aimé son pays malheureux et envahi, et d'avoir puni par les armes l'insolente arrogance de l'ennemi qui l'opprimait? Si nous nous rapprochons encore de notre époque, aux âges de la féodalité, sans rappeler le sauvage supplice de la roue ou de l'arrachement des membres d'un malheureux, attaché à des chevaux qui l'écartelaient tout vivant, sous les yeux du public, combien ne voyait-on pas les appareils de mort de la justice se dresser pour punir ce qui ne serait aujourd'hui que de légers délits? Et si nous avançons encore dans notre temps, ceux qui ont vu le premier quart de notre siècle, alors que la justice criminelle avait des sévérités qu'elle n'a plus de nos jours, se rappelleront que le couteau triangulaire des hautes-œuvres faisait tomber bien des têtes qui lui échappent aujourd'hui, par l'introduction dans nos Codes modernes de la question des circonstances atténuantes posée à l'humanité du jury. Ils se rappelleront avoir vu sur les places publiques, les jours que les marchés ou les fêtes y réunissaient le plus de monde, des malheureux frappés par la loi de la peine du carcan. Les membres chargés de chaînes, le cou tenu à un poteau d'estrade par un collier de fer, ils montraient, durant de longues heures, à la curiosité publique, leur dégradation et leur honte. Ils se rappelleront ces foules se pressant autour des fourneaux où le bourreau chauffait ses fers, et, quand ils étaient rouge blanc, marquait sur la place publique à l'épaule, comme un bétail, des trois lettres T. F. T. ou T. F. P. les malheureux criminels que la justice humaine envoyait dans les bagnes, pour les travaux forcés, à temps ou à perpétuité, comme l'indiquaient les sinistres majuscules incrustées pour toujours dans leur chair. Si les générations qui ont assisté à tant de morts, à tant de tortures, à tant de mutilations fantaisistes ou légales sur des âtres humains, n'ont pas, par ces spectacles, été poussées aux meurtres, les philanthropes se trompent quand ils cherchent la cause des grands crimes qui viennent si souvent, de nos jours, révolter notre humanité et nos consciences, dans la contagion de l'exemple que donne la justice par ses exécutions sanglantes, relativement rares, mises en scène devant le public. En résumant les réflexions qui précèdent, on arrive à conclure qu'il ne faut pas chercher dans un ordre métaphysique ou social, qui a toujours existé, les causes toutes récentes et actuelles de la dégénérescence physique et morale qui afflige notre époque, par le triste tableau de ses réalités incontestables. La médecine, plus positive dans ses rapports avec l'organisation intime et matérielle de notre être, s'est aussi frappée de la décadence contemporaine et rapide de l'homme, dont l'éducation physique et la conservation rentrent dans ses attributions. S'appuvant sur ce vieil adage, qui puise sa véracité dans la sanction de l'expérience et du temps: Mens sana in corpore sano (la santé physique fait la santé morale [sound mind in sound body]), elle a cherché, dans ce grand accident où s'abîment nos deux organismes, si le mal qui les afflige les frappe simultanément, ou si la lésion de l'une n'entraîne pas, comme conséquence, tous les dérèglements de l'autre. Or, ce qui frappe tout d'abord le médecin que l'àge et l'expérience ont mûri, c'est que l'homme physique s'étiole au milieu de tout le bien-être matériel que lui donnent: l'hygiène, qui le préserve des maladies; les asiles et les crèches, qui protègent son enfance; les hôpitaux, qui soignent ses maladies et sa vieillesse; la philanthropie et la mutualité, qui l'assistent partout où il est malheureux. Dans toutes ces conditions de prospérité et de bien-être, qui devraient l'améliorer, il dégénère! L'organisation politique et humanitaire de notre époque, la mieux en harmonie avec ses besoins matériels et sociaux qui ait jamais existé, ne l'empêche pas de déchoir. Et sa dégénérescence physique précède toujours son abaissement moral, dont elle semble être la cause, en retournant l'adage, j'allais dire l'axiome que j'ai cité plus haut: Mens insana in corpore insano (le moral est malade quand le corps souffre). La philosophie, d'ailleurs, n'a-t-elle pas défini l'homme: UNE INTELLIGENCE SERVIE PAR DES ORGANES? Or, si l'intelligence s'écarte des voies de Dieu, si elle a ses aberrations, ses folies, si elle prend le mal pour le bien, si elle donne la haine au lieu de l'amour, la vengeance au lieu du pardon, si elle suit le chemin du crime au lieu de marcher dans la voie de la vertu, c'est que les organes qui la servent ont perdu leur perfection primitive et créée.
Si l'aliment et la génération sont les grands secrets de la conservation, de l'amélioration des êtres vivants et de leurs types, cherchons ce que l'homme, dans sa civilisation moderne, a pu rencontrer fatalement ou introduire imprudemment d'éléments perturbateurs dans ces grandes fonctions dont l'accomplissement, dans l'ordre et les lois de la nature, est la condition essentielle et la garantie indispensable de sa vie. L'homme ne souffre point aujourd'hui, surtout sur la terre privilégiée de France, de circonstances fatales agissant sur sa nutrition. Il étend tous les jours les ressources de sa vie matérielle, par les conquêtes de l'agriculture, par les facilités de relations commerciales et la liberté des échanges, à grandes distances, de toutes les substances alibiles que lui donne abondamment la terre, dans ses productions libérales et spontanées, ou quand elle est sollicitée par le travail qui la féconde et l'oblige à produire. Avec la vapeur qui sillonne les mers, les réseaux de routes de fer qui enveloppent le globe, l'électricité qui porte, en quelques heures, les demandes du commerce à travers tous les continents, le temps des famines et même des disettes est depuis longtemps passé. Ce qu'une partie de la terre refuse accidentellement à ses habitants, les autres parties mieux pourvues le leur envoient. L'aliment ingéré, sous le rapport de sa qualité et de son abondance, ne fait donc pas défaut à l'homme. Mais il vit aussi d'un aliment gazeux qui l'environne, dans une atmosphère où il puise sans cesse les principes les plus essentiels a son existence, puisqu'elle s'éteint aussitôt que cet aliment lui manque. Il puise dans l'atmosphère, par l'absorption pulmonaire et cutanée, l'oxygène de l'air et de la vapeur d'eau. Cet aliment gazeux, dont la science connaît la composition la plus conforme à notre existence, peut subir des altérations, par des miasmes ou principes délétères suspendus dans l'atmosphère. De nos jours, sous le rappport de l'hygiène atmosphérique, rien n'est à désirer; rien ne manque non plus à l'abondance et à la qualité des eaux potables. Partout des administrations éclairées, dans les municipalités, les eaux et forêts, les ponts et chaussées, présidente à la propreté des villes, à la salubrité des logements, au dessèchement des marais. Toute cause d'impureté atmosphérique est partout recherchée et aussitôt éloignée. Sous le rapport des aliments que l'homme s'assimile par la digestion et par l'absorption, ingesta et circumfusa, il se trouverait donc dans les conditions les plus favorables, non seulement à sa conservation, mais à toutes les améliorations ouvertes a sa nature perfectible. Et pourtant il dégénère! . . .
En matérialisant cette légende, toute mystique, on peut dire qu'au milieu du bien-être que les progrès de la civilisation ont si largement répandu sur notre époque, nous nous sommes laissé dominer par la tentation et les sens. Notre volonté a dénaturé nos instincts: elle a imposé à nos usages, comme un aliment de notre être, des substances dont les effets toxiques et délétères ne produisent en nous des sensations de plaisir ou d'ivresse qu'en dégradant notre organisme. Nous avons touché à ce qui était défendu, au fruit de l'arbre du mal, qui est incompatible avec le fonctionnement régulier de nos organes. A l'aliment qui doit entretenir notre vie, nous avons ajouté, comme fantaisie ou comme luxe, le poison qui la détruit.
L'opium et l'alcool ont depuis longtemps subi le jugement de l'observation, de la science et du sens commun, qui ont donné à l'opium toute la part néfaste qui lui revient dans le temps d'arrêt et la marche rétrograde de la vieille civilisation des peuples de l'Extrême-Orient. Quel est l'Européen qui ne considère pas aujourd'hui comme une race inférieure à la sienne ces fumeurs et ces mangeurs d'opium répandus dans toute l'Asie? Ces aines de l'humanité se sont arrêtés dans la civilisation, dont ils nous ont transmis les rayons, quand leur cerveau s'est eng-ourdi au milieu des vapeurs du pavot somnifère. Qui de nous ne jette pas une pensée de compassion, en même temps que de blâme, à ces pauvres Asiatiques, qui savourent avec un bonheur ineffable une drogue que la médecine nous donne pour endormir nos souffrances dans les maladies, et que nous lui dérobons bien souvent, comme poison, pour en finir, par le suicide, avec les misères de la vie? Tous ces ravagées que fait l'opium chez des peuples qui vivent bien loin de nous, nous ne les connaissons que par la tradition, par l'histoire ou par les récits des voyag'eurs qui en ont été témoins. Les idées que nous en concevons ne sont pas aussi nettes, aussi frappantes que celles qui nous viennent du spectacle d'abaissement et de dégradation que donnent les sociétés européennes dominées par l'habitude de l'alcool. Eh bien! L'usage de l'opium et de l'alcool, ces vieux vices de la nature humaine que toute conscience sage réprouve, sont bien loin de jouer un rôle aussi néfaste que le tabac, ce vice récent dans la décadence de l'nhumanité.
Ni l'arsenic, ni la noix vomique, qui donne la strychnine; ni le pavot, qui donne l'opium et la morphine; ni le laurier-rosé qui donne l'acide prussiquo: ni la jusquiame, ni la belladone, ni l'aconit, ni la ciguë, qui donnent des poisons qui tuent notre organisme, ne sont à comparer au poison du tabac, à la NICOTINE, qui le foudroie. Voyez, après tout cela, quelle bizarrerie dans l'esprit humain! Parmi les adorateurs du tabac, il en est beaucoup qui ont assisté, dans les cours et les laboratoires de chimie, aux expériences effrayantes sur les effets toxiques de cette plante, et qui la fument et la mâchent quand même; et ils n'oseraient pas, de peur de s'empoisonner, toucher de leurs lèvres une herbe réputée vénéneuse, dans l'opinion vulgaire: l'aconit, le datura, la ciguë, par exemple. C'est que ceux-là sont déjà sous la domination impérieuse du tyran qui les préoccupera toute leur existence. Leur appétit perverti leur a rendu le tabac aussi nécessaire que l'aliment le plus naturel. Ils travaillent pour lui comme pour le pain de tous les jours ; car il fig-ure au budget de leurs dépenses indispensables. Ils aspirent après lui autant qu'après un excellent repas. C'est un modificateur nécessaire à leur organisation détraquée. Quand ils n'en ont pas, elle souffre; quand ils le savourent, elle se sent allégée, pour souffrir encore, . . . et toujours. Et, de toutes ces sensations, ils concluent que la science se trompe, que le tabac ne fait pas mourir, qu'il aide, au contraire, à vivre et à bien vivre.
Sitôt qu'un agent destructeur de l'économie pénètre dans ses profondeurs mystérieuses, que ce soient les miasmes des marais Pontins ou l'élément toxique d'un végétal, morphine, strychnine ou nicotine, le principe vital, se détournant des fonctions naturelles auxquelles il avait mission de présider, entre en lutte contre cet envahisseur illicite de l'organisme. Toute la vie se trouble dans des agitations qui sont presque une agonie. Si le principe vital est assez abondant, assez fort, il s'identifie avec le poison, qu'il prend corps à corps, pour ainsi dire, et le neutralise. Si, par contraire, le poison est en excès, la vie est perdue. Que les fumeurs se rappellent leurs premières sensations quand ils ont commencé à absorber par les muqueuses de la bouche, des narines et des poumons, la fumée enivrante du tabac. Ces éblouissements, ces sueurs froides, ces vertiges, ces nausées, dont ils souffraient, puisqu'ils cessaient de fumer, et dont ils se faisaient un jeu, quand ils étaient passés, c'était la lutte du principe vital, de l'influx nerveux contre l'agent toxique. Et, la lutte recommençant tous les jours, pour arriver à l'habitude, le principe vital remportait toujours sur son adversaire une victoire devenue de plus en plus facile. Mais ce principe vital, qui, dans chaque individu, a des proportions et une puissance limitées à la consommation de l'organisme auquel il préside, s'use dans la lutte journalière et intermittente qu'il a à soutenir contre l'élément destructeur. Ce qui est employé à la neutralisation du poison manque à l'entretien régulier des fonctions organiques. La vie entre en langueur, car elle ne fonctionne plus qu'avec une partie de sa puissance. Dans son essence intellectuelle, les idées se recueillent mal; les sentiments du beau, qui constituent l'art, s'émoussent; le sens moral délire. Dans son essence matérielle, l'estomac, le poumon, le cœur, fontionnent en désordre. C'est l'état maladif chronique qui mène à la dégénérescence de l'individu et de l'espèce. Par là s'explique la variété d'action des poisons en général et du tabac en particulier sur des sujets différents. Tel individu, chez qui la vie surabonde, chez qui le principe vital coule à pleins nerfs, pourra absorber et neutraliser une quantité de poison représentée par quatre, par exemple, sans on être sensiblement incommodé; tandis que cette même quantité tuera un être plus faible: un enfant, un valétudinaire, un vieillard. Un phénomène que les fumeurs ont ressenti, vient à l'appui de cette affirmation de la science. Dès qu'ils sont malades, ils ne peuvent plus fumer. Pourquoi? C'est que dans toute maladie il y a diminution de la vie; puisque, si la maladie continue, elle conduit nécessairement, fatalement à la mort. Le principe vital s'est amoindri en quantité ou en énergie, et toute sa puissance est nécessaire pour soutenir l'organisme dérangé et plus ou moins en danger de périr. Il n'y a plus rien à en détourner pour annihiler les éléments toxiques; et voilà comment le fumeur malade en ressent les effets plus qu'aux jours des premières épreuves, lorsque l'enfantillage, l'entraînement de l'exemple, la pression d'une erreur, le firent commencer à fumer.
La force de l'habitude où, pour parler le language physiologique, la puissance de réaction vitale, qui sont des éléments changeants et périssables, s'épuiseront toujours, dans un temps plus ou moins rapproché, contre la violence du poison qui est toujours la même et que rien ne fatigue. Or, si la vie s'épuise chez l'individu fatalement adonné a l'usage d'un poison, elle devra s'épuiser aussi, à plus forte raison, dans l'espèce que cet individu détérioré a mission de reproduire. Le NICOTINE donnera naissance à des êtres qui auront toute sa complexion défectueuse et maladive; sa descendance sera entachée du vice originel, comme la descen- dance du phtisique, du scrofuleux, du syphilitique, etc., etc. Tous ces disgraciés de l'humanité qui pullulent dans nos sociétés modernes, la perdraient sans retour, dans la pureté de son type, s'il n'était entré dans la sagesse du Créateur de fixer un point d'arrêt à ces générations défectueuses. Ces êtres qui s'abaissent vers le crétinisme, sont frappés de stérilité en eux-mêmes ou dans leur descendance la plus rapprochée. Ils rentrent ainsi dans la grande loi naturelle qui régit tous les êtres se reproduisant par des germes, dans le règne animal comme dans le règne végétal. Elle veut, pour la conservation de l'intégrité des espèces, qui dégénéreraient sans cela en monstruosités, que tout être altéré dans son type, par dégénérescence ou par croisement, soit dépossédé de la faculté de se reproduire, comme il arrive au crétin et au mulet.
A quoi devons-nous chercher à attribuer ces grands maux, sinon à une cause qui, après les avoir précédés, marche parallèlement avec eux, grandit avec eux? Or, cette cause, de quelque côté qu'on la cherche, on no saurait plus véritablement la trouver que dans le TABAC;
qui, dans moins d'un demi-siècle, de relégué qu'il était, comme malsain, malséant et malpropre, dans la cantine des casernes, la poulaine des vaisseaux, le bouge et la taverne des faubourgs, les cours des prisons, s'est imposé à la fashion et à l'élégance, dans nos places et nos promenades publiques; et trône, tout étonné de ses succès, dans la mansarde du pauvre, la salle à mander du riche et les boudoirs dorés des princes: partout accepté comme un passe-temps naturel et coquet, partout recherché comme un des plaisirs les plus innocents, une des jouissances les plus agréables à nos sens.
Il y a un ou deux siècles, si des dissertations pour et contre sont demeurées sans conclusions définitives sur le mérite ou le danger de ce nouveau-venu, c'est qu'il n'avait pas encore suffisamment fait ses preuves; il n'avait pas passé par le creuset du temps et de l'expérience. D'ailleurs, les grands intérêts d'argent qui s'attachaient alors, comme toujours, à son commerce ou à son monopole, faisaient taire tout ce qui aurait pu le déprécier. Dans ces temps de superstition et de ténèbres, il était tombé dans le domaine des charlatans et des alchimistes qui, par raison de lucre, exaltaient ses vertus curatives, et en faisaient une panacée à tous les maux. Que de victimes n'a-t-il pas du faire alors, dans ce milieu de crédulité et d'ignorance! La médecine moderne, éclairée par la chimie qui lui a démontré sa nature insidieuse et les dangers de son usage, l'a rejeté depuis long-temps de son domaine et de ses formulaires. Mais c'était, dans le principe, un si grand guérisseur, que l'opinion publique, s'insurgeant contre la science, décida que lorsqu'il ne guérissait pas les maux physiques, il devait certainement guérir les maladies morales: le désœuvrement, l'ennui; et c'est aujourd'hui la seule vertu qu'on s'accorde à lui reconnaître. Et ces propriétés nouvelles, si elles pouvaient être un mérite, dans notre siècle où tout est activité et vie, et, où jamais un instant inoccupé ne devrait laisser place au désœuvrement et à l'ennui, il les a ursupées, comme les qualités curatives qu'on lui croyait alors, et qu'il n'a jamais eues. Non, le tabac ne distrait pas; il ne désennuie pas! Il assujettit au contraire, il crée des besoins factices, dont bien souvent on souffre, quand on ne peut pas les satisfaire. Il ôte à l'homme la santé, qui est le premier des biens contre l'ennui; il communique l'acreté de son poison à sa nature primitivement laborieuse, douce et bonne: il le rend mou, mélancolique, rêveur, maniaque, méchant, ennuyé de tout, fatigué de tout, excepté du tabac lui-même, qui fait presque exclusivement la jouissance de sa vie, dont il abrège toujours le terme, sous toutes les formes de la maladie ou de l'épuisement. Voilà comment on pourrait peut-être dire que le tabac détruit l'ennui; et, si c'était vrai, ce ne serait toujours qu'après l'avoir fait naître. Et les consommateurs de tabac seraient-ils donc si malheureux que partout et toujours ils s'ennuient, puisqu'ils prisent, fument et chiquent partout, en quelque compagnie qu'ils se trouvent, sans s'inquiéter des dégoûts que, le plus souvent, ils inspirent!
restaient dans les archives des corps savants, que tout le monde ne lit pas. Enfin, quel que soit le tabac devant l'humanité, utile ou indifférent, bienfaiteur ou dangereux, ami ou ennemi, il joue a son égard un rôle trop important, par l'immense étendue de son usage, pour ne pas mériter de temps en temps une monographie. Je vais essayer d'en ajouter une à tant d'autres. Je dirai de ce grand favori de nos jours ce que nous en a appris l'histoire, ce que nous en a révélé la science. J'y ajouterai les impressions de ma vieille expérience qui l'observe depuis plus de cinquante ans; laissant à la conscience publique le soin de le juger, quand elle saura d'où il nous vient, ce qu'il a été, ce qu'il est. DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE. Vers la fin du quinzième siècle, quand Gênes, Venise et Marseille se partageaient le commerce du monde, la navigation, sortant à peine de son enfance, n'osait que côtoyer les continents. Son grand contre était la Méditerranée, qui baignait de ses flots tranquilles les côtes de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, ces trois grandes terres que l'on désigne encore sous le nom collectif de monde connu des anciens. Déjà la voile avait remplacé la rame pour faire mouvoir sur l'onde les barques et les galères qui servaient aux échanges du commerce. La puissance motrice grandissant, la barque grandissait; elle était devenue navire, qui allait lui-même devenir vaisseau. Les navigateurs avaient franchi les Colonnes d'Hercule, qui étaient pour nos ancêtres l'extrémité du monde, et qui servaient de limites aux deux points extrêmes de l'Europe et de l'Afrique, aujourd'hui Gibraltar et Tanger, dans l'Espagne et dans le Maroc. Mais on se tenait toujours à la navigation des côtes. On avait découvert, dans les parages de l'Afrique, les îles Canaries, les Açores, le cap Vert, le cap de Bonne-Espérance. L'esprit du temps était aux découvertes qui, tout en étendant les connaissances humaines, apportaient au commerce de nouveaux éléments d'échange et de prospérité. Alors un hardi navigateur, un homme au jugement pénétrant et aux convictions persévérantes, Christophe Colomb, capitaine de la marine marchande de Gènes, avait compris que cet Océan nouveau, dont le détroit de Gibraltar ouvrait les portes, devait avoir des terres pour limites, comme la Méditerranée qu'il avait, dans ses nombreux voyages, parcourue en tous sens. Ce n'était plus pour lui qu'une question d'étendue; mais, cette étendue, il fallait la franchir! Bien souvent, dans ses excursions commerciales sur les côtes occidentales de l'Europe et de l'Afrique, il avait poussé ses bordées vers la terre qu'il sentait, dans son intuition profonde. Mais cet Océan était si large, si plein d'inconnu, de dangers et de tempêtes; sa barque était si frêle, son équipage et ses approvisionnements si peu en rapport avec une si grande entreprise, qu'après de longues journées et de longues nuits passées en vain à courir au large, il revenait sur la côte qu'il avait laissée, sans se décourager de son insuccès. Il rapportait décès excursions d'essai une conviction plus raisonnée et plus profonde, que la terre, au loin, dans l'Ouest, existait. Toutes ces impressions et ces espérances, il les disait aux commerçants de son pays. Il leur demandait de l'argent, des hommes et des navires, pour son entreprise d'exploration et de découverte, dont ils auraient eu, eux aussi, la gloire et les avantages. Mais, alors comme aujourd'hui, le commerce était positif et calculateur: il n'exposait rien pour des chances qui n'étaient pas certaines, La persévérance de Colomb croissait en proportion des obstacles que rencontrait la mise à exécution de ses projets. Son pays lui refusant de partager ses déceptions ou sa gloire, il s'adressa successivement aux cours de France et de Portugal, proposant ses idées et demandant à la marine militaire de ces deux pays les moyens de conduire à bonne fin ses espérances. C'était encore le temps des somnolences du moyen âge; le fanatisme religieux dominait tout; il repoussait toute idée d'innovation, éteignait toute lueur de progrès. Parler de découvrir un nouveau monde, c'était contester la vérité de la révélation et des Écritures. Car, si ce nouveau monde qu'annonçait Colomb était aussi peuplé d'hommes, d'où seraient venus ces hommes dont la sainte Bible n'avait pas révélé l'existence? Elle disait bien qu'Adam, père unique de l'humanité, ayant reçu de Dieu la faveur de peupler la terre, trois de ces descendants, fils de Noe, échappés au déluge, s'étaient partagé, pour y perpétuer leur race, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il manquait un quatrième propagateur pour un quatrième monde, si l'on venait à le trouver. En effet, la découverte d'un nouveau monde habité, au milieu des Océans sans bornes que les navigateurs n'avaient jamais traversés, causa tellement, plus tard, d'embarras aux théologiens de l'époque, qu'ils se demandèrent si les habitants du nouveau continent étaient bien des hommes créés à l'image de Dieu. Beaucoup les regardaient comme des espèces d'orangsoutangs, et, au dire d'un historien du nom de Paw, la même question fut débattue en Amérique même, au concile de Lima, en 1583, où plusieurs prélats persistèrent à penser qu'on ne devait pas les admettre aux sacrements de l'Église. Ainsi, devant la raison de foi surtout, Colomb passa, en Portugal et en France, pour un rêveur, dont les hallucinations devaient être écartées. Ce fut alors qu'il vint exposer ses vues à la Cour de Ferdinand [1479-1516] et d'Isabelle [1474-1504], souverains d'Aragon et de Castille. Les raisons qui l'avaient fait évincer auprès des gouvernements de France et de Portugal se présentèrent plus puissantes encore en Espagne. Il avait de plus contre lui toute l'influence des grands officiers de la marine de l'État, qui ne pouvaient admettre qu'un simple capitaine marchand pût avoir des idées raisonnables sur des faits de leur compétence, auxquels ils ne songeaient pas eux-mêmes. La reine Isabelle, frappée de l'originalité de l'idée de Co- lomb, prit à cœur de prêter toute son influence et sa protection à une entreprise dont le succès possible lui souriait, en lui réservant un mérite que de puissants souverains refusaient. Elle patrona de tout son pouvoir les projets de Colomb, qui signa, le 17 avril 1492, un traité qui lui conférait des privilèges égaux à ceux des amiraux de Castille et d'Aragon, le nommait vice-roi à perpétuité et héréditaires des terres et continents à découvrir, avec droit à un huitième des bénéfices de son expédition.
les relations et ses découvertes et les publia, tandis que la voix de Colomb restait muette dans le silence des cachots, au milieu des entraves de la persécution.
Le monde, à qui l'on ne disait rien de Colomb, ne voyait qu Améric Vespuce, dont le nom s'attachait aux récits merveilleux qui lui arrivaient des extrémités de cet Océan désormais ouvert à toutes les convoitises, à toutes les spéculations ambitieuses, à tous les rêves. C'est ainsi que le nom d'Améric fut donné à un monde qu'a découvert Colomb; c'est une usurpation contre laquelle proteste la justice de l'Histoire.
Ces hommes, de nature généreuse et bonne, accueillirent avec l'enthousiasme de l'hospitalité leurs nouveaux visiteurs. Mais la bonne harmonie ne dura pas longtemps. Au contact de deux races de nature et d'intérêts si opposés, la guerre éclata bientôt. Ces peuples primitifs, qui n'avaient pour se défendre que la massue la lance et la flèche, succombèrent dans des proportions effrayantes sous le canon, l'arquebuse et le glaive des Européens. On jugera de l'etendue de ces massacres par le fait suivant, que rapporte l'histoire:
L'année touchait à sa fin, dit l'historien M. A. Montenons, lorsque Colomb apprit que l'enlèvement de Caonabo avait soulevé l'île entière, et que les trois frères de ce prince assemblaient une nombreuse armée dans la Vega Real. Les Castillans capables de service ne montaient pas à plus de deux cents hommes d'infanterie et vingt cavaliers. Mais l'amiral y joignit vingt chiens d'attache, dans l'opinion que leurs morsures et leurs aboiements contribueraient autant que le sabre et la mousquetterie à répandre l'épouvante dans cette multitude d'Indiens nus et sans ordre. Il partit d'Isabelle le 24 mars 1494. A peine fut-il entré dans la Vega Real qu'il découvrit l'armée ennemie, forte de cent mille hommes, et commandée par Manicate, un des frères de Caonabo. Le commandant espagnol entreprit sur-le-champ de l'attaquer. Il trouva peu de résistance. Ces malheureux Indiens, dont la plupart n'avaient que leurs bras pour défense, ou qui n'étaient pas accoutumés du moins à des combats fort sanglants, furent étrangement surpris de voir tomber parmi eux des files entières, par le prompt effet des armes a feu: de voir trois ou quatre hommes enfilés à la fois par les longues épées des Espagnols; d'être foulés aux pieds des chevaux dont l'espèce leur était inconnue, parce qu'elle n'existait pas sur leur continent; et saisis par de gros matins qui leur sautaient a la gorge, avec d'horribles aboiements, les étranglaient d'abord, et mettaient facilement en pièces des corps nus dont aucune partie ne résistait à leurs dents. Bientôt le champ de bataille demeura couvert de morts; les autres prirent la fuite. L'amiral employa neuf à dix mois à faire des courses qui achevèrent de répandre la terreur dans toutes les parties de l'île. Il rencontra plusieurs fois les trois Caciques, nom des chefs de tribu, frères de Caonabo, avec le reste de leurs forces; et chaque rencontre fut une nouvelle victoire; car c'est de ce nom que les historiens appellent cet exécrable abus de la force destructive contre la faiblesse désarmée. Après les avoir assujettis, l'amiral leur imposa un tribut qui consistait, pour les voisins des mines, à payer par tête, de trois en trois mois, une petite mesure d'or, et, pour tous les autres, à fournir vingt-cinq livres de coton.
Si, dans ces guerres d'extermination qui ont presque entiè- rement anéanti une superbe race de cent cinquante millions d'hommes, les Européens avaient, pour détruire la puissance, de la poudre, les Américains avaient la subtilité du poison. Ils lançaient à leurs ennemis des flèches dont la blessure était instantanément mortelle. Tout guerrier portait dans son carquois, comme complément essentiel de son armure, un coquillage ou une petite noix de coco garnie d'une substance dans laquelle, pour donner la mort, il trempait la pointe de sa lance ou de ses flèches. La fabrication de ce poison était un arcano dont les secrets n'appartenaient qu'aux anciens et aux prêtres de leur culte idolâtre. Ils cherchaient cette substance dans les sucs de certains végétaux sur lesquels ils portaient, par-dessus tout, leur adoration. C'était, entre autres, un arbuste au port élégant, aux larges feuilles veloutées, à la fleur épanouie en forme de calice, que nos botanistes auraient classé dans la famille des solanées, comme le datura, la jusquiame, la belladone; toutes plantes auxquelles nous reconnaissons des propriétés vénéneuses et rapidement mortelles. C'est cette plante si chère et si précieuse aux sauvages de l'Amérique, qui l'adoraient comme un bon génie, comme un dieu: le dieu de la Vengeance, le dieu de la Délivrance de leur patrie, le dieu de la Mort, que nous apporta Nicot, le nicotiana tabacum; en un mot, le TABAC.
Ils la roulaient en petits paquets, qu'ils portaient pendus à leur ceinture et a leur cou; ils la brûlaient en gros faisceaux et dansaient dans la fumée épaisse que répandaient ses racines, ses tiges et ses feuilles a demi-desséchées; ils en glissaient des fragments dans la cavité d'un roseau ou d'un os, les brûlaient dans ce tube et en aspiraient la vapeur par la bouche et les narines. Il y avait, dans les pratiques et les mœurs de ces pauvres gens, tant de choses singulières, que les Européens furent bien longtemps avant d'en pénétrer les raisons ou les secrets. Etudiant ces idolâtres dans la partie extérieure do leur culte, qui les frappait le plus, ils virent qu'ils se prosternaient en adoration devant des végétaux et beaucoup d'autres objets. C'est que, chez les idolâtres, l'instinct religieux pousse à reconnaître deux principes: le principe du Mal, ou la Fatalité, qui est partout. Il s'attache toujours a nuire à la créature, qui, pour s'en préserver, se met sous la protection de Génies bien-faisants, personifiés dans une plante, un animal, une pierre, où il résident; dans tel objet, enfin, que l'imagination délirante et obscurcie de l'idolâtre aura rêvé.
Tous ces génies du Bien, que les Indiens appelaient Manitous, avaient, dans leurs croyances, des puissances protectrices différentes, suivant les services apparents et réels qu'ils leur rendaient. Un de leurs Manitous les plus vénérés était celui qui résidait dans la plante petun (tabac), qui leur donnait le pouvoir de se débarrasser, par la mort, de leurs ennemis; qui produisait sur leur être des impressions si frappantes, par la pénétration, qu'ils croyaient que le bon génie s'identifiait avec eux. Chacun avait d'ailleurs son Manitou de prédilection; chacun adorait sa plante, comme nos ancêtres primitifs, sur nos vieux continents, adoraient leur étoile, par un culte qui trouve encore beaucoup de croyants parmi nous. Le culte du grand Manitou se faisait en commun, quand on lui demandait assistance pour des malheurs publics, tels que les inondations, les sécheresses, les famines, les guerres intestines qui les armaient de tribus à tribus; l'invasion des enfants du Soleil (les Européens), venus d'Orient pour troubler les douceurs de leur vie et leur enlever la terre que Dieu leur avait donné. C'est un instinct inné dans l'humanité, qu'elle soit dans les ténèbres de la barbarie ou dans les splendeurs de la civilisation, de chercher dans la foi religieuse une consolation et un remède à tous les maux qui viennent l'affliger. Dans notre foi chrétienne, qui est aujourd'hui la civilisation religieuse la plus parfaite de l'humanité, n'attribuons-nous pas a certaines amulettes, a certaines médailles, des mérites de protection auxquels nous avons recours contre des maux qui nous affligent, contre des dangers que nous pouvons courir? Et sans aller bien loin, dans la guerre malheureuse qui, en 1870 et 1871, a jeté la douleur et la ruine dans notre pays, n'avons-nous pas vu des dames, religieusement convaincues, employer leurs loisirs à faire de petits scapulaires en flanelle blanche dentelée sur les bords, portant un cordon noir pour les suspendre au cou, sur lesquels elles brodaient à l'aiguille un cœur percé d'une flèche? Sous cette broderie symbolique on lisait cette inscription:
Et des dames pieuses, élite du grand monde de notre société chrétienne, allaient sur les places où s'exerçaient nos soldats, aux gares qu'encombraient les convois militaires, et jusque sur les champs de bataille, distribuer à pleines mains, à ces braves gens que les nécessités de la guerre appelaient des campagnes, ce pieux talisman qu'avait béni le prêtre, et qui devait détourner de leur poitrine les balles de l'ennemi. N'avons-nous pas vu, plus tard, un général fortemeut trempé dans la foi chrétienne, au milieu de nos discordes civiles, qui versaient sur le sein de la patrie un sang qui n'aurait dû servir qu'à la délivrer de l'invasion étrangère, n'avons-nous pas vu ce général, dans une grande cérémonie religieuse, dans une cathédrale de France, vouer à ce même Sacré-Cœur de Jésus ses soldats, zouaves pontificaux, légion de volontaires, qui, impuissants à sauver le pays de l'invasion, allaient exposer leur poitrine aux colères de la guerre civile, pour le salut de la religion, de l'ordre et de la société? Eh bien! tous ces talismans que la foi religieuse impose aux croyances humaines, les sauvages de l'Amérique les avaient cherchés dans la plante qu'ils adoraient, dans leur dieu Petun, dont la puissance, concentrée dans une goutte de matière, donnait la mort à leurs ennemis, imitant en cela les païens, qui adoraient le dieu qui tuait par la foudre, le Jupiter tonnant. Les ministres de leur culte, car l'idolâtrie a ses prêtres comme le paganisme et le monothéisme, se servaient du petun pour fanatiser leurs croyances aux jours des grandes fêtes, aux approches des grands événements et des batailles surtout. Ils le brûlaient comme dans nos temples nous brûlons l'encens. Au milieu de ses vapeurs qu'ils absorbaient, ils se mettaient dans un état d'ivresse narcotique qui n'était, à leur conscience et aux yeux de ces foules crédules et abusées, que la pénétration du génie protecteur qui leur apparaissait pour les inspirer et les conduire. Pour toutes ces pauvres créatures, chez qui le sentiment du patriotisme se révélait par le désir commun de chasser l'étranger, le besoin dominant était la guerre qui, seule, pouvait les délivrer de l'invasion; la guerre à forces inégales, contre des ennemis puissants qui exterminaient leur race; la guerre sainte, dans laquelle toutes leurs espérances reposaient dans leur bon génie Petun. Alors ces pauvres idolâtres, pour s'identifier avec leur mystérieux protecteur, se saturaient de ses vapeurs acres et brûlantes. Les guerriers surtout y puisaient un entraînement et des colères qui les faisaient braver la mort pour mieux la donner. Ils croyaient, en absorbant par la bouche et les narines la fumée du petun, s'approprier aussi la puissance de leur Dieu. Voilà pourquoi fumaient les indiens, que nous imitons si bien aujourd'hui, sans pourtant partager en rien leurs croyances religieuses. C'était la même superstition qui les poussait à manger leurs ennemis. Ces sauvages des Antilles qu'on appelait les Peaux-Rouges, les Anthropophages, étaient tellement fanatisés dans leurs convictions barbares, qu'ils mangeaient tous les européens qui tombaient vivants en leur pouvoir, pour s'assimiler leur force, leur vigueur, leur bravoure; en un mot, toutes les qualités de leurs ennemis, qu'ils reconnaissaient supérieurs à eux, puisqu'ils ne pouvaient parvenir à s'en délivrer. C'est aussi pour cette même raison qu'ils mangeaient le serpent à sonnette et s'abstenaient des autres; peut-être parce qu'ils empruntaient a ce terrible reptile, en même temps qu'au tabac, le venin dont ils empoisonnaient leurs flèches et leurs lances. Ainsi, pendant longtemps, deux fanatismes poussaient ces deux races d'hommes a s'entre détruire:
De cet ascendant religieux qu'avait le petun sur les sauvages d'Amérique (il découlait peut-être aussi) une influence non moins puissante sur leur esprit: l'influence curative dans les maladies. Il est dans les deux natures humaines, âme et corps, une corrélation, une affinité si intimes, que tout ce qui tient à l'élément religieux, en rapport avec l'âme, semble devoir agir aussi par expansion sur les maladies du corps. Dans la foi primitive du chrétien,
Chez le sauvage, dont la foi limitée est en rapport avec son intelligence rétréci, c'est le génie Petun qui guérit tous les maux. Les Européens, qui étaient peu disposés à croire à la divinité de Petun, dans le culte que les sauvages avaient pour lui, après avoir, a l'imitation des indigènes, éprouvé l'influence qu'il avait sur leurs sens, étaient portés à lui reconnaître les vertus curatives que leur attribuaient les Indiens. Alors cette plante, mystérieux Protée, dépouillant son essence divine qu'elle avait en Amérique, vint prendre place en souveraine sur le trône vacant de la médecine, au milieu des peuples civilisés de l'Europe du seizième siècle.
L'arrivée du tabac fut pour eux une bonne fortune. Les effets extraordinaires et inconnus de cette plante sur l'organisme humain la firent entrer d'emblée dans la médecine et dans toutes les sciences occultes qui tenaient de la magie.
Le tabac n'envahit pas avec une égale rapidité les différents États de l'Europe. Fray Romano Panc, missionnaire espagnol envoyé en Amérique pour y répandre le christianisme, avait, dans son contact avec les indigènes, observé la vénération qu'ils professaient pour cette plante. Il en envoya les premières graines à Charles-Quint en 1518, chargeant Cortez de les remettre lui-même au grand monarque. Elle se répandit ensuite en Portugal, où on la cultivait comme plante de curiosité et d'ornement. La noblesse élégante de l'arbuste, l'auréole de divinité et de guérisseur universel dont il s'entourait pai les mille légendes qui l'avaient accompagné sur le vieux continent, le faisaient rechercher par toutes les personnes éprises du merveilleux. C'est ainsi que fut amené à le connaître Nicot, ambassadeur de France à la Cour de Portugal. Il le présenta, en 1560, à Catherine de Médicis [1519-1589], reine et régente de France. CATHERINE DE MÉDICIS
Avant d'aller plus avant dans la légende du tabac, arrêtons nous un peu à sa marraine et sa patronne, Catherine de Médicis. L'herbe de Nicot se lie si intimement à la reine de France, qui fit son prestige et créa sa fortune, qu'il faut faire marcher de front l'histoire de ces deux individualités, qui remplirent cette époque d'impressions si profondes. Le passage de la Florentine, comme on l'appelait alors, à la Cour de France, y laissa pendant plus d'un demi-siècle, tant d'agitation, tant de souvenirs, qu'un grand nombre d'écrivains s'attachèrent à pénétrer toutes les particularités de sa vie. Les détails que nous donnons sur elle sont puisés dans doux de ses historiens spéciaux: Alberi et Destigny. Catherine de Médicis était fille d'une princesse de sang Bourbon, Madeleine de Latour, mariée à Laurent de Médicis, dont le chef de famille, si ton remonte aux souvenirs de l'histoire, n'était autre qu'un charbonnier enrichi et parvenu. Ses fils, devenus médecins, prirent le nom de leur profession, medici, d'où l'on fit Médicis. Et, ce qui confirme cette origine, c'est que les Médicis avaient pour armoiries cinq pilules sur un champ d'or. Catherine naquit le 13 avril 1519, à Florence, ce qui lui fit donner plus tard, dans le grand rôle qu'elle joua dans l'histoire, le nom de la Florentine. Sa mère mourut en lui donnant le jour. Son père la suivit bientôt dans la tombe. L'orpheline resta soumise aux soins de deux papes, ses oncles, Léon X, qui ne soigna que deux ans son enfance et mourut de mort subite, et le cardinal Jules de Médicis, élevé à la papauté le 5 novembre 1523, sous le nom de Clément VII, et qui était le seul parent restant de celle qui devait plus tard devenir une reine de France. Après la mort de Laurent de Médicis, son père, les parents de l'orpheline, imbus des idées superstitieuses qui dominaient les mœurs d'alors, avaient consulté les astrologues les plus renommés sur le sort et l'avenir deleur pupille.
Les papes avaient alors la haute direction des alliances royales dans les pays catholiques; et ce fut par l'influence de son oncle, Clément VII [1523-1534], qu'elle arriva à la Cour de France, en 1533, par son mariage avec Henri II [1547-1559], second fils de François Ier [1515-1547]. La jeune princesse, qui n'ignorait pas toutes les prédictions fatalistes dont elle avait'été l'objet, voulut les vérifier elle-même, et se lança dans toutes les excentricités de la magie. Elle admit dans son intimité tous les astrologues, les alchimistes, les nécromants les plus renommés du temps, et se livrait à toutes les pratiques de la sorcellerie. Elle interrogeait tous ces médiateurs mystiques entre elle et sa destinée, et tous lui répondaient qu'elle serait reine. Le dauphin François, frère aîné de son mari, la séparait du trône. Il mourut d'une mort si inattendue et si prompte, le 10 août 1536, qu'elle fit naître les soupçons d'un empoisonnement. Les oracles de la sorcellerie disaient vrai; les destinées de Catherine s'accomplissaient. La mort subite de François l'avait faite dauphine; la mort de François Ier, en 1547, la fit reine, par l'avènement au trône de son mari, sous le nom d'Henri II [1547-1559], héritier présomptif du roi François Ier, son père. La vie de Catherine, qui devait traverser cinq règnes orageux, dans une période de près de soixante ans, se partagea en deux moitiés bien tranchées. D'abord timide et muette, étrangère à la Cour de François Ier, sans prétention et sans parti, au milieu de tant de jalousies et de rivalités bruyantes; sans crédit, quoique jeune et belle, même sur le cœur de son mari, elle ne troubla d'aucune plainte la longue faveur de Diane de Poitiers, sa vieille rivale, dont l'insolence allait parfois jusqu'à prendre sa place. Il semble que sa première étude ait été de s'effacer pour vivre inaperçue, de se faire pardonner son titre d'étrangère et le peu de gloire que son alliance apportait à la couronne de France. Elle réussit, à force de diminuer son rôle, à vivre sans ennemis. Stérile encore, après dix ans de mariage, elle évita pourtant d'être répudiée, et ce fut un premier chef-d'œuvre de son adresse. Elle avait pour se diriger les conseils de son oncle, le pape Clément VII [1523-1534], qui, pour la consoler du délaissement dans lequel la tenait son royal époux, subjugué par l'ascendant de la belle Diane de Poitiers, lui faisait cette recommandation devenue historique:
Elle suivit les saintes exhortations qui lui venaient de Rome, et quand, après dix ans de mariage sans avoir eu d'enfants, Henri II allait passer pour stérile, elle lui donna trois fils qui devinrent trois rois: Excitant peu de défiance, Catherine était à même de beaucoup voir. Elle eut tout le loisir d'étudier son rôle et de mettre à profit cette longue vie de palais, dans ce folâtre essaim de nobles filles suivant les chasses galantes de Ghambord, et se faisant tour à tour, dit le chroniqueur, religieuses de Vénus et de Diane. C'est dans de telles dispositions d'esprit qu'elle devint veuve, par une circonstance toute de hasard, qui devait porter au plus haut paroxysme ses idées fatalistes. On célébrait le mariage du Dauphin, fils de Catherine, avec la jeune et belle reine d'Ecosse, Marie Stuart. Le 27 juin 1550, on préluda aux réjouissances publiques par un tournoi. Le roi [Henry II] lut un des tenants, avec trois des principaux seigneurs de la Cour. Après deux jours de combats et de joutes, Henri, déjà plusieurs fois vainqueur, voulut courir encore contre le comte de Montgomery. Dans cette lutte, le comte porta au roi un coup de lance qui brisa son casque, enleva sa visière, et lui perça l'œil droit et le front. Il succomba bientôt à cette blessure, à l'àge de quarante ans. Sa mort laissait Catherine reine et régente du trône de France, qui revenait à son fils mineur François II. Le sort servait au mieux les vœux de Catherine. La mort aplanissait toutes les difficultés qu'elle trouvait pour arriver au pouvoir souverain. Soit adresse ou maladresse, Montgomery venait de la débarrasser d'un mari indifférent et d'une rivale insolente. Elle régnait donc enfin, seule maîtresse des destinées de la France. Mais elle avait a côté d'elle Marie Stuart, sa belle-fille, dont la beauté lui portait ombrage et dont elle ne pouvait supporter l'ascendant qu'elle avait sur son fils. Elle l'éloigna de la Cour, en l'envoyant à Blois avec son mari, sous prétexte que ce déplacement serait avantageux à la santé du roi. François II, ce fils du miracle, qui vint au monde quand la reine et son époux passaient généralement pour stériles, avait eu le fatal héritage que laissent aux enfants les vices et la corruption des mœurs de leurs parents. Il était couvert d'une sorte de lèpre contre laquelle les ressources de l'art étaient impuissantes. Catherine, après avoir épuisé en vain toutes les ressources de l'alchimie et de la sorcellerie, l'envoya chercher l'air sur les bords de la Loire. A son arrivée dans la résidence royale du château de Blois, les bruits les plus alarmants désolèrent les campagnes. Des enfants en bas âge disparaissaient, et l'on disait que des émissaires du château les enlevaient clandestinement à leurs familles pour être massacrés et donner leur sang, comme remède, au jeune roi, qui le buvait tout chaud pour régénérer le sien dont la masse était corrompue. On en lavait aussi ses plaies pour les guérir. Cet horrible traitement demeurant sans effet sur la santé du roi, Catherine employa, pour le guérir, la panacée des Indes, le tabac, dont Nicot lui avait fait hommage. Elle la soumit aux élaborations de l'alchimie et aux pratiques cabalistiques de la sorcellerie pour en obtenir les vertus qu'elle donnait aux Indiens pour guérir tous les maux. Elle arriva, sans doute, à en extraire, sous une forme plus ou moins concentrée, ce principe toxique que les Indiens en retiraient pour empoisonner leurs flèches, et que, plus tard, découvrit le chimiste Vauquelin. Elle appliqua, sous forme d'onguent, sa panacée sur les ulcères à vif qui couvraient le corps du roi, et, par un effet d'absorption dont on ne se doutait guère alors, la panacée de la reine tua le roi [François II], qui ouvrit ainsi la série des victimes sans nombre que devait faire plus tard la plante de Nicot. Le roi [François II] était mort avec tous les symptômes et la rapidité que cause un empoisonnement. Aussi les médecins qui le soignaient furent-ils soupçonnés de ce crime, qui fit passer la couronne de France à Charles IX [1560-1574], toujours sous la régence de la reinemère, Catherine de Médicis. Elevée dans le palais des papes, elle y avait puisé des principes de superstition et d'intolérance qui avait perverti en elle le sentiment religieux. Eblouie de sa grande fortune, dont elle attribuait la cause aux charmes et aux sorcelleries dans lesquels elle avait une foi toute fervente, elle s'enfonçait de plus en plus dans les sombres mystères des sciences occultes. Elle se mit en relation avec les plus fameux astrologues, dont le nombre s'élevait alors à plus de dix mille. Elle était en rapport avec Gabriel Simeoni, pour implorer les secours de ses conseils. Elle demandait au célèbre Milanais Cardan un talisman dont la vertu magique pût la préserver de toute fâcheuse atteinte. Et, après la mort du savant Gauric, son astrologue ordinaire, à qui elle abandonnait toute sa foi superstitieuse, elle appela près d'elle le magicien Régnier, qui s'empara bientôt de toute sa confiance, et madame Castellane, que l'on renommait aussi pour sa science dans l'art des prédictions. Elle avait élevé au culte du fatalisme, à l'hôtel de Boissons, une colonne ou tourelle qui existe encore, adossée au bâtiment de la Halle au blé, à Paris. C'est du sommet de cette tour qu'elle interrogeait les astres et leur demandait des conseils dans toutes les circonstances importantes de sa vie privée et de l'administration de son royaume. De plus, cette reine catholique s'était laissé fasciner par les rapports merveilleux qu'elle avait lus dans les publications de son compatriote AméricVespuce, sur les usages des Indiens, dont les prêtres rendaient des oracles sous l'inspiration d'un bon génie, personnifié dans leur plante Petun (tabac). Elle avait conçu pour cette plante la même vénération qu'avaient pour elle les idolâtres; elle imitait les pratiques de ces pauvres fatalistes, qui espéraient tout d'elle et de ses inspirations sur leur imagination rétrécie. L'herbe favorite de la reine était partout. Elle étalait la majesté de sa tige, de ses feuilles et de sa corolle dans les jardins comme dans les boudoirs des palais royaux. Imitant les prêtres indiens, Catherine s'enfermait dans les couches épaisses de sa fumée; et là, sous l'influence des vapeurs narcotiques qui bouleversaient son cerveau par des sensations étranges, jusqu'alors inconnues, elle se croyait inspirée et prenait pour des conseils de son bon génie toutes les bizarres et folles impressions que lui causait cette ivresse extatique. Ainsi, cette organisation nerveuse, primitivement douce, sensible et bonne, se modifia tellement, sous la double in- fluence des idées superstitieuses et du narcotisme qu'elle puisait dans les émanations de la plante favorite, qu'elle se jeta dans toutes les aberrations monstrueuses où mène la toute-puissance au service du fanatisme et de la folie. C'est ainsi qu'elle conçut et organisa froidement, sous Charles IX [1560-1574], un des plus grands crimes qui soient jamais entrés dans une pensée humaine: la Saint-Barthélémy. Dans un de ces accès de délirium si fréquents chez les nicotinés, elle avait rêvé, sans doute, qu'elle devait faire à Dieu une offrande digne des grandes faveurs dont il l'avait comblée. Et quel sacrifice pouvait lui être plus agréable que le sang des hérétiques, dissidents de la vraie Foi? Ecoutons encore ce que dit l'histoire:
En 1575, un sieur Henry Etienne, écrivant sur Catherine de Médicis, disait, page 52:
A l'occasion du massacre de la Saint-Barthélémy [1572], le même auteur [Henry Etienne] écrit, page 73:
Catherine, par la mauvaise éducation qu'elle avait donnée à ses fils, et par l'ascendant qu'elle avait sur eux pour leur faire commettre toute sorte de crimes, avait soulevé contre elle et contre Henri III [1574-1589] le peuple et les seigneurs influents. De cette animosité naquit la Ligue, dont le but était de les faire tomber du trône. A la Ligue, Catherine et son fils opposèrent encore la trahison et le crime. Feignant une réconciliation avec le duc de Guise, le plus influent et le plus redoutable des ligueurs, ils l'attirèrent dans un guet-apens, au château d'Amboise, et le firent assassiner dans un corridor qui séparait leurs deux appartements, et d'où ils purent avoir la barbare, mais douce satisfaction d'entendre râler la victime sous le poignard des mignons de la Cour. Le cardinal de Guise, son frère, fut également égorgé le lendemain. Catherine fit brûler son corps et jeter ses cendres au vent, de peur que les ligueurs n'en fissent des reliques. Tout cela se passait en 1588, seize ans après la Saint-Barthélémy [1572]. En apprenant le massacre de ces deux principaux soutiens du christianisme et de la foi, la Cour de Rome lança contre les auteurs de ces crimes les foudres de l'excommunication. Soixante-dix docteurs réunis en Sorbonne déclarent Henri III [1574-1589] déchu du trône, et délièrent ses sujets du serment de fidélité. Catherine, en proie à ces frayeurs superstitieuses qui viennent, dans des moments solennels, frapper le cœur des grands criminels, s'éteignit dans les angoisses du remords que les foudres du pape avaient fait naître en elle. Sa mort fut regardée avec indifférence par son fils, qui fut aussi son complice. Il ne prit aucun soin de ses funérailles.
D'après ce que l'expérience nous a révélé sur les effets mystérieux et toxiques produits sur l'organisme humain par le Génie de la mort des Indiens idolâtres, leur dieu Petun, devenu l'idole des civilisés du dix-neuvième siècle, qui pourrait dire que cette reine, qui a ensanglanté l'histoire de tant de crimes, n'a pas été poussée à toutes ces monstruosités, si au-dessus de sa nature de femme, par abaissement de son esprit et de son cœur, desséchés et, dégradés dans les acres vapeurs du tabac, dont elle se saturait dans ses pratiques de sorcellerie et de fatalisme, comme s'en saturent, de nos jours, dans les tabagies et les tavernes, nos grands excentriques de la monomanie et du crime! CATHERINE DE MÉDICIS MARRAINE
Catherine débutait donc dans sa royale carrière, quand elle connut la plante do Nicot. Cette femme à l'enthousiasme ardent recherchait avec affectation, comme les parvenus, tout ce qui pouvait faire parler d'elle. Le grand Nostradamus, qu'elle admettait à la Cour, l'avait initiée déjà à tous les secrets de la magie et de l'astrologie. Fille de médecins, devenue reine, elle devait naturellement aspirer au don merveilleux de guérir. Par rivalité de privilège avec les rois de France, qui ne guérissaient, par droit divin, que les écrouelles, elle rêva de guérir tous les maux par sa propre puissance. Fanatique et superstitieuse, elle s'appropria la plante de Nicot, le dieu Petun, la panacée universelle des sauvages du Nouveau-Monde, en un mot le Tabac. Elle l'introduisit dans son royaume sous son tout-puissant patronage. Une reine ne pouvait moins faire pour un dieu d'idolâtres détrôné par le christianisme, et cherchant une position à la Cour des rois de France. Elle lui donna son nom: Catherinaire, Médicée, herbe a la Reine, avec le titre pompeux de panacée universelle. On l'appela aussi herbe sainte, herbe de Sainte-Croix, saine et sainte, vulnéraire des Indes, jusquiame du Pérou, panacée anthartique, herbe à tous les maux. Ainsi, pendant près de trente ans, Catherine de Médicis [1519-1589] employa toute son influence pour faire prévaloir dans ses États sa plante privilégiée. Soit fanatisme ou mode, l'usage du tabac, parti de si haut, devait rapidement se répandre dans tout le monde civilisé. La Cour de France, dès ce temps-là, avait tout le prestige et l'ascendant de l'initiative de la fashion. Ridicule ou bon ton, tout ce qui se faisait dans les palais royaux était, comme de nos jours, accepté avec engouement et sans contrôle de raison, par cet immense troupeau d'imitateurs qu'on appelle la nation. Pour se faire une idée de l'influence d'un haut patronage sur le succès des plus grands ridicules, qu'on se rappelle l'effet que produisit, à la Cour de Napoléon III [1852-1870], la première crinoline, qu'inaugura l'impératrice Eugénie pour dissimuler l'état intéressant où elle se trouvait alors. La crinoline de l'impératrice de France a fait le tour du monde. Toutes les nations ont subi la lourde importunité de cet encombrant vêtement. Pendant douze ans, les usines de tous les pays ont étiré en lames d'acier, pour ces cages à femmes et à enfants, beaucoup plus de métal qu'il n'en eût fallu pour une ligne de chemin de fer faisant le tour du globe. Et un beau jour, cette féerie de la mode disparut, sans raison, comme elle avait pris naissance; parce qu'il plut à l'impératrice de dresser en diadème les ondes dorées de sa luxuriante chevelure. A l'exagération de la crinoline déchue succéda alors une autre exagération non moins excentrique: celle de la coiffure. La tyrannie du chignon, dans sa toute-puissance, alors, domine encore le beau sexe pendant dix ans. Elle attendra, pour disparaître, qu'en l'absence d'une Cour de France, il naisse, dans nos hautes régions du bon ton, une fantaisienouvelle dont la simplicité, toute républicaine, remplacera dans la toilette des femmes ces monumentales couronnes où l'insuffisance des cheveux appelle à son secours toute sorte de matériaux d'emprunt. Si, dans nos sociétés éclairées, l'instinct d'imitation qui est le faible des êtres primitifs, est si puissant, que devait-il être en plein Moyen Age, sous Catherine de Médicis? Le tabac, prôné par la reine comme souverain en médecine et en magie, c'était l'étincelle électrique qui devait faire bondir tous les esprits. Par l'étendue du programme de sa puissance, il se recommandait à tous les âges, à tous les sexes. A l'instar de Catherine, qui l'employait dans ses pratiques de sorcellerie et de cabalistique, la curiosité superstitieuse des femmes lui demandait la solution de tous les problèmes secrets de leur vie. A l'instar des alchimistes qui l'employaient dans la droguerie, les bonnes grand'mères s'en servaient, suivant la formule du médecin Leander, en l'associant aux cendres des petites hirondelles brûlées toutes saignantes avec leurs nids, pour rendre la santé aux jeunes poitrinaires, qui mettaient en ce traitement toutes leurs espérances. Leur crédulité naïve leur disait que les hirondelles et le tabac, venant de bien loin, d'un monde inconnu, ne pouvaient être que des envoyées de Dieu pour les guérir. A l'exemple de Charles IX [1560-1574], a qui la reine le faisait prendre en poudre par le nez, pour purger les humeurs strumeuses de son cerveau, tous les hommes de bon ton le prisaient.
Les médecins et les alchimistes protestèrent contre cette invasion de la Catherinaire, herbe à tout guérir, qui n'était autre chose que la négation de la science et la spoliation de leur profession. Deux principes ou éléments formaient la base des sciences médicales d'alors: l'élément froid et l'élément chaud. Toute la matière médicale, sur laquelle opérait l'alchimie, avait pour mission d'agir contre ces deux principes d'où dérivaient toutes les maladies. La classification naturelle des drogues se réduisait donc à deux ordres: premier ordre, remèdes chauds, que l'on employait contre les maladies d'origine froide; deuxième ordre, remèdes froids, que l'on opposait aux affections de cause chaude. La science de la logique existait aussi, et elle n'admettait pas, de concert avec la raison, qu'un remède qui avait la prétention de guérir toutes les maladies, fût à la fois chaud et froid. L'herbe à la reine perdait donc d'emblée, par cette première objection fort juste et irréfutable, la moitié de son prestige et de sa vertu. Elle ne pouvait plus raisonnablement être considérée que comme une demi-panacée. Elle ne pouvait guérir que les maladies chaudes ou les maladies froides; elle avait à choisir. De là un grand schisme qui divisa les savants de la médecine et de l'alchimie. Le dogme de l'infaillibilité du pape posé à la décision du concile de 1870 [sous le pape Pius IX], ne souleva pas plus d'intérêt, ne captiva pas plus la curiosité que dut le faire alors l'appel, à la barre de la science, de l'herbe protégée par la toute-puissante reine Catherine de Médicis [1560-1574]. Alors plus que jamais existait pour les sciences médicales l'éternel adage: Hippocrate [460 - 377 B.C.E.] dit oui, et Gallien [130 - 200 C.E.] dit non. Il se forma deux camps dans lesquels on s'évertua à grandir ou à abaisser la puissance curative de l'herbe merveilleuse. L'histoire ne dit pas si, dans un troisième camp, on fit le recensement des victimes des expériences et de la lutte. Et tant de bruit se faisait pour savoir si l'herbe favorite de la reine avait des propriétés chaudes ou des propriétés froides! Les brochures, les pamphlets, les satires défrayèrent peu- dant plus d'un demi-siècle les spéculations des habiles et la croyance débonnaire du public. Jamais sujet n'a donné lieu à tant d'écrits, à tant de débats, à tant de controverses. C'était l'esprit de parti dans toute son effervescence. Et le tabac gagnait toujours en importance, par cette grande agitation que l'on faisait autour de lui. Chacun désirait le connaître; on voulait en avoir pour l'expérimenter et se faire juge entre les deux opinions opposées. Jamais engouement populaire n'avait été si grand. Ce dut être alors, mais dans des proportions infiniment plus étendues, le phénomène de séduction qui s'est produit en notre temps, à l'époque du choléra de 1834; quand le pharmacien [F. V.] Raspail [1794-1878], jetant dans le public sa théorie des animalcules parasites, vivant dans nos tissus et causant toutes nos maladies, proposa comme panacée universelle, devant guérir tous nos maux, le camphre, qui, selon lui, détruirait les insectes qui rongent nos organes quand nous sommes malades, comme il détruit les mites qui mangent nos habits. Qui n'a pas porté alors, en plein dix-neuvième siècle, son petit sachet de camphre préservateur? qui n'a pas fumé la cigarette Raspail, coquettement rangée dans un tuyau de plume fermé par du coton? Raspail a su convertir tant de tètes crédules à ses théories fantaisistes, qu'il a fait, en même temps que sa fortune personnelle, la fortune éphémère, il est vrai, du camphre guérisseur. Cet obscur inconnu, sortant si subitement des flacons poudreux des droguistes, aurait détrôné le tabac, si ce dernier n'avait eu pour lui l'auréole d'ancienneté et de divinité de son origine, le prestige royal qui l'avait introduit au milieu de populations moins incultes que celles d'où il venait, mais à qui il avait imposé déjà un nouveau fanatisme; s'il n'avait eu surtout le protectorat de l'État qui, pour en retirer des impôts usuraires, le soigne, le manipule, le tripote et le présente au public sous des formes si séduisantes qu'aucune faiblesse humaine ne saurait lui résister. LE TABAC ENTRE DANS LA MÉDECINE. —
Pendant que, dans les deux camps, défenseurs et ennemis du tabac rompaient des lances, sans succès décisif pour un côté ou pour l'autre, le commerce, habile à faire argent de tout, envoyait ses vaisseaux charger sur les côtes d'Amérique la plante tapageuse et à la mode. Elle poussait surtout naturellement dans l'archipel des Antilles, et on allait la chercher dans la petite île de Tabago, qui fait partie de ce groupe et qui avait appartenu primitivement aux Hollandais. C'est du nom de cette île que lui vint le nom de tabac; qui remplaça le nom de petun, qu'elle avait parmi les Indiens. Le tabac entra alors dans le domaine du trafic. C'était à qui, pour en vendre davantage, exalterait le plus ses qualités curatives et magiques. Chaque libelle à qui il fournissait un titre ou un sujet était un prospectus entraînant le public à la consommation et, par suite, à la vente. C'était le génie de la spéculation mis en pratique; ce même génie qui inspire, de nos jours, tous ces pompeux imprimés, où le traitement du docteur un tel; la Moutarde blanche, le café Ceze, la délicieuse Revalescière Dubarry, etc., etc., sont plus que suffisants pour guérir toutes les maladies de l'humanité, sans compter les con- currences que leur font, en autres pays, des substances non moins efficaces ni moins célèbres. Un de ces fanatiques, nommé Baillard, publiait vers le milieu du dix-septième siècle, une réclame où, après avoir exposé les merveilles de la catherinaire, pour guérir tous les maux sans exception, il terminait ainsi son dithyrambe:
Par toutes ces élucubrations répandues dans un public aussi superstitieux qu'ignorant, l'engluement pour le tabac était devenu si grand, les recettes qu'on retirait de sa vente étaient si considérables, qu'on l'acclimata pour la culture dans presque tous les Etats de l'Europe. Pour accaparer les bénéfices qu'il créait, des spéculateurs intrigants obtinrent des gouvernements le privilège de son commerce. Moyennant un impôt fixe qu'ils payaient, l'État protégeait un monopole qui était la source de fortunes immenses basées sur l'ignorance du peuple, l'exploitation de ses croyances erronées et de ses futilités dangereuses.
toujours grandissante des croyants aux vertus merveilleuses de l'herbe de Nicot. On trouve cependant à la bibliothèque Mazarine, à Paris, une traduction française d'un ouvrage écrit en latin à l'époque des grandes discussions sur le tabac. L'auteur de cet ouvrage est un médecin de Leyden, Jean Leander. Il a pour titre: [Tobacologia: Hoc est Tabaci, Sen Nictotinae Description Medico-Cheiurgico Pharamceutica (1622), traduit] Traité du Tabac ou Panacée universelle. La traduction est de 1626, par Barthélémy Vincent, à Lyon. L'auteur de la traduction, s'adressant au public, lui dit:
Après cette préface du traducteur, il ne sera pas, sans intérêt, à notre époque, de connaître la nature des discussions et l'excentricité des théories sur lesquelles se basait le grand succès de la panacée universelle. Je continue donc à citer Jean Leander:
Vers la fin du dix-septième siècle, le docteur Nicolas Le- mery [1645-1715], de l'Académie royale des sciences, dans son Traité de Chimie, disait du tabac, page 627 de la douzième [12ème] édition:
D'après ce chimiste, on emploie aussi le tabac en l'associant, pour le traitement d'une foule de maux, à l'huile et à l'esprit de tête humaine.
On pourrait peut-etre pardonner a ce temps d'ignorance et de superstition d'avoir introduit dans la matière médicale la graisse de pendus, à laquelle le vulgaire attache encore de nos jours des vertus merveilleuses; mais le tabac associé à l'huile et à l'essence de tête d'homme distillée à la cornue, comme on faisait des crapoaux et des vipères, pour guérir les malades, n'est-ce pas le dernier degré d'aberration du sens humain dans les folles pratiques de l'alchimie?
Honoré des privilèges de tous les gouvernements, qui lui décernaient un brevet de vertu, en protégeant les spéculateurs qui brocantaient, par son aide, sur la santé publique, il avait été admis a l'insigne honneur d'entrer dans la Thériaque. De même que, dans ce bon temps, on cherchait le moyen de faire de l'or avec tout, par la pierre philosophale, qui devait être, si on l'avait trouvée, le procédé qu'employa Dieu pour faire le monde de rien, on cherchait aussi le remède qui devait guérir tous les maux.
La pierre philosophale de la médecine, ou la panacée universelle si longtemps rêvée, se trouvait alors représentée par la Thériaque. La thériaque était la réunion de toutes les sub- stances reconnues pour avoir des propriétés curatives sur telles ou telles maladies, et condensées dans un seul remède, désigné sous le non générique d'Electuaire. Les drogues admises à l'honneur de faire partie de la thériaque se comptaient alors par centaines. Sous le ministère Guizot, en 1837, une commission de savants académiciens fut chargée de rédiger un nouveau Codex de la matière médicale et pharmaceutique de France, plus conforme aux sciences médicales et aux lumières du temps. Elle ne voulut pas immoler tout d'un coup toutes ces vieilles superstitions populaires qui avaient donné à la thériaque, pour guérir les maladies, presque autant de foi et de confiance qu'on en avait autrefois dans la sorcellerie et la magie, auxquelles elle avait succédé. On conserva sa formule, qu'on réduisit à soixante-douze éléments médicinaux seulement. Quand le tabac entra dans la thériaque comme remède majeur, il jeta la discorde dans tous les éléments bénins qui la composaient. Elle avait été, dans le principe, si sagement combinée, que toute maladie, qu'elle fût d'essence chaude ou froide, strumeuse ou bilieuse, etc., etc., y rencontrait toujours un adversaire spécifique pour la combattre. La médecine populaire était alors dans sa plus grande simplicité. Suivant l'intensité de la maladie, on prenait chez le droguiste pour deux, quatre ou six sous de thériaque, comme aujourd'hui on y prend de l'orbe ou du tilleul; et l'on se guérissait plus ou moins, sans l'intervention du médecin.
La thériaque, dont les manipulations étaient fort compliquées, se faisait une fois l'an, avec grande solennité, en réunion et sous la surveillance des alchimistes et des droguistes les plus réputés en science. Les plaintes contre son infériorité et ses insuccès arrivaient de toutes parts au docte conciliabule, qui s'empressa d'en rechercher les causes. Le tabac avait déjà été pris plusieurs fois en flagrant délit d'avoir causé, de par le monde, des morts subites, comme de nos jours le chloroforme. Il fut considéré comme suspect et perturbateur des vertus curatives de l'électuaire de sapience, qui, délivré de la présence de cet intrus, dangereux parasite qui le discréditait, reprit toiate la faveur que le tabac lui avait accidentellement fait perdre.
Le tabac qui, du temps de Catherine de Médicis [1560-1574], avait eu tout crédit à la Cour, était entré dans les bonnes grâces des grands seigneurs. Il était devenu pour ainsi dire une livrée de courtisans. On ne paraissait dans le monde officiel qu'avec sa petite boîte garnie d'herbe à la ruine. Ses ennemis l'avaient tellement battu en brèche, pour ses méfaits, qu'on n'osait plus ni l'ingérer dans l'estomac, ni l'introduire dans les yeux et les oreilles, sous aucune forme que ce fut. On le portait en amulette. C'est alors que, pour lui donner un rôle d'utilité plus expressive, on s'imagina de l'introduire dans le nez, lui créant par là un emploi et un attribut auxquels les sauvages n'avaient jamais pensé. Le nez l'adopta mieux que l'estomac. Son principe âcre et irritant produisait sur la muqueuse olfactive une telle surexcitation que les liquides y arrivaient aussi abondants qu'ils affluent aux yeux, pour les débarrasser de tout corps étranger qui les gêne. A ce phénomène de sécrétion de liquides se joignait une sensation de vertige et d'ivresse, dont on ne soupçonnait pas alors la cause toute vénéneuse, et que l'on considérait comme une action mécanique de la poudre allant chercher, pour les extraire, les humeurs strumeuses du cerveau, conformément au doctes théories du médecin [Jean] Leander, que j'ai citées plus haut [pp 52-55]. Alors les cerveaux sains ne devaient pas exister, d'après la conviction des priseurs; tous avaient leurs strumes, leurs humeurs peccantes dont il fallait les débarrasser. Et les strumes coulaient toujours; plus on en tirait, plus il y en avait. Les nez des amateurs étaient autant d'exutoires internes qui, comme les sainbois, les mouches et les cautères sur les bras, sécrètent des sérosités muqueuses aussi longtemps qu'on les irrite avec des onguents. Le moulin à tabac et à la tabatière étaient encore bien loin dans l'avenir. L'art de priser était dans son enfance. Les amateurs avaient une petite râpe en métal, avec laquelle ils convertissaient la plante en poudre, au fur et à mesure de leurs besoins ou de leur fantaisie; on râpait la carotte sur une petite gouttière en bois ou en ivoire, et on en offrait à son entourage, avec tout le cérémonial de l'étiquette et du bon ton. Molière [Jean B. Poquelin, 1622-1673], dans la peinture de ses marquis petits-maîtres, les présente le nez, les lèvres et le jabot barbouillés de tabac, de cette herbe puante dont l'usage, disait une femme célèbre de ce temps, ne pouvait durer.
Ceux qui le mettaient dans le nez l'avaient sous forme de bâtons roulés, renfermés avec la râpe dans des boîtes plus ou moins luxueuses, que l'on laissait sortir à moitié de la poche du gilet, avec une ostentation toute coquette. Tout le luxe que l'on étale ordinairement aux doigts, dans des anneaux de métal ornementés de ciselures et de pierreries, se reporta sur la boîte à tabac, qui devint un joyau indispensable à la garde-robe de tout gentilhomme élégant. La tabatière et l'usage du tabac se multiplièrent puissamment et grandirent en importance par la forme du cadeau. Les souverains, les grands personnages s'en servaient avec des inscriptions honorifiques, pour témoigner de leur haute estime ou de leur reconnaissance pour des services rendus. Dans ces temps-là, la tabatière avait son rôle diplomatique. C'est en s'offrant réciproquement une prise que les grands dignitaires s'accostaient et entraient, sans avoir l'air d'y attacher de l'importance, dans la discussion des points les plus délicats à aborder. C'est alors que la boîte à tabac, en faveur chez les grands de la terre, s'éleva à toute la hauteur d'un objet d'art, atteignant parfois des valeurs inimaginables. Ah! si le dieu [Petun] des sauvages de l'Amérique n'avait pas été un faux dieu, s'il avait pu avoir conscience des honneurs qu'on lui rendait, comme il se serait réjoui de se voir choyé, mitonné, dans ces petits bijoux de boîtes, tout or et diamants, comme jamais aucun autre culte n'en a inspiré à l'esprit des hommes! Et dire que toutes ces richesses artistiques n'étaient mises en œuvre que pour loger pour deux sous d'herbe à la reine! Le peuple, qui voyait les seigneurs s'offrir avec ostentation la prise de tabac dans leurs boîtes d'or et d'argent conçut nécessairement une haute idée de la poudre que ces messieurs se mettaient dans le nez. Il voulut en faire autant. On fabriqua pour lui la tabatière en buis, en corne de bœuf, en cartonpierre, en écorce de cerisier et de bouleau. Les plus modestes, les jeunes femmes et les jeunes filles surtout, qui ne voulaient pas paraître avoir des défauts, comme si leur haleine parfumée de tabac ne les trahissait pas, prisèrent dans le cornet de papier de la boutique. Tous les vieux manuscrits, tous les vieux imprimés disparurent alors en cornets à tabac. Que d'oeuvres précieuses de l'esprit humain ont dû s'anéantir dans cette grande hécatombe! C'est ainsi que, pour faire les uns comme les autres, grands et petits, tout le monde prisa. C'est l'histoire des moutons de Panurge, spirituelle allégorie de la puissance entraînante de l'exemple sur les êtres faibles: un de ses moutons étant accidentellement tombé dans l'eau, tous les autres le suivirent et s'y noyèrent. LE TABAC PERD DE SA RÉPUTATION DE PANACÉE. Il y avait déjà bien cent ans que l'on prisait pour se préserver des maladies dont le point de départ, au dire de la science d'alors, était toujours le cerveau, qui les engendrait et les envoyait sous forme d'émanations malsaines à tous les organes, et les maladies n'en tourmentaient pas moins la pauvre humanité. Elle avait certainement en plus à souffrir des maux que lui causait la prétendue panacée. L'herbe de la reine se trouvait donc, par cette long-ue expérience, considérablement ébranlée dans la haute réputation que sa marraine lui avait faite. Elle vivait sur son ancien crédit; elle ne faisait plus de conquêtes. Ses premiers adorateurs en usaient toujours, mais avec cette confiance tiède qui se traduit généralement par ces mots:
La foi s'éteignait, et il ne restait plus que l'habitude. Le règne du tabac, dépouillé de son prestige de panacée, et abaissé au rang d'un usage malpropre, semblait près de finir, quand les luttes académiques recommencèrent au sujet de ses vertus curatives. Les brochures pour et contre surgirent encore de toute part. C'était la mise en jeu de l'intérêt contre la raison, après avoir été, dans le siècle précédent, le conflit des superstitions les plus opposées. Le parti de la raison comptait dans ses rangs les médecins, dont la voix n'avait encore que bien peu d'autorité, par le faible prestige de leur origine et par les sarcasmes plus ou moins piquants dont les poursuivaient de malicieux écrivains, au sujet de leur art encore problématique.
On leur répétait aussi toujours, pour paralyser leur opinion: Hippocrate [460 - 377 B.C.E.] dit: Oui, et Gallien [130 - 200 C.E.] dit: Non. Le parti de l'intérêt était, au contraire, tous ces marchands satisfaits, enrichis de tous les régimes qui leur concèdent des monopoles à l'ombre desquels ils convertissent paisiblement leurs sous en bons écus d'argent. La ligue de l'intérêt l'emporta; l'opinion du public, encore une fois égarée, se préoccupa du tabac qu'elle semblait avoir délaissé.
Et, à l'appui de leur opinion et de leurs théories, ces doctes invoquaient gravement la science et les usages des Indiens, qui ne prisaient pas le tabac, mais qui en recelaient la fumée par la bouche et allaient même jusqu'à l'avaler. C'est alors que les sectes des fumeurs et des chiqueurs prirent naissance dans un conflit d'opinions les plus extravagantes. Les premiers fumeurs apparurent sous Louis XIII [1610-1643]. Los marins fréquentaient de plus en plus les côtes de l'Amérique et, par ce penchant naturel à tous les voyageurs, ils aimaient à reproduire dans leur pays ce qui les avait le plus frappés dans leurs expéditions lointaines. Ils fumaient donc, pour imiter les Indiens. Le petit appareil des sauvages, à la bouche d'un matelot, distillant la fumée suffocante du tabac, était bien loin d'égaler l'élégance et le bon ton de la boite à priser. Aussi les marins ne trouvaient-ils que bien peu d'imitateurs parmi les fanatiques du tabac. Il fallait à la pipe, pour faire son entrée dans le monde, un type humain quelconque qui la couvrit de sa popularité ou de son prestige, comme Catherine de Médicis [1519-1589] avait couvert la plante de Nicot. Alors parut [le Capitaine] Jean-Bart [1650-1702]. Disons ce que fut ce vaillant capitaine, afin de faire mieux comprendre de quelle influence a été son exemple dans le succès du tabac à fumer et de la pipe.
La guerre venait d'éclater entre la France, d'un côté, et la Hollande alliée avec l'Angleterre, de l'autre; et, en bon patriote, il vint offrir à son pays la valeur de son courage et de son expérience consommée dans les pratiques de la mer. Né dans la roture, par conséquent indigne de servir comme officier sur les bâtiments du roi, il se fit capitaine de corsaire. Il se signala par tant de traits de courage et d'audace, que Louis XIV [1643-1715] lui donna une commission pour croiser dans la Méditerranée. Il fit un mal considérable aux deux marines alliées de Hollande et d'Angleterre. Appelé à croiser dans la Manche, il avait fait sur les ennemis de nombreuses prises qu'il avait conduites à Bergen, en Suède, où il était rentré pour ravitailler et radouber son navire. Il fut suivi dans ce port de relâche par un navire de guerre anglais, mis à sa poursuite. Le capitaine de ce navire rechercha l'occasion d'entrer en pourparler avec son redoutable ennemi, le commandant du corsaire français. Un jour, il l'aborda sur une place publique:
Et les deux commandants se rendirent à bord du vaisseau anglais. L'équipage du corsaire avait vu son capitaine monter sur le pont de l'ennemi. Que se passait-il qui pût expliquer cet événement? L'attention de tout le monde était intriguée et en éveil; toutes les longues-vues se braquaient, comme des sentinelles en vigie, sur les gaillards de l'anglais. Jean-Bart, qui avait, comme tous les braves, le cœur généreux et droit, était bien loin de se défier des galanteries de la puissante Albion. Il tomba dans un infâme guet-apens. A peine fut-il sur le pont que couvrait le pavillon d'Angleterre, que le commodore, se sentant fort au milieu de son équipage, dit à son invité, venu tout confiant et sans armes:
On faisait à bord du navire angolais l'inspection des poudres. Plusieurs barils ouverts étaient gardés à vue par des marins, sur le pont. Jean-Bart avait à la bouche sa pipe allumée, dont il tirait de longues bouffées, en frémissant d'indignation et de colère. Une de ces grandes idées qu'inspirent la résolution et le courage, dans les moments suprêmes, l'illumina soudain. Plutôt que d'être prisonnier par la trahison, il va s'ensevelir sous les flots, entraînant avec lui tout cet équipage de lâches. L'idée aussitôt conçue, il se fraye un passage au milieu des matelots, arrive sur les poudres; et prenant à la main sa pipe allumée, en guise de torche, il va faire sauter le navire. A la vue de tant de résolution et d'audace, l'équipage effrayé se disperse et se sauve, pour se soustraire à la catastrophe qui le menace. La voix de Jean-Bart tonne, menaçante, sur ce pont de navire qui lui appartient et qu'il dépend de lui d'anéantir. L'équipage du corsaire, qui observait, entend l'appel de son capitaine; il vole à son secours, aborde, la hache à la main, le navire anglais, délivre son commandant et coule bas, dans le port même de Bergen, ce navire qui, violant à la fois les lois de la courtoisie militaire et de l'hospitalité d'un port neutre, venait de jeter sur son pavillon, par un acte de lâcheté, une de ces taches qui y restent toujours. Jean-Bart, jugeant que le guet-apons où il avait failli succomber n'était pas suffisamment puni par la destruction du navire où un acte si bas avait été commis, résolut d'en tirer une vengeance plus éclatante. Les Anglais et les Hollandais bloquaient le port de Dunkerque; Jean-Bart quittant Bergen, passa, avec son corsaire, au travers de leurs escadres. Il gagna les côtes de l'Angleterre, débarqua à New-Castle avec son équipage de braves, et infligea à la ville le châtiment que méritait la trahison de Bergen.
Louis XIV [1643-1715] voulut le voir. Jean-Bart [1650-1702] se rendit à la Cour du Roi-Soleil. L'astre était à son déclin; la gloire de ses beaux jours pâlissait.
Le titre que recevait Jean-Bart lui donnait rang à la Cour, au milieu de ces brillants états-majors de princes, de ducs et de marquis qui dédaignaient la bassesse de son origine et jalousaient sa popularité et sa gloire. Jean-Bart était devenu le héros à la mode de la nation. Original dans ses manières, chamarré d'or et d'argent, il portait toujours, comme complément de sa tenue, la pipe, devenue légendaire, qui avait joué un si beau rôle sur les barils de poudre du pont des Anglais. Il la fumait crânement partout où ils paraissait en public. La pipe de Jean-Bart était devenue une fantaisie d'imitation, comme le furent plus tard le gilet blanc de Robespierre, le jabot de Mirabeau, la chemise rouge de Garibaldi, etc. Tout le monde se prit à fumer, comme le Malouin. Les robustes fumaient le tabac; les faibles ou petits crevés du temps, les enfants, fumaient des herbes quelconques ou de l'anis; mais chacun portait la pipe à la Jean-Bart.
La pose à la pipe, c'est l'usage qu'on en fait sans lui attacher plus d'importance que de faire comme tout le monde, et même mieux que tout le monde, avec une certaine attitude prétentieuse qui a l'air de vous dire:
Si la mise en scène de Jean-Bart, un matelot parvenu, menaçant de faire sauter par le feu de sa pipe un perfide vaisseau de l'Angleterre, a pu répandre parmi nous l'usage imitatif de la pipe, le tableau de l'histoire qui représente un Empereur français cherchant à couvrir sa lâcheté de la fumée de son cigare, est bien fait pour repousser de nos lèvres ce petit appareil de pose dont la fantaisie, née d'une action d'éclat glorieuse pour le pays, devrait finir après un acte de honte qui a si profondément humilié la nation. Jean-Bart, d'une constitution primitivement robuste, mourut en 1702, à l'âge de 52 ans, de phthisie des poumons. Le grand usage qu'il faisait de la plante de Nicot, d'après les effets que l'on en connaît aujourd'hui, devait amener chez cet intrépride marin cette fin prématurée qui brisa beaucoup trop tôt une carrière si valeureusement commencée. Il a subi la loi d'abréviation de l'existence qui frappe fatalement les adorateurs du tabac. La marine française a souvent honoré sa mémoire, en posant sur la proue de plusieurs vaisseaux, à qui elle donna son nom, le buste du vaillant capitaine de Louis XIV [1643-1715]. En 1845, la ville de Dunkerque lui a érigé une statue durable, qu'elle doit au ciseau de David d'Angers.
Jean-Bart mort, la pipe, n'ayant plus de patron haut placé pour la soutenir, tomba tellement en défaveur que, sur le pont des vaisseaux où elle avait été primitivement cultivée, les ma telots fumeurs, qui n'étaient alors que les rares balochards ou mauvais sujets du bord, étaient tenus d'aller piper à la poulaine, c'est-à-dire au lieu le moins noble et le plus retiré de l'avant du navire, pour que leurs bouffées incongrues ne vinssent pas incommoder messieurs de l'État-major. La pipe et le tabac, alors généralement répudiés par le beau sexe et le bon ton, s'étaient réfugiés loin du monde, dans la marine et dans l'armée, où ils ne servaient plus que de distraction à l'ennui et de passe-temps à l'oisiveté de la vie militaire. Après les guerres de Louis XIV, le dix-huitième siècle, qui fut presque une ère de paix générale, laissait peu d'importance, dans l'esprit public, à tous les gens d'armes, dont les usages se renfermaient dans la caserne. L'armée, par ses mœurs, était, pour ainsi dire, un corps à part dans le pays. Le civile, sans enthousiasme pour le militaire, le regardait fumer avec curiosité, et ne l'imitait pas.
De [17]93 à 1815, la nation vécut, pour ainsi dire, dans les camps. Tous les hommes portèrent la tenue militaire, et la pipe devint, pour beaucoup d'entre-eux, le complément indispensable ou à la mode de l'équipement. L'Empire renversé, l'élan révolutionnaire de la nation s'arrêta devant la restauration de principes politiques ayant pour base le trône soutenu par l'autel. L'armée qui avait, aux jours de révolte populaire, abandonné la cause du droit divin pour servir la révolution d'abord et un usurpateur ensuite, tomba dans un profond discrédit. Toutes ces valeureuses légions, qui avaient lutté si long-temps contre la coalition de l'Europe, ramenant dans ses fourgons l'ancienne monarchie et l'ancien régime que [17]93 avait renversés, tous ces vieux débris de glorieuses batailles, on ne les appelait plus que les brigands de la Loire, parce qu'ils étaient concentrés sur les bords de ce fleuve, où on devait bientôt les désarmer. On licencia ces braves gens; beaucoup d'entre eux ne gardèrent, de tout leur fourniment militaire, que la vieille pipe, compagne fidèle de leurs fatigues, qui les avait distraits bien souvent par sa fumée des ennuis du bivouac. Ils rentraient au foyer de la famille, y apportant une habitude dont il leur aurait été difficile de se sevrer, tant le tabac enchaîne et lâche si rarement celui qu'il a une fois saisi. D'ailleurs, ils sentaient toujours une certaine volupté à téter la boufarde, qui rappelait leurs beaux jours, quand ils étaient soldats.
Et ils la pendaient religieusement au clou d'honneur du manteau de la cheminée. C'était tout leur trophée! tout ce que leur avaient légué tant de fatigues et de victoires!
La pipe des soldats de Bonaparte fut peu du goût de nos réformateurs. Elle rappelait trop, par son origine militaire, le règne du soldat parvenu, de l'usurpateur dont Waterloo les avait délivrés. Elle était alors plus que malséante, elle était séditieuse. Repoussée de partout, elle se retirait, comme pour se cacher, dans de petits cafés de rang très modeste, où se donnaient rendez-vous les vieux de la vieille, et que surveillait la police, toujours à l'affût des conspirations militaires, dont les bruits venaient souvent troubler Louis XVIII [1814-1824] et Charles X [1824-1830] sur un trône où les avaient replacés nos ennemis. Tout fumeur était alors considéré comme un frondeur de l'autorité. Dans toutes les situations de la vie d'un jeune homme, il n'existait pas pour lui de recommandation plus défavorable que celle que lui donnaient une haleine ou des vêtements parfumés au tabac. On le flairait, pour savoir les lieux qu'il hantait, avant de se fixer sur le degré de considération et de confiance qu'on devait lui accorder.
Tous les hommes se firent spontanément soldats. Jamais la nation n'avait eu un aspect plus militaire; tout le pays n'était qu'un camp. Alors sortirent de leurs retraites tous ces vieux culotteurs de pipe de l'Empire, caporaux ou sous-lieutenants licenciés de 1815, et qui prirent bravement des épaulettes de capitaines et de commandants des gardes nationales improvisées. A la place d'une République, à qui revenait naturellement l'héritage d'un trône renversé une seconde fois par le mécontentement de la nation, nous nous étions donné une royauté bourgeoise. La nouvelle Cour, au lieu de laisser le peuple arriver jusqu'à elle dans l'imitation des mœurs, descendit jusqu'au peuple. Le roi Louis-Philippe cherchait l'affection de ses sujets dans la simplicité de ses manières. Il sortait à pied dans les foules, le parapluie sous le bras comme tout le monde, donnant la poignée de main et la prise de tabac à tout venant. Ses jeunes fils, élevés au contact des enfants du peuple, faisaient de beaux officiers supérieurs de vingt [20] ans, fumant le cigare, pour se donner un genre, avec tout l'aplomb, des vieux généraux de l'Empire. C'étaient des modèles de tenue militaire, que l'armée cherchait à copier, ainsi que toutes ces légions de soldats citoyens de tout âge, paradant sur les places publiques des villes, des villages, des hameaux, pour apprendre à marcher à l'ennemi. Il y avait plus de corps-de-garde que de mairies. On montait la garde partout, et partout on voyait les zélés militaires s'étudiant à surmonter la nausée narcotique du tabac [plus en anglais], pour mieux apprendre, à endurer les fatigues de la guerre, toujours en perspective, croyaient-ils. La pipe et le cigare, par l'égalité et la fraternité qui confondaient tous les citoyens, avaient fait invasion dans toutes les classes de la société. Ceux qui se rappelleront ce temps n'auront pas oublié ces petites scènes de ménage où la fumée du tabac aurait causé bien des divorces, si la législation l'avait permis. [Plus en anglais]. Les dames accordaient aux messieurs la liberté de la pipe et du cigare quand ils étaient en tenue et en service militaire. Elles allaient même jusqu'à trouver parfois, pour quelques-uns, que cela leur allait bien; mais elles luttaient de toute leur exigence pour les reléguer au corps-de-garde, au café ou en plein air. On contesta toujours à la fumée de tabac le droit d'hospitalité sous le toit de la famille. C'était incommode, inconvenant, sans gène et de mauvais goût. D'ailleurs, la reine [Maria Amelia] et les princesses [Louise et Marie] ne permettaient pas de fumer à la Cour; c'était par trop de mauvais ton. La pipe elle cigare n'étaient pas admis aux jardins des Tuileries, du Luxembourg et dans toutes les dépendances du domaine de la couronne affectées au public. De cette époque, la consommation du tabac, comparativement modérée jusqu'alors, commença à s'accroître dans des proportions considérables. On en usait pourtant avec une certaine réserve, l'usage du cigare n'était que toléré; il était encore loin de faire son entrée dans le bon ton, et de devenir presque obligatoire.
Il composa sa Cour de tous ces dandys politiques, disciples du High life et du Sport d'Angleterre, qui avaient comploté avec lui, dans des rêves d'orgies, les campagnes de Strasbourg et de Boulogne; tous prisonniers d'État, pour crime de haute trahison, sous la monarchie de Louis-Philippe; habitués à chercher dans l'ivresse du tabac des consolations à leur captivité. C'étaient tous des fumeurs émérites, dont la pipe et le cigare semblaient être le blason; car ils les accompagnaient partout. La moustache et le cigare de l'Empereur fanatisèrent bientôt la nation, dans laquelle il avait su, du reste, se créer de vives sympathies qui n'ont pas survécu au déshonneur de sa chute. Partie de si haut, la contagion de l'exemple n'eut plus de bornes. Les beaux jours du tabac, a la Cour de Catherine de Médicis [1560-1574], reparurent à la Cour de Napoléon III. Si son règne, comme panacée universelle ou comme inspirateur des magiciens et des sorciers est passé, il trône en souverain absolu delà mode et du bon ton. Ceux qui ne sacrifient pas à son culte sont une minorité arriérée. La pipe, le cigare, la cigarette et la chique sont partout, passent partout, avec une autorité prétentieuse qui à l'air de vous dire: Si je vous incommode, c'est à vous de vous retirer. Il n'est qu'un seul asile qu'ils n'aient pas encore osé franchir; c'est le seuil de l'église, encore la chique et la prise ne le respecte-t-elle pas. Et l'État, par cupidité d'argent, ce qui est douloureux à dire, couvre de son haut patronage ces futilités malsaines. Il vend à qui en veut, même aux enfants qui n'ont pas la raison, sans leur dire ce que c'est, une drogue que l'gnorance superstitieuse du Moyen Age a pu considérer comme bonne a guérir tous les maux; mais que l'expérience des siècles et le creuset de la science ont ramenée à sa valeur réelle, en la réléguant au rang des plus subtils poisons. ON DÉCOUVRE DANS LE TABAC
L'engouement qui avait accompagné le tabac dès son entrée dans nos usages, les idées préconçues que l'on s'était faites de ses grandes vertus, n'ont jamais permis à la foule ignorante ou prévenue de ses consommateurs d'attacher une sérieuse importance à ses vices. Comme il avait ses amis et ses ennemis, si, ce qui devait lui arriver bien des fois, on le surprenait tuant le malade, au lieu de le guérir, on attribuait volontiers la terminaison fatale à la violence de la maladie elle-même, plutôt qu'à l'action du remède. Tout ce qui se portait au dossier des accusations de mort formulées contre lui était attribué à la médisance, à l'envie, qui s'attachent toujours à dénigrer ce qui est bon. Cependant les faits parlaient de plus en plus haut et venaient attester que la panacée de la reine n'était rien autre chose qu'un dangereux poison. Santeuil, un de nos célèbres poètes, qui écrivait en latin, et qui était assez partisan de la prise, se trouvait comme convive dans un festin. Quelques amis, dissidents du tabac, sans doute, voulant lui faire une farce, qu'ils croyaient inoffensive, en mirent, à son insu, une prise dans un verre de vin d'Espagne qu'on lui offrit. A peine eut-il bu ce fatal breuvage, qu'il entra dans les convulsions d'une atroce agonie, qui se termina bientôt par la mort, au milieu de ses amis, qui venaient de l'empoisonner, quand ils ne croyaient faire qu'une plaisanterie pour rire, à l'occasion de la plante à la mode. Les annales de l'histoire et des sciences abondent en faits semblables. Nous n'en citerons que quelques-uns pour établir que le tabac tue, sous quelque forme et par quelque voie qu'on l'absorbe. On lit dans le Dictionnaire des sciences médicales, tome LIV 1821:
Murray rapporte l'histoire de trois enfants qui furent pris de vomissements, de vertiges et de sueurs abondantes, et qui moururent en vingt-quatre [24] heures, au milieu des convulsions, pour avoir eu la tête frottée avec un liniment composé de tabac, dont on s'était servi pour guérir la teigne. Comme [le roi] François II, dont nous avons déjà parlé [p 39]. [Apollinaire] Bouchardat [1806-1886], dans son Traité de Thérapeutique, cite une observation rapportée par M. Tavignot. C'est un cas de mort qui suivit l'administration du tabac en lavement. Les symptômes qui furent subits se succédèrent avec une effrayante rapidité. Il se manifesta de la pâleur avec stupeur, de la gêne de la respiration qui fut toujours croissante; une abolition complète de l'intelligence. A ces accidents se joignit un tremblement convulsif des bras d'abord, des jambes, puis de tout le corps, qui augmenta pendant dix minutes, et auquel succéda un état de prostration extrême. Le coma et la résolution de tous les membres terminèrent l'agonie; en douze minutes, tout fut fini. Il n'y avait pas eu de vomissements. [Plus, en anglais]. Le Journal de Chimie médicale, tome XV, rapporte le fait suivant:
Le public, toujours indifférent à ce qui devrait l'intéresser le plus, s'inquiétait fort peu si le tabac que prenait si grand soin de lui préparer la régie était ou n'était pas un poison, quand un grand drame judiciaire vint dessiller ses yeux et faire tomber le cigare et la pipe des lèvres de beaucoup de leurs adorateurs fervents. Le 15 juin 1851, la cour d'assises de Mons, en Belgique, jugeait deux grands criminels accusés d'empoisonnement. C'étaient les époux Bocarmé. Les débats de cette affaire, qui a eu un immense retentissement par la nouveauté du poison employé, ont duré du 25 mai au 15 juin. Ils éclairent avec tant d'autorité la question du tabac, que nous transcrivons dans leur entier les détails de ce crime, tels que les ont publiés les annales judiciaires de l'époque. De l'acte d'accusation faite devant la Cour, il résulte que Hippolyte Visart, comte de Bocarmé, âgé de trente-deux ans, et Lydie Fougnies, âgée de trente-deux ans, son épouse, demeurant à Bury, au château de Bitremont, ont, de concert, empoisonné Gustave Fougnies, leur beau-frère et frère.
Bocarmé appartenait, par sa naissance, à une des premières familles du Hainaut. Il avait épousé la fille d'un riche épicier, qui n'avait qu'un frère, amputé de la jambe droite et d'une faible constitution, Bocarmé avait, dans son mariage, spéculé sur l'héritage que lui apporterait la mort prochaine de son beau-frère. Il s'était fait faire testament par sa femme Lydie, pour s'assurer de ses biens. Mais Gustave ne mourait pas assez vite, et il avait même formé le projet de se marier. Ce fut dans cet état de choses que Gustave Fougnies mourut subitement au château de Bitremont, chez les accusés, qui l'avaient invité à diner. Les accusés prétendirent qu'il était mort d'apoplexie. Cependant l'état du cadavre indiquait une mort toute différente; une substance toxique paraissait avoir été employée pour la perpétration du crime. Quelle était cette substance? Les médecins légistes furent appelés à élucider la question. M. Stas, savant professeur de Bruxelles, fut chargé de l'expertise. Ses recherches l'amenèrent à conclure que Gustave Fougmes était mort empoisonné à l'aide de la nicotine. L'enquête a constaté que Bocarmé avait été, sous le faux nom de Bérant, chez Lopens, professeur de chimie à l'école industrielle de Gand, pour s'instruire près de lui sur la manière d'extraire l'huile essentielle du tabac, dont les sauvages de l'Amérique empoisonnaient leurs flèches, comme il l'avait vu dans son pays, aux colonies, où il avait été élevé. Lopens lui fit faire des expériences dans son laboratoire, et il parvint à obtenir de la nicotine pure. De retour chez lui, Bocarmé fabriqua une grande quantité de poison. Il s'exerça sur des animaux pour en étudier l'emploi et les effets. Il l'appliqua, le 20 novembre, sur Gustave. Lydie Bocarmé, qui connaissait les dispositions de son mari à l'égard de son frère, aurait pu empêcher le crime, au moins en en prévenant Gustave. Elle ne l'a pas fait, dit-elle, parce qu'elle était dominée par son mari. La Cour, prenant en considération les motifs allégués par Lydie, l'a renvoyée de l'accusation, et Bocarmé, reconnu coupable, a été condamné à la peine de mort. M. Stas, dans les questions que l'accusation avait posées a résoudre, conclut:
PREMIÈRE EXPÉRIENCE. — Pour confirmer cette opinion, M. Stas a pris, dans les organes de Gustave, une gouttelette des liquides qu'ils contenaient, avec un tube effilé et capillaire. Il touche avec ce tube la langue d'un linot. Au bout de quelques instants, l'oiseau secoue la tête et éprouve des convulsions tétaniques. Il meurt au bout de deux [2] minutes quarante-cinq [45] secondes, en tombant sur le côté droit. DEUXIÈME EXPÉRIENCE. — Une gouttelette infiniment petite, telle qu'il est possible d'en obtenir avec un tube effilé et capillaire, est appliquée sur la langue d'un autre linot. Immédiatement il secoue la tête, a des convulsions tétaniques comme le précédent; il meurt au bout de trente secondes, en tombant sur le côté droit. TROISIÈME EXPÉRIENCE. — Une gouttelette est mise sur la langue d'un pigeon assez vigoureux, une partie du liquide est projetée au dehors par la secousse que l'animal imprime à sa tète. Au bout de quelques secondes, il a des convulsions tétaniques et meurt en une minute et demie [1½]. La justice avait été mise sur la voie des substances employées par Bocarmé pour empoisonner son beau-frère par la découverte, dans la maison, de divers appareils de laboratoire de chimie, et, entre autres, de feuilles de tabac. La science savait déjà que le tabac contenait un principe excessivement vénéneux; mais elle ne l'avait pas encore bien défini et birn élaboré. M. Stas voulant, avant tout, connaître la puissance destruc- tive de la plante qu'il supposait avoir été employée pour la perpétration du crime, opéra lui-même sur elle, par analyse chimique, et en obtint un produit avec lequel il fit les expériences qu'il relate ainsi qu'il suit: PREMIÈRE EXPÉRIENCE. — Chien de taille moyenne, vieux, maigre, d'une faible constitution. On verse sur la langue, au moyen d'une pipette, de la nicotine pure. A peine le poison est-il en contact avec la langue, que celle-ci prend une teinte violacée: l'animal s'agite, mâchonne et fait des efforts comme pour rejeter le liquide ingéré. Il tombe immédiatement du côté droit; il est pris de convulsions tétaniques; la colonne vertébrale se raidit; le cou et la tète se courbent vers le dos; les membres antérieurs et postérieurs s'étendent alternativement, ainsi que la queue; les pupilles sont dilatées, les convulsions gagnent en force; la colonne vertébrale et les quatre membres s'étendent, la queue se courbe, et l'animal expire. Entre l'administration du poison et la mort il s'écoule trente [30] secondes, et à peine la dernière expiration est terminée, qu'il survient un relâchement dans tout le système musculaire de la vie animale. DEUXIÈME EXPÉRIENCE. — Chien adulte, de taille moyenne, d'une forte constitution. On laisse couler sur la langue de la nicotine pure. La langue prend la teinte violacée que l'on avait aperçue dans l'expérience précédente. Il y a émission d'urine; l'animal ne tarde pas à tomber sur le flanc droit et à présenter la série de mouvements convulsifs dont j'ai parlé, avec cette différence que les accès sont plus violents et que la durée s'en prolonge davantage. La mort survient au bout d'une demi-minute.
humble dans la médecine légale, sous la surveillance de la haute police, à côté des poisons les plus traîtres et les plus actifs, dont se servent les pervers pour accomplir leurs crimes: le vert-de-gris et la mort-aux-rats.
PREMIÈRE OBSERVATION. — En 1855, les Chinois envahissaient la Californie en quantité beaucoup plus considérable que n'auraient désiré les Américains, à qui ils venaient faire concurrence pour le travail et les industries lucratives. Les Américains leur étaient donc instinctivement hostiles. Un petit groupe de ces Asiatiques, au nombre de cinq, venait de s'établir pour faire en communauté le commerce du tabac et la fabrication des cigares. Deux d'entre eux vinrent m'appeler la nuit, en me disant qu'on avait massacré leurs camarades, qu'ils les croyaient tous morts. J'arrivai dans une petite maison composée de trois pièces communiquant par des portes ouvertes, et me trouvai en présence de trois corps: deux étaient sans vie et gisaient étendus dans de petites couchettes, superposées l'une à l'autre, comme dans les navires affectés aux passagers. Un troisième, immobile sur le plancher, faisait de grandes aspirations à de longs intervalles. Les deux cadavres étaient encore chauds. Aucune marque de violence ne paraissait sur eux. Les yeux étaient entr'ouverts et fixes, la pâleur était extrême. Ce qui me frappa, moi et le public du quartier mis en émoi par cet événement, ou l'on avait cru tout d'abord voir un crime, fut une odeur de tabac des plus prononcées qui, bien que toutes les portes fussent ouvertes, nous rendait presque impossible le séjour dans l'appartement. Voici ce qui était arrivé: Les Chinois avaient transporté dans la journée, à leur demeure, qui était aussi leur atelier, deux fardeaux de tabac d'un poids total de soixante kilogrammes environ. Un de ces pa- quets avait été ouvert et des feuilles préparées à l'humidité, pour être roulées en cigares le lendemain. Deux des associés étaient sortis dans la soirée, laissant les trois autres, qui s'étaient endormis sur leurs couchettes. (C'est dans cet état, les portes étant fermées, que les émanations narcotiques du tabac les surprirent, les frappèrent de stupeur et de paralysie, les mettant dans l'impossibilité de chercher leur salut dans la fuite. Le Chinois qui donnait encore signe de vie, fut porté dans la rue, au grand air. On le frictionna avec du whiskey. Il fut très long à rappeler à la vie et conserva, après cet accident, un état d'hébétude et de faiblesse de la sensibilité générale. Il n'a pas pu rendre compte de ce qui s'était passé en lui; d'après la disposition de ses vêtements, on a dû supposer qu'il était aussi dans sa couchette, dont il serait tombé, en se débattant dans les convulsions, ou en sautant pour chercher à fuir l'asphyxie dont il avait senti venir les étreintes. 2e OBSERVATION. Une dame irlandaise, mère d'une nombreuse famille, voulait débarrasser ses enfants de vers ascarides, contre lesquels elle avait employé plusieurs traitements infructueux. Elle avait entendu dire que le tabac, en lavements, était un moyen infaillible pour faire périr ces petits vers, qui se tiennent surtout dans le bas intestin des enfants. Elle partagea, entre deux de ses fils, un de douze [12] et l'autre de dix [10] ans, le contenu d'une seringue en étain d'un demi-litre environ. Un troisième enfant, âgé de sept [7] ans, s'était enfui quand sa mère préparait la part qui lui revenait dans le lavement. Elle courut après lui, et le ramena bientôt à la maison. Quelle fut la terreur de cette malheureuse mère, quand elle vit ses deux enfants se tordre sur le plancher, dans les convulsions atroces d'une douleur muette! Elle court effarée chez ses voisins, pour chercher du secours. On m'appelle, j'arrive à la hâte. Ses deux fils étaient morts! Dix [10] minutes s'étaient à peine écoulées entre l'administration des lavements et le dernier signe de vie. Le tabac était encore dans le vase où la malheureuse femme avait fait l'infusion. C'était le même que fumait son mari. J'ai pu évaluer quelle avait mis à peu près quinze grammes de tabac dans six cents grammes d'eau. Je n'ai jamais vu douleur de mère plus déchirante. Pauvre femme qui, dans la pensée de bien faire, venait de faire mourir les deux aînés de ses enfants! Voilà pourtant où conduit l'ignorance des choses qui semblent les plus usuelles. On fume le tabac par la bouche, on le chique, on le prise en poudre par les narines; pourquoi ne le prendrait-on pas en lavement? On s'en garderait bien, d'abord si l'on savait que c'est un poison; et si l'on savait de plus que l'activité des poisons est en rapport avec la rapidité de leur absorption, et que l'intestin est la partie la plus absorbante de tout notre organisme. LE TABAC EMPLOYÉ DANS LA FABRICATION DU CURARE,
Nous avons dit, dans le courant de ce travail, que les sauvages du Nouveau-Monde employaient le Petun, disons le tabac, pour empoisonner leurs flèches. Bocarmé, qui avait vécu longtemps parmi eux, aux colonies, n'ignorait pas cette particularité des usages des Indiens. Aussi il spéculait, en méditant son crime contre son beau-frère, sur l'incertitude de l'impunité qui en résulterait pour lui, parce qu'il dérouterait la justice, par l'emploi d'un poison jusqu'alors inconnu [pp 79-85]. C'est dans cette pensée qu'il se rendit à Gand et demanda, sous un faux nom, au chimiste Lopens, de lui faire connaître un procédé pour extraire du tabac l'huile essentielle dont les sauvages de l'Amérique empoisonnent leurs flèches. C'est ce qui fut établi dans le procès dont nous avons parlé plus haut.
Quand les Américains prirent possession de la Californie, en 1848, ils trouvèrent ce territoire couvert d'une grande quantité de tribus indiennes vivant dans les vallées fertiles et ombragées qu'arrosent les grands fleuves de cette contrée. Le premier soin des nouveaux arrivés fut de chasser ces pauvres indigènes des lieux qu'ils occupaient, pour s'en emparer et y planter leurs tentes d'abord, et plus tard y faire leurs établissements définitifs pour l'agriculture et le commerce. Sur les bords du Mendocino, qui coule entre la Californie et l'Orégon, ces tribus étaient très compactes. Elles y vivaient de glands, doux comme nos châtaignes, que donnent abondamment des forêts de chênes séculaires. Elles avaient en plus la pèche, la chasse et des fruits variés que la terre produit sans culture dans ces régions tempérées. En leur prenant leur territoire, leurs cabanes de terre et de branches d'arbres, on leur prenait aussi leurs moyens d'existence. Et quels droits pouvaient avoir à la vie des populations incultes? . . . On les refoula par la force, la terreur et la persécution, dans les gorges des montagnes, où la misère et la faim leur faisaient une guerre aussi impitoyable que leurs envahisseurs. Dans le dénûment extrême où elles se trouvaient, pressées par la faim, il arrivait parfois à ces créatures malheureuses de descendre furtivement la nuit, comme des ombres, dans leurs anciennes vallées converties en vastes plaines de maïs, et de commettre quelques larcins dans ces riches cultures. Voler quelques épis à ceux qui leur ont volé tout ce que leur avait donné Dieu . . . , quel crime épouvantable! Aussi, le châtiment ne devait pas se faire long-temps attendre. Les colons qui avaient souffert de cette espièglerie des Indiens firent un appel aux armes pour châtier ceux qu'on appelait des malfaiteurs. Des volontaires, venus de tous côtés, se serrent en bataillons pour aller faire la chasse aux Indiens, comme dans nos vieux pays d'Europe les braconniers s'assemblent en partie de fête pour faire la chasse aux loups, quand leur effronterie les pousse jusqu'à venir enlever les moutons dans les bergeries. Dans cette mémorable campagne, chaque volontaire s'érigeant en défenseur de la propriété, a pu faire largement l'épreuve de son rifle ou de ses revolvers sur de pauvres êtres humains qui n'avaient, pour se défendre, qu'un arc, des flèches, une lance et une massue; toutes armes inutiles contre des ennemis qui les tuaient à cinq cents [500] mètres de distance, quand leurs flèches a eux n'atteignaient pas à cinquante. Les Indiens ne purent tenir devant cette légion de braves. Ils furent massacrés. Cependant on en conserva quelques centaines comme trophée de victoire. Les triomphateurs choisirent, parmi ces prisonniers de guerre, de jeunes filles, de jeunes garçons, dont ils firent leur propriété, par droit de conquête. Ils ramenèrent de leur expédition un troupeau humain où les femmes, les enfants et les vieillards étaient en plus grand nombre, les jeunes hommes ayant préféré la mort en combattant, à l'humiliation de se rendre à leurs cruels ennemis. Les vainqueurs conduisirent ces sauvages sous leur escorte armée, pour les montrera triomphalement dans les centres déjà conquis à la jeune civilisation. Ils étaient liés deux à deux avec de la corde; des tambours battaient la marche en tête de la colonne. C'est ainsi que je les vis traverser les principales rues de San-Francisco. L'exhibition terminée, on alla les parquer sur le bord de la mer, à la baie du Nord, à l'entrée du goulet. Des cordes attachées à des pieux formaient une enceinte en demi-cercle, gardée par des hommes armés. De l'autre côté du cercle, la mer opposait sa barrière aux captifs. Quand les femmes et les enfants, couchés sur les sables de la grève, se reposaient des fatigues de leurs marches forcées, on prenait les plus valides des hommes, ceux aux allures les plus viriles, pour les conduire en spectacle au milieu des rues populeuses, par groupe et à tour de rôle. Je dois dire que, dans toutes ces foules qui se pressaient autour d'un spectacle si étrange, après l'entraînement delà cu- riosité passé, un sentiment d'humanité et de confusion, je dirai presque de honte, semblait serrer les âmes.
Une coquille nacrée, on forme de limaçon, mince et allongée, traversait la cloison des narines et venait former sur la lèvre supérieure une sorte de moustache ressortant avec originalité sur cette face bronzée. Une peau d'ours noir enveloppait son torse. Il marchait appuyé sur un bâton, dans une attitude dénonçant la souffrance. Il répondait par des attentions toutes paternelles à la vénération que semblaient avoir pour lui surtout les femmes et les enfants. Il commandait les guerriers qui avaient soutenu l'attaque des blancs, pendant que son frère, chef de la tribu, protégeait vers le désert la retraite de ceux qui avaient échappé à la surprise de leurs ennemis. Les malheureux restèrent ainsi trois jours sur la place, exposés aux regards d'une foule curieuse; puis on les déporta dans les réservations. Les réservations ou réserves sont des points éloignés des centres de colonisation, que la nature a rendus faciles à garder par des postes militaires espacés à de courtes distances, et où les Américains parquent les indigènes qui sont turbulents ou hostiles, et qui n'en peuvent sortir sans s'exposer à tomber sous la balle des sentinelles. Le gouvernement de l'Union semble bien assurer à ces mal- heureux des moyens d'existence et des vêtements contre le froid, comme il ferait à des prisonniers déportés, ou comme on donnerait une indemnité viagère à celui dont on possède les biens. Mais les rares distributions ou l'insuffisance de ces subsides font que ces pauvres êtres humains, privés de la liberté d'aller demander à la nature une existence plus libérale que celle qu'on leur donne, s'éteignent rapidement dans la misère et la dégradation les plus profondes. C'est souvent ce manque aux engagements qu'on a pris envers eux, et les mauvais traitements auxquels ils sont en butte qui les poussent à la révolte; et ils vont par bandes plus ou moins nombreuses porter le meurtre et l'incendie dans les habitations dispersées des colons. C'est alors qu'interviennent les soldats de l'Union. Et ces guerres de montagnes et de broussailles, qui détruisent dans les deux camps de grandes quantités d'hommes, ne cessent sur un point du territoire que pour recommencer sur un autre.
Il paraît qu'à la faveur de la nuit ils avaient trompé la vigilance de leurs gardiens et avaient repris la vie de liberté et d'indépendance à laquelle ils semblaient ne devoir plus jamais retourner. On s'en préoccupa peu; on ne les rechercha point, car c'eût été peine inutile. D'ailleurs, le sentiment général, après un pareil triomphe des vainqueurs, était que tous ces malheureux auraient bien du en faire autant. Mais que peuvent des vieillards, des femmes et des enfants contre l'oppression et la brutalité de la force?
pèrent les premiers le pays. Ces braves gens avaient quelques troupeaux qui leur donnaient du lait, des fromages et des veaux, qui, avec de la volaille et le gabier, leur faisaient entretenir avec la ville quelques relations de commerce. J'avais, un jour, dans mes promenades a cheval, au milieu de cette nature sauvage et luxuriante dont les hommes n'avaient pas encore altéré l'aspect primitif, découvert cette petite colonie, comme on découvre une oasis dans le désert. De jeunes chevaux paissaient dans de hauts pâturages. Don Louis, c'était le nom du chef de la modeste ferme, avait pour ses élèves des soins tout paternels. Aussi, je lui laissai en sevrage un petit rejeton né d'une jument de race anglaise, importée d'Australie, que je montais dans cette promenade, que je faisais pour voir folâtrer mon poulain au milieu des herbages. Don Louis et moi étions devenus de véritables amis. Aussi, j'allais parfois, dans mes moments de loisir, visiter mon pensionnaire, à qui la vie des prairies convenait beaucoup mieux que la solitude de rétable. Un jour que je faisais a la vallée ma promenade habituelle, don Louis me dit:
Il me conduisit a sa case, où, au milieu d'un groupe d'Indiens et de métis, je crus reconnaître le personnage qui avait fixé mon attention, quelques semaines auparavant, au milieu des prisonniers indiens amenés à San-Francisco. C'était le malade que me présentait don Louis. Il comprenait et parlait fort bien la langue de Certes.
Et je fixais toujours mon homme, m'attachant surtout à reconnaître qu'il avait un trou à la cloison des narines, ce qui est une marque de distinction réservée aux seuls dignitaires des tribus. Il avait quitte son simple costume de la vie libre, et était accoutré de vieux vêtements européens. Il n'avait aucun ornement sur la tête: plus de dents de tigre aux oreilles; plus de coquille au nez; plus de bandeau de plumes sur le front; c'était un souverain déchu et devenu bercer. Je n'insistai pas à le reconnaître.
Et il me découvrit sa cuisse gauche. Elle était démesurément tuméfiée; une sanie purulente sortait d'une petite ouverture.
L'Indien, embarrassé, ne savait que répondre.
Et il lui montrait la région d'où il était venu. Pepo détourna la tête pour cacher de grosses larmes qui roulaient dans ses yeux; puis, se remettant de son émotion profonde, il me tendit la main.
Et cet homme, dont l'àge et le malheur avaient ridé profondément le front, me prit convulsivement la main qu'il pressa sur ses lèvres, en pleurant comme un enfant.
Il avait refait son armure, à laquelle il avait ajouté un grand couteau-poignard que lui avait donné Don Louis, et dont il se servait, avec beaucoup d'avantage et d'adresse, pour confectionner son arc, ses flèches, son casse-tête. Tout était prêt; il aimait à y travailler devant moi, quand j'allais rendre ma visite au modeste rancho (ferme des Indiens). Un jour, j'arrivai plus tôt que d'habitude. J'étais parti de grand matin pour voir, du sommet des montag'nes, un des spectacles les plus grandioses qu'il soit donné à l'homme de contempler. C'est d'attendre la sortie de ce vaste Océan qu'agitent rarement les tempêtes, le soleil quand il vient, par ses premiers rayons, condenser les épais brouillards qui baignent les forets et que la brise chasse en rivières de feu dans le fond des vallées. Je surpris Pepo dans une partie retirée de la cabane, occupé à un travail qui absorbait toute son attention. Il broyait des herbes sur une pierre de granit dont les indigènes se servent pour réduire en farine les grains de mais ou les glands doux, dont ils font leur nourriture principale. Une odeur pénétrante me saisit à la gorge, en serrant ma poitrine.
Je pris quelques-unes des plantes qu'il écrasait ainsi. C'étaient des jeunes tiges d'un laurier qui croît abondamment dans ces contrées. Il a les dimensions et le port majestueux d'un grand chêne. Quand le soleil plonge ses rayons au milieu de son épaisse verdure, aussi dangereux que le mancenillier, il frappe de vertige le voyageur confiant qui vient chercher la fraîcheur et le repos sous son ombrage.
Et Pepo, souriant avec malice, me répondait:
Plus je mettais d'insistance à le dissuader d'employer cette substance pour sa jambe, plus il souriait. Et sortant tout à coup de la discrétion qu'il aurait voulu garder auprès de moi, en me montrant ce qu'il faisait, il me dit, d'un ton qui ressemblait presqu'à de la colère:
Dans les herbes qu'il désignait comme devant tuer le cœur, je reconnus le tabac indigène, qui croît en abondance dans les vallées ombragées de grands arbres. Et celle qu'il disait devoir tuer les jambes était une sorte de clématite ou liane que les Américains appellent oak poison (poison du chêne), parce qu'elle croît abondamment au pied de ces arbres et tresse dins leurs branches épaisses ses rameaux longs et flexibles, comme toutes les plantes de cette famille grimpante. Les indigènes l'appellent hyedra (hydre, serpent). Sa puissance vénéneuse est si grande qu'elle agit même à distance sur ceux qui sont plus susceptibles d'en ressentir l'influence. Leur face et certaines parties du corps les plus cachées se boursouflent, comme si elles étaient atteintes d'érysipèle vésiculeux ou de petite vérole.
Pepo, tant était grande sa reconnaissance pour les soins que je lui avais donnés, n'avait plus rien à me cacher. Quand il eut fini d'écraser sur la pierre les tiges tendres de son laurier, il mêla bien ensemble les trois lots de ses plantes toutes baignées dans leurs sucs. Il avait préparé à l'avance, avec des branches de saule adroitement tressées, une sorte de panier, rond comme un petit tonneau à un seul fond, d'une capacité de quarante litres environ. Ce panier était fixé sur une planche qui lui servait de socle ou de support. Une rainure profonde, taillée au couteau dans cette planche, en encadrait les bords et venait se termi- ner, à un des angles, en forme de gouttière ou de déversoir. Pepo posa dans ce panier toutes ces herbes, qu'il prenait soin de ne pas toucher à la main, et qu'il remuait avec deux petites fourches de bois. Il paraissait également éviter de respirer un air qui avait passé sur elles. Comme diraient les marins, il se tenait au vent de sa besogne. Avec la tête de sa massue, il tassa alors vigoureusement, comme avec un pilon dans un mortier, cette pulpe végétale dont le jus découlait au travers du panier et ruisselait dans les gouttières de la planche, d'où il tombait dans une calebasse en forme de plat. Quand le tassement avec la massue eut fait sortir de cette masse humide les premiers sucs, l'Indien chargea les herbes avec de grosses pierres et laissa s'écouler lentement le reste du liquide que pouvait encore en extraire cette forte pression. Après quelques heures de ce travail, il avait obtenu de ses plantes près d'un litre de liquide vert brun, épais et visqueux, qu'il appela la MÈRE DU POISON. Il répartit ensuite cette matière, d'odeur nauséabonde et vireuse, dans un grand nombre de coquilles d'une grosse moule nacrée, abondante sur la côte, et les exposa à l'action d'un vent frais, en plein air et à l'ombre. C'était la partie la plus délicate de l'opération. La mère devait rester au moins pendant huit jours dans ces coquilles, où elle se desséchait graduellement, en la préservant bien de l'humidité des brouillards et de la nuit. Une fois desséchée, on recueillait dans chaque coquille, comme dans une cornue qu'on aurait chauffee au feu pour la distillation, une pâte de consistance gommeuse, très adhérente, qui était le Veneno, le Poison, le CURARE. A ma visite suivante, Pepo me montra, avec un sentiment de satisfaction et d'orgueil, comme un homme qui a réussi dans une entreprise difficile, une boule grosse comme un petit œuf, qu'il tenait renfermée entre les deux valves d'une coquille. C'était tout ce qu'il avait extrait de Veneno de l'opération à laquelle j'avais assisté la semaine avant.
Pepo se mit à rire avec toute sa bonhomie. Il répétait malicieusement: Curàré! . . . curàré! . . . en accentuant fortement l'expression, et me faisant comprendre que je ne prononçais pas bien le mot, espagnol: Curàré et non curare, qui veut dire soigner, guérir, cuve, remède. Quand ils appliquent ce mot de guérir à l'action du poison, ils veulent dire, par antiphrase: Tuer. Pepo me donna alors l'explication de l'origine du mot curare, que j'étais bien loin de connaître, comme il s'en aperçut. Cette explication, la voici: Quand les Espagnols envahirent l'Amérique, les Indiens n'avaient d'autre moyen à leur opposer pour se débarrasser d'eux, que l'empoisonnement. La haine des PEAUX-ROUGES pour leurs envahisseurs était si profonde, leur besoin de vengeance si vivant, que la première parole qu'ils apprenaient à leurs enfants à prononcer était le mot petun (tabac, poison [curàré]). La première pensée que concevait leur raison était la mort contre les étrangers. C'était dans les maladies surtout qu'ils avaient le plus d'occasion de les approcher, comme devant connaître mieux qu'eux les affections du pays et les remèdes pour les traiter Alors, sous prétexte de les soigner et de les guérir, on les empoisonnait. De là vint l'usage de l'expression curâé, parmi les Indiens, quand ils voulaient dire empoisonner, tuer. Chez les sauvages, comme parmi les civilisés, même de notre temps, les bonnes femmes ont toujours eu des secrets pour guérir. Aussi c'était elles qui étaient chargées d'administrer le curâré, ou la cure, à tous les malades,—qui succombaient naturellement en leurs mains. Et la mort, effectuée par la vieille empoisonneuse, ne manquait pas d'être mise par elle sur le compte du Vomito negro, de la Fièvre jaune, des Coups de soleil et tant d'autres maladies qui paraissaient décimer les blancs dans ces nouvelles contrées; tandis que c'était le curâré ou la panacée indienne qui les expédiait dans une autre vie. Plus tard, quand les Européens s'aperçurent que les indigènes, au lieu de les guérir avec leur prétendue panacée, les tuaient, ils conservèrent le mot curâré, qu'ils prononcèrent curare sans accents, pour désigner le poison des Indiens. C'est là l'origine très vraisemblable du mot curâré, telle qu'elle m'a été judicieusement développée par Pepo. Les mêmes explications établissent aussi comment un affreux poison, le petun ou tabac, qui est un des éléments les plus actifs du curare, avait envahi l'Europe, sous le titre pompeux de panacée des Indiens. C'était sous sa forme végétale et naturelle que les Indiens l'employaient dans leur médication meurtrière des blancs. Pour toutes leurs maladies, de quelque nature qu'elles fussent, c'était toujours le tabac employé par toutes les voies et sous toutes les formes, pour arriver plus sûrement à les faire périr. Voilà pourtant l'origine de cette fameuse panacée universelle, qui révolutionna plusieurs siècles! Quelle mystification pour nous, Européens! Plus primitifs dans nos croyances médicales que les sauvages d'Amérique, nous acceptâmes des Caraïbes, des Peaux-Rouges, comme devant prévenir et guérir tous nos maux, et nous idolâtrons encore aujourd'hui une herbe qui n'a jamais été, entre leurs mains, qu'un agent de destruction contre nous; en qui toute notre science n'a jamais pu découvrir une vertu curative; mais où, par contraire, et depuis un quart de siècle seulement, elle a trouvé, tout étonnée, le plus perfide des poisons.
Ainsi donc Curare, Petun, Panacée, Tabac ne doivent plus être considérés aujourd'hui que comme exprimant une même chose, menant au même résultat: La mort violente par intoxication.
Depuis l'occupation des Américains, le gros gibier avait abandonné ces parages, où il ne trouvait plus assez de solitude. Mais des bandes sans fin d'oiseaux de mer, et surtout des pélicans, aussi grands que des cygnes, traversaient à chaque instant la presqu'île qui sépare la baie de la pleine mer. Pepo, embusqué dans les rochers, à mi-côte de la montagne, leur lançait au passage, et à de grandes distances, ses flèches empoisonnées; et ils tombaient comme foudroyés, au milieu des herbes du vallon où nous courions les ramasser. Sept ou huit de ces énormes oiseaux étaient là, dans un monceau, roidis comme si des barres de fer avaient instantanément remplacé leurs os. Pepo trouva bientôt moyen d'utiliser un si large butin. Il les réserva pour en prendre les peaux, qu'il voulut emporter à sa tribu, en souvenir de sa captivité et de son voyage au pays des Bostoniens.
Pepo, malgré le succès de sa chasse, ne paraissait pas content; il trouvait qu'il n'y avait aucun mérite pour lui d'abattre ces gros oiseaux, dont le vol aussi lourd que paresseux permettrait presque de les atteindre avec des pierres. Il aurait voulu, pour montrer son adresse, frapper à la course un chevreuil, un lièvre, un lapin; mais il aurait fallu chercher longtemps avant d'en trouver.
La mer était à trois milles de la petite ferme. Don Louis envoya quatre Indiens à cheval faisant la battue dans les bois, pour rejeter les bêtes, s'il s'en trouvait quelques-unes, dans le vallon où nous nous promenions lentement. Au grand désespoir de Pepo, qui avait toujours l'œil au guet et l'arc à la main, rien ne traversait la vallée. Nous arrivâmes ainsi, tout en cheminant, vers la grève. La mer était tranquille, des oiseaux de toutes variétés cherchaient près des côtes, à la marée descendante, leur nourriture de tous les jours. Des phoques, qui les chassaient, montraient de temps en temps, au milieu d'eux, comme autant de têtes d'hommes, leurs larges fronts et leurs gros yeux. Sur des roches peu avancées dans l'eau grouillaient ces animaux difformes, ressemblant par la bigarure de leurs couleurs et la grosseur de leur corps à des troupeaux de porcs, étendus les uns près des autres, tant ils étaient nombreux. Pepo, qui n'avait jamais habité la côte, ne connaissait pas ces amphibies, moitié bête, moitié poisson, qu'on appelle veaux marins, et il semblait curieux de les voir de plus près. Aussi, à toute portée de son arc, il décocha vigoureusement sur eux plusieurs de ses flèches, au moment où ils paraissaient hors de l'eau. La bête plongeait et ne se montrait plus. Pepo désespérait de la valeur de ses flèches contre ces monstres de la mer, quand la vague en rejeta à la côte, sans vie, trois énormes, sur cinq ou six qu'il avait tirés. Don Louis, de son côté, avec son rifle, leur envoyait des balles. Le monstre emportait le plomb et ne revenait plus. Et Pepo, content de la supériorité de son tir, disait en souriant:
Et, pendant que mes deux Indiens plaisantaient, moi, je faisais des réflexions sérieuses sur cette puissance d'un poison, ayant pour base le tabac, qui tuait, par une simple piqûre, ces êtres dont l'organisation animale était si inférieure que les balles qui les traversaient ne semblaient leur porter aucune atteinte. Après ce petit amusement, dont les phoques du rivage avaient fait tous les frais, nous reprîmes le chemin de la ferme. Pepo, que nos compliments sur son adresse avaient beaucoup flatté, voulut nous donner des preuves plus méritantes de la précision de son coup d'œil et de la puissance de ses flèches, en prenant pour but de son tir des points de mire plus mobiles et moins volumineux que les pélicans et les phoques. Il braconna, chemin faisant, les petites perdrix du pays, le colin à gorge noire et à aigrette sur la tête, qu'il tirait au passage, dans leur vol saccadé et rapide. En chasseur pré- voyant, il préparait ainsi de quoi faire la collation au retour.
La théorie de Pepo sur la vie et sur l'action des poisons sur l'organisme m'amusait beaucoup. Les idées de Popo, en matière si abstraite, me parurent si originales que je voulus chercher à sonder un pou toutes ses croyances. Je le questionnai sur leur ancien usage de manger leurs ennemis, ce qui leur arrive parfois encore, malgré les quelques pas qu'ils auraient dû faire dans la civilisation.
Pepo avait dans sa jeunesse reçu l'instruction que les missionnaires espagnols étaient venus apporter à ces idolâtres pour les convertir au christianisme. Il se rappelait le mystère de l'Eucharistie, par lequel on lui disait qu'il nourrirait son âme des qualités divines, s'il recevait en lui le corps du Dieu fait homme incarné dans la sainte hostie. Et il ajoutait:
Il y avait dans le calme de sa physionomie quelque chose de prophétique et d'inspiré quand, avec cette imagination ardente des êtres primitifs, il comparait à deux serpents dont les replis enlacent le monde, ces deux poisons: la nicotine du tabac et l'alcool du maïs, partis de l'Amérique pour venger le Nouveau-Monde des cent cinquante [150] millions d'hommes qui y vivaient paisiblement avant qu'on les eût connus, et que les Européens y ont presque détruits, depuis que Christophe Colomb leur a montré les routes de ces vastes contrées. Pepo partit à la recherche des débris de sa tribu, dispersée dans des solitudes qu'il n'avait jamais connues, et dont le séparait une distance de plus de dix jours de marche. Gomment aura-t-il traversé ce pays occupé ça et là par des groupes de colons, toujours sur le qui-vive, toujours prêts à faire la chasse à l'Indien? Il avait tout ce qu'il lui fallait pour mener à bonne fin une semblable entreprise: la force physique, le courage moral et la confiance qu'il puisait dans son armure bien complète et dans la qualité supérieure de son poison, dont il s'était largement approvisionné. Don Louis n'en entendit plus jamais parler. Et, en 1871, quand je retournai en Californie, après une absence de huit ans, un de mes premiers besoins fut d'aller visiter la vallée des Indiens. A la place de la pauvre chaumière, à moitié cachée dans les chênes, s'élevait une maison de bois coquettement peinte en blanc, avec toutes les dépendances et le matériel d'une grande vacherie. J'y demandai Don Louis, le patron du rancho des Indiens qui avait existé là : on ne le connaissait pas. J'ai pensé que le pauvre métis avait eu le même sort que tous les indigènes. Son droit d'occupant aura été primé par le droit du plus fort. Contraint d'abandonner cette terre qu'il avait fécondée par son travail, il aura été chercher, en des contrées lointaines, quelques ravins cachés à la convoitise des settlers (colons), où lui et ses troupeaux auront trouvé une existence précaire. Ils y attendront le jour où le flot montant de ce qu'on appelle là-bas la civilisation, viendra les refouler encore, jusqu'à extinction de la petite colonie indienne dont il s'était fait le patriarche et le mentor, sans que sa qualité de métis, qui aurait dû servir de trait d'union et de conciliation entre les deux races d'Amérique et d'Europe, ait pu le protéger contre la cupidité et l'injustice des envahisseurs. LES GOUVERNEMENTS CHERCHENT A ARRÊTER
Les propriétés vénéneuses du tabac, si incontestables aujourd'hui, avaient été constatées, à différentes époques, après son introduction dans les habitudes européennes, par les gouvernants plus préoccupés de la santé de leurs sujets que de faire argent de leur ignorance et de leurs vices par des impôts fantaisistes. Quand les charlatans et les spéculateurs sur la crédulité publique, d'un côté, les philanthropes et les savants, d'un autre, étaient aux prises, dans leurs discussions et leurs pamphlets, pour savoir si le tabac était salutaire ou pernicieux, Jacques 1er, roi d'Angleterre [1603-1625], voulut, par lui-même, éclaircir une question qui avait tant d'importance, non seulement pour son royaume, mais encore pour l'humanité entière. Il fit, lui aussi, son livre sur le tabac (1). Sa position de monarque et d'arbitre entre des opinions si opposées, car il s'agissait de savoir si le tabac guérissait ou tuait, devait assurer l'impartialité de sa sentence, au milieu de tant de controverses et d'arguments superstitieux ou subtils. Ses conclusions motivées furent:
(1) La Réfutation du Tabac, prouvant que le tabac est une cause de cachexie (Scurvy). Londres, 1672, par Jacques 1er, roi d'Angleterre.
et il en proscrivit l'usage parmi ses sujets, par des lois très sévères. En 1624, le pape Urbain Vincent [1623-1644] frappait des peines corporelles et d'excommunication ceux qui useraient de cette substance, aussi dégradante pour l'âme que pernicieuse pour le corps. La reine Elisabeth défendit d'en user dans les églises, et autorisa les bedeaux à confisquer les tabatières à leur profit. A l'exemple de ces souverains, les gouvernements d'Europe frappèrent de proscription, dans leurs États respectifs, la panacée universelle des Indes, qui ne guérissait rien, et qui engendrait, au contraire, beaucoup de maux. Il n'y a pas jusqu'aux souverains de la Perse et de la Turquie qui menacèrent de leur couper le nez d'abord et de la peine de mort pour récidive, ceux qui faisaient usage de cette drogue dangereuse, surtout pour les peuples d'Orient, a organisation nerveuse et des plus impressionnables à l'action des poisons végétaux. Christian IV, roi de Danemark [1588-1648], condamnait les consommateurs de tabac à des amendes pécuniaires et à la peine du fouet; correction qu'il jugeait en rapport avec les peccadilles de ces grands enfants, qui s'appellent des hommes, et qui dissipent leur temps à jouer à la fumée d'une herbe malsaine, comme les enfants jouent aux bulles de savon qu'ils soufflent en l'air. En 1689, dans la Transylvanie, une ordonnance menaça de la perte de leurs biens ceux qui planteraient du tabac, et frappa d'une amende de trois florins jusqu'à deux cents, ceux qui consommeraient cette plante pernicieuse. Le gouvernement français n'a pas toujours poussé à la consommation lucrative du tabac. Quelques années après la mort de Catherine de Médicis, dont le funeste patronage avait fanatisé la France pour l'herbe à guérir tous les maux, le premier acte de notre législation sur le tabac fut un décret de 1600 [Henri IV], qui en interdisait l'usage comme pernicieux. Mais que pouvait faire ce décret de prohibition contre des croyances au merveilleux que la superstition avait si profondé- ment enracinées dans l'esprit des masses ignorantes et fanatiques de ces temps-là? Il n'eut pas plus d'effet que les foudres de l'Eglise tonnant, à cette époque, contre les sorciers, les devins, les magiciens et ceux qui les consultent. Aussi fallut-il recourir à la pénalité. Une ordonnance de la police de Paris, en date du 30 mars 1635, disait:
Ils ont au contraire protégé, sous les mesures les plus exceptionnelles, un agent de démoralisation et de dégradation physique, après que les révélations du temps, les conseils de l'expérience, les analyses de la science leur disaient:
LE TABAC JUGÉ PAR LA SCIENCE EST MEURTRIER. Nous avons exposé succinctement tout ce que le temps, l'expérience et la tradition nous ont appris sur le tabac; revenons à ce que nous en dit la science, qui doit être le juge en dernier ressort dans cette cause si longtemps débattue. Nous extrayons les détails suants des études médico-légales sur l'empoisonnement, par le docteur Tardieu, professeur de médecine légale à la Faculté de Paris:
Dans le Dictionnaire des Sciences naturelles, 1825, article Tabac, on lit:
En décembre 1813, la Bibliothèque britannique publia un travail des docteurs Wilson, Brodie et Emmest, où ils placent au nombre des poisons végétaux l'huile empyreumatique que l'on retire par la distillation des feuilles de tabac.
Quand la science attestait de toutes parts les propriétés délétères de l'herbe de la Régie, quelques médecins attachés à des manufactures de tabac, dans un mouvement de zèle, sans doute, émirent, dans des rapports à leurs chefs de service, l'opinion que la fabrication du tabac, loin d'être nuisible à la poitrine, comme on pouvait le croire et comme on l'en a accusée, serait, au contraire, tout à fait inoffensive, et même, jusque un certain point, favorable aux poitrines faibles. L'un d'eux allait même jusqu'à penser que le travail de cette fabrication est capable d'arrêter le développement de la phthisie chez les personnes qui y sont disposées; et, qui plus est, de la guérir quand elle existe. C'était ramener les beaux jours de la panacée tant discréditée de la bonne reine Catherine, que l'administration se reprochait peut-être de répandre avec tant de profusion au milieu de ses consommateurs fidèles et crédules. Aussi la Régie sai- sit-elle l'occasion de communiquer à l'Académie la bonne nouvelle de la découverte faite dans ses ateliers. Le tabac guérit la phthisie! . . . Quel succès, si c'était vrai! Tout le monde allait en consommer pour se préserver d'une fin si terrible. La phthisie . . . , la plus meurtrière, la plus incurable de toutes les maladies, guérie par le tabac! . . . Mais c'était la revanche la plus éclatante, la plus glorieuse que l'on pouvait faire prendre à l'herbe de Nicot contre tous ces sceptiques, tous ces détracteurs qui s'entendent pour lui trouver toutes sortes de vices! . . . Aussi, le 2 mai 1843, une lettre ministérielle invitait l'Académie à s'occuper du tabac sous le rapport, entre autres, de ses propriétés curatives de la phthisie. L'Académie ne fut point dupe de cette démarche de la Régie. Elle lui fit l'effet de tous les propriétaires de remèdes patentés qui s'adressent à elle pour avoir un avis favorable sur les qualités de la drogue qu'ils présentent au public, dont il leur est ainsi plus facile d'obtenir la confiance et l'argent. La question, d'ailleurs, intéressait à un trop haut point la santé publique et la considération de l'Académie elle-même, mise en demeure de la juger, pour que ses honorables membres se sentissent disposés à la complaisance ou à la faiblesse en faveur du Gouvernement, se faisant l'avocat de la cause du tabac. L'Académie donna à la question plus d'étendue que ne s'était proposé le ministre. Elle étudia en entier la manutention du tabac. Le docteur Mélier, dans un travail remarquable de vérité et de franchise, exposa toutes les impressions qu'il avait recueillies, pendant près de deux ans d'observations consciencieuses et suivies, à la manufacture du Gros-Caillou, à Paris. Et, loin de pouvoir constater des effets salutaires en faveur du tabac, il n'y rencontra que des affections et des dangers. Et les conclusions de son rapport engagent le Gouvernement à protéger la santé des travailleurs, qui est compromise et qui souffre dans cette industrie malsaine. Nous avons cherché partout si ce rapport, qui jetait un grand jour sur un sujet si important à la santé et à la moralité publiques, avait été publié par le Gouvernement qui l'avait provoqué, inconsidérément peut-être. Nous n'en avons trouvé aucune trace dans les organes officiels, que lit tout le pays, qui était pourtant bien intéressé à le connaître. L'administration de la Régie eût été moins discrète, sans doute, si le rapport de l'Académie avait confirmé ses espérances dans les vertus curatives de la plante qui fait l'objet de ses spéculations autant politiques que mercantiles. Que le tabac guérisse ou qu'il tue, le public est aussi intéressé d'un côté comme de l'autre à le connaître. Aussi nous allons reproduire ici les passages de ce travail, qui résument l'opinion des juges les plus compétents sur la matière, et qu'il importe aux clients de la Régie de bien méditer.
(1) On pourrait rapprocher de ces faits le dépérissement rapide et la mortalité sans pareille des arbres dans les quartiers des grandes villes les plus fréquentés par les fumeurs. Les Tuileries perdent tous les jours leurs beaux marronniers, depuis qu'on y fume; et l'administra-tion lutte sans succès pour le reboisement des boulevards ou des places publiques, surtout dans le voisinage des cafés. Car là règne, sans discontinuer, une atmosphère de fumée de tabac qui tue la végétation, comme le ferait le voisinage des fours à chaux, par exemple, par l'acide carbonique qui s'en dégage. Ce sont surtout les marronniers et les tilleuls qui souffrent le plus de cet empoisonnement chronique. A peine leurs feuilles sont-elles épanouies, au printemps, qu'on les voit jaunir et tomber au moindre souffle des brises de juillet. En août et septembre, ils sont tout chauves, comme au milieu de l'hiver, dans un état de mort apparente qui contraste bien tristement avec la verdure fraîche et luxuriante des arbres qui vivent loin de nous, dans les bois, où notre civilisation ne gâte pas leur atmosphère. A Dublin, à Edimbourg, à Londres, ces trois capitales du royaume
uni d'Angleterre, il est défendu de fumer dans presque tous les parcs, dans l'intérêt de la conservation des arbres, bien plus que par convenance et bon ton. Je visitais un jour le beau jardin botanique de Kew, près de Londres. Dans des serres, qui sont de véritables palais de cristal, se trouvent de riches collections de plantes exotiques. A toutes les portes de ces serres, sur toutes les murailles, on lit en gros caractères: — Pourquoi cette mesure si sévère? demandai-je au conservateur de ces serres. — Si l'on fumait ici, monsieur, toutes nos plantes périraient bien vite. Avec la chaleur et l'humidité qui régnent dans les serres, l'absorption des végétaux est très active, et la fumée de tabac, pénétrant leurs feuilles et leurs tiges, les tuerait en peu de jours. Quel enseignement pour les fumeurs, dans ces précautions que prennent des jardiniers pour empêcher le poison du tabac de flétrir la fraîcheur de leurs plantes, de les faire périr même! Eux, ils s'inquiètent peu de saturer des émanations de leurs pipes l'air des appartements où respirent de jeunes enfants dont l'organisme doit souffrir, tout au moins comme des plantes, de l'absorption de vapeurs si malsaines.
Le docteur Mélier, dans tout son rapport, n'est pas toujours si pessimiste et si rigoureux contre le tabac que nous l'avons fait ressortir. A côté des effets délétères de la panacée des Indes, il pose comme compensation, et pour lui conserver les faveurs qu'elle mérite, ses propriétés curatives de la gale.
Cela ne doit pas paraître étonnant; car comment l'acarus de la gale, ce parasite miscroscopique qui vit sous notre épiderme, qu'un peu de graisse et de soufre fait périr, pourrait-il vivre et se reproduire dans un milieu où périssent les plantes, et où l'homme a tant de peine à ne pas succomber?
Dans la discussion de ce rapport, quant à la coloration qu'on remarque chez les travailleurs du tabac, M. Gérardin l'a comparée à celle qui résulte des altérations des organes digestifs. M. Londe demande à ce qu'il soit ajouté aux conclusions du rapport:
M. Desportes dit:
Trouver un contre-poison du tabac! . . . Pouvait-on dire à la Régie, d'une manière plus adroite et plus convenante que l'a fait M. Desportes, qu'elle devait s'abstenir de ce commerce qui fait que, sous sa protection paternelle, des milliers d'ouvriers s'empoisonnent pour fabriquer le poison de tous les jours qu'elle débite à la nation? Car la première condition de ne pas avoir besoin de contre-poison, c'est de ne pas s'empoisonner soi-même. Et le contre-poison du tabac n'aura été trouvé qu'au jour où les hommes, confus de leurs faiblesses, auront répudié ces vieux enfantillages que nous ont légués les siècles de superstition et d'ignorance; au jour où ils renonceront à singer, avec une pipe et du tabac, reliques de la sorcellerie et de la magie, les sauvages que découvrirent Christophe Colomb et Cortès; au jour où une administration ayant plus à cœur la conservation publique que ses recettes budgétaires, fera écrire sur tous les paquets de tabac que voudront consommer les passionnés et les crédules, ce mot révélé par la science: POISON! . . . . . . mot que l'on oblige les pharmaciens et les droguistes, sous peine d'amende, à mettre en grosses lettres sur toute enveloppe contenant une substance toxique, qu'elle s'appelle belladone, datura, aconit, opium, arsenic, nicotine ou tabac. Mais, va objecter la Régie, si vous dites au peuple que le tabac est un poison, il n'en consommera plus, et nous n'aurons plus les beaux millions que nous apporte, par centaines, le doux passe-temps de regarder monter en l'air de la fumée, en crachant ses pituites et ses strumes, comme au bon temps où l'herbe a la reine guérissait tous les maux. L'objection est majeure. Mais, il m'en souvient, cette objection d'intérêt fiscal était la même, au temps où les hommes sensés s'émurent de tous les désordres causes dans la société par une institution immorale: La loterie, qui ruinait, au bénéfice de l'État, des milliers de familles; engendrait la folie, par spéculation manquée; poussait au suicide, par désespoir et par honte. Cette séduisante sirène aux yeux d'or étalait alors, comme une tentation à la faiblesse du peuple, ses numéros gagnants, dans les mêmes boutiques où s'étale aujourd'hui, dans le même but de séduction, le tabac, sous toutes ses formes. La loterie, qui faisait quelques riches et infiniment de pauvres, a bien disparu de nos mœurs dès que l'État ne l'a plus patronnée et exploitée. Pourquoi le tabac ne disparaîtrait-il pas ainsi? Il ne fait jamais de riches, lui, parmi ceux qui en usent; il ne fait que des pauvres, qui se privent souvent de pain pour l'acheter: car tout poison qui engourdit la vie, calme la faim au détriment des énergies du corps. Il répand dans l'humanité une grande partie des misères qui l'affligent aujourd'hui.
Dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale., année 1847, tome XXXVIII, on trouve un extrait du London médical Gazette, tome III, 1846. M. Guérard y traduit ainsi un article de M. le docteur Wright sur l'action physiologique du tabac:
organes des sens et ceux de la reproduction et de la digestion. Je crois avoir reconnu qu'il produit l'atonie et toutes les conséquences qui en dérivent.
Le 10 février 1851, le docteur Ed. Robin présentait à l'Académie des sciences la Note suivante:
La communication de M. Robin est accompagnée d'un petit flacon contenant un morceau de chair conservé par ce procédé depuis quatre mois. Après l'empoisonnement de [Gustave] Fournies par [Hippolyte Visart, comte de] Bocarmé, à l'aide de la nicotine, qui fit tant de bruit dans le monde, par la nou- veauté du poison employé pour ce crime (voyez page 79), M. [Matthieu J. B.] Orfila [1787-1853], professeur de médecine légale à la Faculté de Paris, répéta les recherches qui avaient été faites par le professeur Stas, de Bruxelles. Comme lui, il a extrait la nicotine du tabac: il a fait toutes les expériences foudroyantes par lesquelles cet alcali vég'étal révélait ses propriétés toxiques. L'illustre chimiste, à la séance de l'Académie du 24 juin 1851, communiqua des observations tendant à démontrer toutes les propriétés toxiques du tabac. Devant cette énumération de propriétés vénéneuses et formidables, qu'on était loin de soupçonner dans la plante qui fait les délices de tant d'ignorants abusés, M. [Pierre M.] Roux, prévoyant que les individus qui font usage du tabac absorbent une quantité de nicotine assez grande pour que leurs organes en soient à la longne imprégnés et que l'économie puisse, en être affectée, saisit cette occasion pour faire une piquante sortie contre le tabac, et pour demander que l'Académie s'emparât de cette question, à laquelle l'avenir de la civilisation, dit-il, est intéressé. Il insista sur sa proposition, sur laquelle l'Académie crut devoir passer outre. Rendons hommage au digne professeur Roux, qui a si bien compris, dans cette circonstance, son devoir d'académicien et de philanthrope. Ses observations judicieuses honorent son caractère indépendant.
Devant une question d'un grand intérêt d'hygiène publique, où il s'agissait d'éclairer son pays sur des erreurs dangereuses et funestes, il n'a pas, comme ses collègues qui ont rejeté sa proposition, pesé ce que dirait la Régie si l'opinion des académiciens, en tranchant une question si obscure et si controversée, venait à faire baisser dans ses coffres le chiffre toujours montant des produits du tabac.
Le docteur [Ambroise] Tardieu [1818-1879], dans le Dictionnaire d'Hygiène publique 1854, article Tabac, dit:
On lit dans la Gazette médicale de Paris, année 1855:
M. Claude Bernard [M.D., D.N.S.], professeur de chimie au Collège de France, dans sa 27e leçon, en 1850, disait, en parlant du principe vénéneux du tabac:
 (pp 130-137) fait que leur action délétère est plutôt lente qu'instantanée. Il en serait bien autrement si la bouche était froide; la nicotine s'y condenserait, et pour peu que la fumée y séjournât, le fumeur tomberait foudroyé, comme le sont les animaux à sang-froid, les lézards, les serpents, les grenouilles que l'on tue instantanément si on leur souffle dans la bouche une bouffée de tabac. LE TABAC, JUGÉ PAR LA SCIENCE, N'EST BON A RIEN. On reconnaîtra, par la longne énumération des faits qui précèdent, que les données de la science sont unanimes à constater les propriétés toxiques du tabac. Et si, à côté des effets meurtriers qu'on s'accorde à lui reconnaître, nous demandons encore à la science à quoi il est utile, la science nous répond: A rien! . . . Car s'il peut avoir quelques avantages, on peut toujours les obtenir par des moyens moins dangereux que lui. En effet, si l'on compulse tous les Traités de matière médicale qui ont paru depuis un siècle, époque à peu près où la médecine a pris un rang parmi les sciences, on ne trouve nulle part que la plante de Nicot ait pu apporter quelque soulagement réel aux maladies des hommes. On la trouve pourtant parfois indiquée en frictions ou en lotions, pour le traitement de la gale, et aussi en lavements pour ramener à la vie les asphyxiés dont on désespère. Le temps, qui l'avait dépouillée peu à peu de ses propriétés curatives, ne lui avait conservé que ces deux privilèges. Et si nous voulions lui enlever le dernier de ses prestiges et la faire disparaître en entier et définitivement des formulaires et des laboratoires de la médecine et de la pharmacie, nous dirions que, dans la gale, elle est aussi puissante a tuer l'acarus parasite que le malade lui-même, sous les téguments duquel il ha-  (pp 140-145) TOUT CE QUE LE TABAC PRODUIT DE DÉSORDRES DANS L'ÉCONOMIE. Maintenant que l'on sait que le tabac est le plus violent de tous les poisons végétaux, et que c'est par la plus étrange des erreurs et la duperie la plus niaise qu'on lui attribue, pour motiver son usage, des effets salutaires qu'il n'a pas, il sera facile de comprendre toute l'étendue des désordres qu'il jette dans la constitution physique et morale de l'homme, et par suite dans la société tout entière, dont l'homme n'est que l'élément constitutif, l'unité. Nous avons reproduit, pages 113 et suivantes, le rapport académique et officiel du docteur Mélier sur les manufactures de tabac, envisagées au point de vue de l'hygiène de ces établissements. On y a vu les désordres que produit le tabac sur la santé de ces quantités considérables d'ouvriers, hommes, femmes, enfants, occupés tous les jours à travailler la plante favorite de la reine Catherine de Médicis pour la livrer, sous toutes les formes, au nez et au palais du consommateur. On doit considérer tous ces ouvriers comme les victimes de ses émanations plutôt que de son usage libre, volontaire et direct. Cette catégorie d'infirmes diffère de la catégorie des consommateurs, en ce qu'elle demande à une industrie malsaine des moyens d'existence que lui donne un travail dangereux. Leur position, sous ce rapport, n'est pas sans mériter de l'intérêt. Le consommateur, au contraire, s'expose spontanément, sans nécessité, sans raison, aux ravages que des habitudes, volontairement contractées, peuvent causer dans sa santé. Il acheté chèrement ses souffrances. [Plus en anglais]. En exposant les désordres que l'usage du tabac amène dans notre organisation, nous passerons successivement en revue les organes sur lesquels il agit, soit par contact direct, soit par conséquence éloignée, de son absorption. De là naissent deux genres distincts de lésions: les lésions organiques et les lésions fonctionnelles ou physiologiques. Pour les lésions organiques, nous suivrons ses effets sur le nez, les yeux, la bouche, l'estomac, les intestins, le foie, le larynx, le poumon, le cœur, les reins, la vessie, l'appareil génital, la moelle épinière et le cerveau. Pour les lésions fonctionnelles ou physiologiques, nous exposerons les troubles qu'il apporte dans la digestion, l'hématose, qui appartiennent à la vie animale; et dans les fonctions plus élevées de la vie de relation: intelligence, moralité, génération. Dans la longue série de lésions organiques et nerveuses que nous allons développer, nous ne prétendons pas dire qu'au lieu de prévenir et guérir toutes les maladies, chez un même individu, comme on le croyait autrefois, le tabac les engendre toutes. Non! Mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que tout amateur souffrira plus ou moins de son usage, dans un ou plusieurs points de son économie, suivant son idiosyncrasie, sa constitution particulière, son tempérament. C'est-à-dire que l'organe et la fonction qui auront en eux quelque tendance à la faiblesse seront les premiers atteints par la subtilité du poison, et auront toujours à en souffrir. Ainsi, par exemple, il attaquera chez l'un, le larynx; chez l'autre, le poumon; l'autre, le foie; l'autre, l'estomac; l'autre, le sang; l'autre, l'intelligence; l'autre, la mémoire, etc. Et c'est ainsi qu'il fera sentir à tout consommateur, sous les formes  (pp 148-167) Du côté des organes de la respiration, combien ne constate-t-on pas de désordres chez les personnes qui font un usage constant du tabac? D'abord c'est le pharynx qui s'irrite et se dessèche, sous l'impression de la plante narcotique; car elle prend à la gorge et y cause un sentiment de constriction qui est un symptôme constant et caractéristique de tout empoisonnement par les substances végétales acres. Cet état du pharynx et de l'arrière-gorge tient les fumeurs et les chiqueurs dans un besoin continuel de boire, qui en pousse un si grand nombre à l'intempérance et à l'abus des boissons alcooliques ou fermentées. Du pharynx, l'irritation rayonne sur la glotte et le larynx. Un sentiment incommode de titillation provoque une petite toux sèche, qui est souvent un avant-coureur de la phtisie laryngée, à laquelle succombent un si grand nombre déjeunes fumeurs. La voix s'altère, elle n'a plus ni timbre, ni extension; elle est criarde et fatiguante. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nos tribunes parlementaires, nos barreaux, ne produisent plus d'orateurs; que l'on n'entend plus autant le chant du travailleur dans l'atelier; que, le soir, les solitudes de la nuit ne sont plus égayées par des chœurs de jeunes gens, unissant, dans les accords de leurs voix, le sentiment et l'art. C'est ainsi qu'on n'entend plus de grandes voix qui dominent le bruit des grands exercices militaires, et que, sur nos champs de manœuvres, le clairon strident a remplacé la voix mâle et sonore d'un commandant ou d'un officier instructeur.
une double voie: les canaux aériens ou les bronches, et le système capillaire sanguin qui, par leur union inextricable, au milieu d'un parenchyme spécial qui leur sert de support, constituent presque la substance même de l'organe. L'air atmosphérique pénétrant dans les bronches entraîne avec lui la fumée du tabac, soit qu'elle se dégage à l'air libre, soit qu'elle se trouve concentrée dans les appartements et les estaminets où se réunissent plusieurs amateurs, pour nager, en quelque sorte, en compagnie, dans l'ivresse nicotique qui les sature de toute part. Et si l'absorption a lieu par les membranes muqueuses des narines, de la bouche, de l'estomac, et même par la peau, à plus forte raison le principe toxique arrivera-t-il rapidement dans l'organisme par la circulation. Il se concentre dans le cœur, et vient s'épanouir en divisions infinies, comme le sang lui-même, dans les capillaires du poumon. Là, deux phénomènes physiologiques se produisent. Pour bien s'en rendre compte et en confirmer la valeur, il faut se rappeler qu'en parlant des expériences faites sur la nicotine administrée à des animaux vivants, nous avons établi que ce poison végétal manifestait son action sur le système circulatoire par un effet de constriction qui resserrait le calibre de tous les vaisseaux, même du cœur, apportait dans la circulation une entrave générale, un point d'arrêt qui se manifestait par la petitesse et l'accélération des battements du cœur, qui semble plutôt vibrer que se contracter. Pour toute personne qui n'est pas familière à l'action du tabac, cet effet est fortement senti quand on séjourne quelques instants dans une atmosphère chargée de nicotine. Cette constriction est si marquée, qu'il semble que la poitrine se resserre, qu'une lourde atmosphère vous enveloppe, vous empêche de respirer, vous étouffe. Voilà pour le premier phénomène, le plus immédiat, le plus instantanément senti. Le second phénomène provient de l'action de la nicotine sur le sang lui-même. Nous avons vu également que la nicotine, en contact avec ce liquide, le noircit et le coagule, au point de conserver, comme par une sorte de cristallisation, les tissus qui en sont fortement imbibés, comme le poumon, la rate, le foie, etc. Ces effets de physiologie expérimentale bien constatés, nous arrivons à conclure que l'action du tabac sur le poumon se manifeste par quatre genres de désordres distincts: 1° Irritation directe de la membrane muqueuse des bronches par l'action narcotico-âcre de la fumée: 2° Diminution du calibre et de l'élasticité des canaux affectés à la circulation de l'air et du sang; 3° Coagulation du sang dans les capillaires sanguins; 4° Atonie, langueur, imperfection de l'hématose, par l'effet stupéfiant du poison narcotique sur les nerfs divisés à l'infini dans le parenchyme pulmonaire, comme s'y ramifient les capillaires aériens, artériels et veineux. 1° L'irritation directe de la membrane muqueuse de l'appareil pulmonaire aérien produit chez le fumeur la bronchite qui, passant rapidement de l'état aigu à l'état chronique, dégénère presque toujours en catarrhe chronique du poumon. C'est alors que les fumeurs peuvent dire, avec raison, qu'ils éprouvent un véritable besoin de fumer, et qu'ils trouvent dans la satisfaction de ce besoin un soulagement à leurs infirmités. En effet, de même que nous avons vu la prise faire couler, à la satisfaction des bonnes femmes, le catarrhe nasal, que l'usage seul du tabac avait acclimaté dans leur nez, de même le fumeur, quand il hume son cigare ou sa pipe, voit sortir avec plaisir de sa poitrine les glaires épais et filants de son catarrhe pulmonaire. Il vante alors les vertus expectorantes du tabac. Dans son enthousiasme, on l'entend souvent dire:
Mais ce dont il ne se doute pas, dans la simplicité de sa foi, c'est que le catarrhe, qui fait un des tourments les plus persistants de sa vie, n'est pas une maladie naturelle, dont il a été fatalement atteint; mais bien une infirmité qu'il a provoquée lui-même par sa confiance erronée dans ses pratiques malsaines. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le tabac seul l'a engendrée et la perpétue; c'est qu'à chaque pipe qu'il fume, il apporte l'aliment à la fluxion strumeuse que la pipe suivante aura à expulser. C'est ainsi qu'il puise sans cesse à une source intarissable ces humeurs contre nature, qui coulent avec tant d'abondance que, souvent fatigué d'expectorer, il murmure tout bas:
L'air et le sang ne pénétrant le poumon qu'en quantités insuffisantes, les inspirations et les expirations sont courtes et rapides; il faut, par exemple, trois mouvements de l'appareil respiratoire pour opérer l'effet physiologique qui se fait en deux, dans un poumon non altéré. De là l'essoufflement et la suffocation dans le travail forcé, la marche rapide ou ascendante, la course; de là aussi l'asthme, dont un si grand nombre de fumeurs sont atteints.
Et, comme les capillaires des bronches rétrécis se refusent, chez eux, à laisser passer, en un temps donné, cette quantité d'air nécessaire, la poitrine se soulève avec force, comme un soufflet dont on presse l'action. L'air, refoulé par la pression atmosphérique dans le vide que produit brusquement ce soufflet, pénètre, en les forçant, les mille petits canaux où il circule, pour atteindre les profondeurs capillaires du poumon; il y produit un bruissement dont la résultante, dans les bronches et le larynx, est ce sifflement lourd qui caractérise l'asthme, et qui fatigue autant les asthmatiques que ceux qui les approchent. [Plus en anglais]. A l'expiration, le phénomène est le même, et se produit en sens inverse, avec un sifflement plus marqué, parce que la poitrine est plus fortement organisée pour l'expiration que pour l'inspiration; et qu'elle se presse d'expulser l'air usé, pour le remplacer par l'air pur dont elle a, dans son anxiété, un besoin si impérieux. La difficulté qu'éprouve l'air à pénétrer dans les ramifications des bronches, et surtout les efforts que fait la poitrine pour l'en expulser produisent, dans ces canaux, une lésion spéciale qu'on appelle emphysème. L'emphysème pulmonaire consiste en une dilatation mécanique de certaines parties des tubes aérifères, tandis que le tube lui-même conserve son diamètre normal dans la plus grande partie de son parcours. Il se forme alors sur ces conduits une série de petites ampoules, sous forme de chapelet, comme on les voit se dessiner sous la pression du sang, dans les veines variqueuses superficielles: aux jambes, par exemple. [Plus en anglais]. Ces ampoules, une fois constituées, se gonflent à chaque mouvement d'entrée et de sortie de l'air, et forment comme autant de petites soupapes, ou mieux, de petits tampons, qui viennent presser latéralement sur les vaisseaux aérifères et sanguins qui les entourent de toute part, et déterminent dans ces vaisseaux autant de points d'arrêt ou d'obstacles à la circulation pulmonaire. De là un nouveau genre de suffocation qu'on appelle dyspnée, dont les phénomènes se confondent avec ceux de l'asthme proprement dit. 3° La coagulation du sang s'opère dans les capillaires artériels et veineux du poumon, par le contact de la nicotine avec ce fluide. Bien que les deux principes, nicotine et sang, circulent côte à côte dans des tubes différents et distincts, c'est par le phénomène physiologique de l'endosmose que la combinaison s'opere. La nicotine, comme l'oxygène de l'air, avec lequel elle a beaucoup d'affinité, passe par endosmose, ou absorption trans-membraneuse, dans les vaisseaux sanguins; et, tandis que l'oxygene en se combinant avec le sang le rend rutilant, fluide, artérial, et comme tel, propre à entretenir la vie, la nicotine de son côté, le brunit, l'épaissit, y tue le globule que l'oxygène a vivifié, et lui donne les qualités asphyxiantes qui produisent l'ivresse narcotique: ivresse sombre, que les fumeurs appellent la consolation de l'ennui, et qui n'est que la dépression de la faculté de sentir, qui s'endort engourdie dans les vapeurs du tabac, comme elle s'endormirait dans les vapeurs asphyxiantes du charbon, par exemple, ou de toute autre émanation délétère. Le sang ainsi épaissi forme, dans les capillaires, qu il parcourt, un coagulum dont la plasticité pâteuse entrave la rapidité de la circulation, y détermine des points d'arrêt. Or en anatomie physiologique, il est un fait incontestablement etabli: c'est que le sang qui ne circule plus dans ses canaux se coagule, perd sa vie, et agit dans l'économie comme corps étranger ou comme substance de formation accidentelle. Ce phénomène se répétant de plus en plus dans les capillaires du poumon, par l'absorption répétée de la nicotine, amené graduellement, chez le fumeur, l'hépatisation pulmonaire.
L'hépatisation du poumon était autrefois une maladie assez rare; on la constatait, par l'autopsie, sur les sujets qui succombaient aux suites d'une inflammation aiguë du poumon, qui avait résisté aux moyens curatifs. Là, la solidification du sang, son immobilité, sa dégénérescence étaient le résultat de  (pp 174-193) sable des sondes qui se creusent parfois des fausses routes dans ces tissus ramollis par l'inflammation. Et c'est là la source la plus ordinaire de la dégénérescence cancéreuse, qui affecte surtout la prostate, corps glanduleux que traverse le col de la vessie au point où il se continue avec le canal de l'urètre. Dans les êtres organisés supérieurs, il y a deux personnalités bien distinctes, qui s'appellent l'individu et l'espèce. Ces personnalités ont, pour trait d'union, le testicule. Aussi, le testicule, par le fait de cette communauté, et par une grande exception dans la loi organique, n'est-il pas indispensable à l'individu pour la perfection de son existence comme être isolé. Il s'en sépare, comme chez les castrés et les eunuques, sans que sa constitution en souffre. Il n'a fait que perdre un sens, le sens génital, en s'affranchissant d'une faculté, ou plutôt d'une obligation: celle d'engendrer. La nature, en échange de cette obligation accomplie, donne un plaisir; et c'est là, en apparence, tout ce que le testicule rapporte à l'homme. Mais ce plaisir, vu la grande utilité de son but, la génération à laquelle il invite, est celui qui ébranle le plus voluptueusement toutes nos facultés de sentir. C'est celui que nous recherchons le plus, et c'est de lui que naissent le sentiment, l'affection de la famille, l'attachement au foyer, à la patrie, l'espérance dans l'avenir, les croyances en Dieu: tous ces puissants leviers qui agitent le monde et qui émanent de l'amour et se résument en lui. Le testicule, c'est la source de la vie, car il crée, dans les profondeurs mystérieuses de sa substance, la monade humaine, le zôosperme, cet infusoire qui deviendra homme, en passant par tous les degrés et par toutes les évolutions de la matière animée.  (pp 195-199) ou n'existe qu'en très minime proportion dans la liqueur séminale; et les deux sexes-vivent, au contact l'un de l'autre, dans une parfaite indifférence génitale. Si, chez la généralité des animaux, la faculté d'engendrer est intermittente, chez l'homme elle est continue. Il a en lui toutes les énergies nécessaires pour le rapprochement fructueux des sexes. Dans toutes les saisons, sous tous les climats, à tous les instants de sa vie, depuis la puberté jusqu'à la vieillesse, tout son appareil génital répond à tous ses désirs. Ce privilège, l'homme le doit à la prédominance de sa constitution nerveuse, qui, chez lui, plus que chez les autres êtres de la création, sécrète largement la vie, et la verse avec profusion aux jouissances fantaisistes de tous ses sens, comme aux méditations profondes de sa pensée. Et si, par une cause perturbatrice quelconque, la maladie, la vieillesse, par exemple, la source de vie vient à diminuer, le sens et l'appareil qui en sont les premiers privés sont le sens et l'appareil génital, dont l'existence est la moins indispensable, comme nous l'avons déjà dit, à la conservation de l'individu. C'est un fait que tout le monde peut constater, en observant ce qui se passe en semblables circonstances dans sa propre organisation. Nous savions, d'ailleurs, que toutes les fois qu'un principe délétère, un poison, s'infiltre dans l'organisme pour le troubler ou le détruire, une partie proportionnelle de fluide nerveux ou de vie vient aussitôt à sa rencontre et se sacrifie pour le neutraliser. Et, par toutes ces considérations, nous arrivons à conclure que la nicotine ne se détruit, chez le fumeur, qu'au détriment, en première ligne, de ses facultés génératrices. Ainsi s'expliquent ces grands faits contre nature que signalent les statistiques et dont sont témoins les doyens d'âge de nos sociétés modernes: la décroissance de la population; la diminution des mariages, leur peu de fécondité ou leur sté- rilité absolue (1), la mortalité des enfants en bas âge; l'impuissance, relativement grande, des mères à arriver au terme de leur gestation utérine; la fausse couche avant que l'embryon ait manifesté sa vie par le mouvement dans les eaux de l'amnios, et toutes les circonstances graves qui résultent, pour les femmes, de ces avortements souvent répétés. La diminution de la population ou le temps d'arrêt qu'elle éprouve dans sa croissance régulière, la mortalité des enfants, sont des faits assez authentiques et assez bruyants pour que nous n'insistions pas ici à prouver leur existence; et les préférences de l'homme pour le célibat s'affichent hautement dans toutes les classes sociales où nous nous agitons. Quant au peu de fécondité ou à la stérilité absolue des mariages, il suffit, pour se convaincre de cette particularité, qui n'est pas assez observée ou dont les causes sont mal appréciées, de regarder autour de soi. Si l'on passe une revue dans un cercle de ses connaissances, on trouve bien des jeunes ménages, à mari fumeur, où la volonté, le désir, la joie d'avoir de la famille, demeurent constamment infructueux.
Citons, à cette occasion, une petite anecdote pleine d'actualité et de franchise par des militaires. Au moment où les artilleurs territoriaux de la ville de Lyon quittaient leur régiment, en garnison à Valence, le colonel leur adressa ces paroles d'adieux tant soit peu rabelaisiennes:
La chronique ne dit pas si ce brave colonel donnait lui-même l'exemple à ses soldats, et si le tabac, qu'il brûlait peut-être, ne le détournait pas, lui aussi, à son insu, du culte qu'il prêchait si bien pour le petit dieu de Cythère.  (pp 202-215) la langueur. Tantôt c'était un remords d'avoir contracté ce mariage, pour lequel il aurait dû comprendre qu'il n'avait pas toutes les conditions requises; tantôt c'était la sombre jalousie qui lui faisait douter de la pureté de l'attachement de la malheureuse femme, dont la vie se passait à nourrir en lui des espérances pour un avenir meilleur. Dans ce courant d'émotions, trop fortes pour son cerveau ramolli, sa raison se perdit, et le pauvre aliéné dut traîner, pendant plus de dix ans encore, sa misérable existence dans un de ces asiles que la pitié publique ouvre à toutes les dégradations mentales, et qui cachent aux regards du monde tant de victimes que fait tous les jours le tabac. Ah! si les médecins pouvaient révéler toutes les confidences qui leur sont faites en semblables matières, que de pièces accablantes viendraient grossir le dossier de l'accusation, dans le procès du tabac! Mais, sans jeter un regard indiscret dans l'intimité des ménages, dont un trop grand nombre ressemblent à celui dont nous avons entrouvert l'alcôve, constatons ce qui se passe sous les yeux de tout le monde; examinons quels sont, de nos jours, les rapports de l'homme et de la femme dans la société. LE TABAC CHANGE LES RAPPORTS SOCIAUX DE L HOMME
Ceux qui peuvent, comme nous, remonter par la mémoire au bon vieux temps du commencement du siècle, se rappelleront qu'il y avait alors un foyer de famille dont les femmes étaient l'âme, le centre d'attraction. Dans toutes les classes de la société, depuis la chaumière jusqu'au palais, on se réunissait, on se fréquentait; et le but de ces soirées, où se confondaient dans une même gaieté les membres de la famille, les intimes et les étrangers, était toujours de rapprocher, sous les yeux des parents, de beaux jeunes gens et de gracieuses jeunes filles, qui devaient plus tard devenir des époux. C'était la vie sociale dans tout son naturel, son charme et son entrain; l'ingénuité, l'esprit, l'art y brillaient sous l'aiguillon puissant du désir de plaire. Là naissait aussi, sans qu'on s'en doutât, le besoin d'aimer. Les jeunes gens, cédant à ce penchant naturel qui leur faisait trouver des charmes dans la société des jeunes filles, se pressaient dans ces réunions, où ils mettaient toute leur ambition, tout leur amour-propre d'être admis. On dansait, on faisait de la musique, on jouait les charades et mille autres divertissements de société.  (pp 218-245)
EFFETS DÉPRIMANTS DU TABAC SUR LES FACULTÉS GÉNITALES,
L'abaissement du sens génital, sous l'influence du tabac, est une question d'un intérêt trop vital, pour que nous prétendions arriver à la conclure sur le seul exposé des opinions que nous venons d'émettre. Aussi, pour donner à nos appréciations plus de valeur pratique, nous avons cherché à les appuyer par les révélations de l'expérience. Chez l'homme, comme chez les animaux de tout rang, le principe de là vie est le même; et le fonctionnement de l'organisme y est modifié ou détruit, d'une manière uniforme, par tous les agents perturbateurs que l'on met en contact avec des êtres d'espèces différentes. C'est ainsi que l'étincelle électrique agite de mouvements convulsifs identiques les membres de l'homme, du cheval, de l'oiseau, de la grenouille, de la fourmi. L'alcool leur donne l'ivresse, l'opium l'assoupissement, la nicotine, le curare, en contact avec leurs chairs, leur donnent la mort. Quand le docteur Mélier, dans un rapport officiel à l'Académie des sciences, que nous avons cité page 113 et suivantes, affirmait que les manutentions de tabac étaient des industries délétères, il expérimentait aussi sur des plantes et des oiseaux, pour conclure, des effets que le tabac produisait sur eux, à ce qu'il devrait produire chez l'homme. Le docteur Wright, expérimentant sur des chiens, auxquels il donnait, tous les jours, certaines quantités de tabac, constatait chez eux la flétrissure du testicule et le dégoût pour les rapports sexuels. Ce qui menait à conclure que les effets de cette plante, chez l'homme, devaient être identiques (page 123). Ces faits se rapprochaient absolument de ce que j'observais, tous les jours, chez les fumeurs, que j'avais été amené à reconnaître comme peu ardents aux amours, impuissants ou stériles; et pour mieux établir mon opinion à ce sujet, j'entrepris d'étudier, par un travail consciencieux et patient, ce que produirait le tabac sur des poules et des lapins. Je menai en même temps mes expériences sur ces deux familles d'animaux, qui sont les plus producteurs de nos espèces domestiques, surtout dans le midi de la France. J'étais dans les conditions les plus favorables pour conduire à bonne fin ce minutieux travail d'observation. J'avais quitté l'Amérique, où je vivais depuis 1849, pour venir rechercher, à Toulon, des biens que, dans mon absence, l'État m'avait pris, à mon insu, dans une grande expropriation pour utilité publique, et dont l'indemnité m'avait été frauduleusement soustraite, dans tous ces désordres administratifs qui signalèrent la fin de l'Empire. J'avais retrouvé, dans ce grand désastre de ma fortune, un petit coin de terre, situé au vallon de Claret, au pied des montagnes rocheuses du Faron, au nord de Toulon. Je me retirai là, de 1864 à 1870, attendant avec résignation la marche lente de la justice, à qui je demandais la restitution de mes biens, qu'elle ne me fit pas rendre; sans doute parce que l'État était le puissant adversaire contre qui je plaidais, et que le voile tiré sur ces mystérieuses affaires était bien lourd à soulever, vu les responsabilités qu'il mettait à couvert. J'avais fait de mon vallon de Claret un petit ermitage. Si la nature y était ingrate pour la végétation, par manque de terre  (pp 248-259)
COMMENT TUE LA NICOTINE. Dans les expériences que nous avons rapportées, pages 81 et suivantes, sur les propriétés délétères du tabac, nous avons vu la nicotine causer la mort par effet foudroyant, sitôt qu'on l'introduit dans l'organisme, par quelque voie que ce soit. Ce phénomène instantané ne saurait s'expliquer que par l'action de cette substance sur le système nerveux, qui est la source de la vie. Que se passe-t-il dans cette œuvre de destruction si terrible? A l'autopsie des cadavres qu'a tués la nicotine, l'œil ne découvre rien qui ait pu causer la mort. Il n'existe aucune trace de lésions matérielles ou automatiques; tout ce que l'on peut constater, c'est que la vie est éteinte, telle qu'elle le serait par l'électricité, la foudre. Et entre ces deux agents de destruction subite, il y a encore cette différence, que la foudre a une force matérielle. Elle enflamme le ciel, elle fait trembler les montagnes, elle creuse la terre, renverse les édifices, fond les métaux. Elle représente un corps, un volume quand elle tue. La nicotine, elle, quand elle foudroie, ne présente qu'une goutte, un atome, un rien. Dans l'état actuel des connaissances humaines, nous ne pouvons expliquer que par deux mots: poison, empoisonnement, la terrible puissance que la nicotine a sur l'organisme. Nous constatons un fait, sans pouvoir en approfondir les causes intimes; car comment expliquer qu'une infime partie d'une substance végétale, déposée sous l'épiderme, à l'un des points les plus éloignés de notre corps, envahit instantanément tout notre organisme en pleine vie, et y détruit cette vie avec plus de rapidité que ne le feraient la blessure, la mutilation la plus grave, un boulet qui couperait notre corps en deux, un train de chemin de fer qui broierait nos chairs et nos os?
Si l'on pouvait par une définition toute matérielle, donner une idée d'un phénomène si immatériel que la vie, nous dirions: la vie naît des centres nerveux qui la sécrètent et la répandent dans tout l'organisme pour le mettre en action. En effet, quand on descend dans les profondeurs les plus reculées de la vie, quand on fouille en quelque sorte l'élément dont elle va sortir, l'embryon, la première chose qui tombe sous les sens, dans cette matière encore amorphe, c'est un petit filament assez semblable au spermatozoïde de la fécondation. Si l'on suit, jour par jour, sur des germes différents, les progrès de ce filament primitif, on le voit devenir graduellement cerveau et moelle épinière; et créer, comme par végétation, tous les organes qui doivent concourir avec lui à l'évolution de la vie, et se renfermant, comme par une intuition et une prérogative de sa puissance souveraine, dans une enveloppe protectrice, le crâne et la colonne épinière, il se dé lègue lui-même, sous forme de cordons ou de nerfs ramifiés à l'infini, dans toutes les profondeurs de notre corps, dont il développe et anime la matière par un mystère dont l'essence remonte à Dieu, source insondable de toute vie. Autant que la physique et la physiologie peuvent le constater, voilà ce que serait la vie: le cerveau l'engendre, puis  (pp 262-275)
Pauvre femme! c'était elle qui devait le quitter la première. Son domestique, un de ces misérables dont la nicotine avait changé les susceptibilités d'un mauvais caractère en instincts meurtriers, l'assassina dans la chambre, aux pieds mêmes de son mari, sans que la parole ou le mouvement aient pu revenir au malheureux infirme, qui demeura impassible et inconscient devant cet horrible crime. LA NICOTINE, CAUSE DÉTERMINANTE
On ne saurait vraiment croire combien sont nombreux dans les familles, les maisons de santé, les hospices, les infirmes de ce genre, dont nous venons de reproduire un tableau, et que l'on classe indistinctement dans la catégorie des idiots. Avant d'arriver à ce bas-fond de la décrépitude humaine, que la mort ne leur laisse pas toujours le temps d'atteindre, les nicotines passent par une série de maladies intellectuelles et morales, dont les premiers degrés sont parfois difficiles à saisir, tant ils se perdent dans les nuances normales de caractère qu'on appelle l'excentricité, l'originalité, et qui ne sont pourtant autre chose qu'un premier pas vers la folie. Ces premiers dérangements nerveux affectent les sens: la vue, l'ouïe, le goût, le sens génital. Ce sont les hallucinations proprement dites [p 308]. Les hallucinés de la vue et de l'ouïe se croient possédés par des esprits; ils les voient, ils les entendent, ils conversent avec eux. Et pour peu que vous laissiez aller ces fous lucides au courant de leurs impressions et de leurs erreurs, ils vous dépeindront avec clarté, comme s'ils les voyaient en corps, les formes des êtres mystérieux qui les obsèdent. Ils vous repro-  (pp 278-281) saient. La police faisait alors une charge, cassant des bras et des têtes, opérant des arrestations importantes dans ces foules inoffensives, d'où elle laissait échapper les blouses blanches qui avaient été la cause première du tumulte et du rassemblement. C'est ainsi que ces don quichottes d'un nouveau genre combattaient une fiction; une émeute qui n'existait pas, à laquelle personne ne songeait, et remportaient des victoires faciles sur ces flâneurs et ces curieux que l'on appelait les ennemis éternels de l'ordre social, les convoiteurs de la propriété, les partageux . . . , grands mots qui n'exprimaient aucune réalité, et dont on se plaisait à effrayer les campagnes. C'est par là que l'Empire se posait en sauveur de la société, toutes les fois qu'il avait besoin de recourir aux suffrages de la nation, pour retremper son autorité chancelante. L'occasion de l'enterrement de Noir était des plus favorables à l'organisation d'une fausse émeute. Rochefort le comprit, quand ces inconnus vinrent si bruyamment jeter le trouble dans ces funérailles si imposantes et si calmes. C'est alors qu'il s'élança sur le catafalque dont les faux émeutiers cherchaient en vain à l'abattre, et qu'il cria à la foule:
La foule le comprit, et continua silencieusement sa marche recueillie dans la direction fixée pour la cérémonie funèbre. Notre pauvre nicotine d'Asnières, lui aussi, était là. Il s'éprit d'une belle passion pour Rochefort. Ses facultés engourdies par le tabac s'éveillèrent à la mise en scène de ce personnage révolutionnaire. Son imagination le voyait toujours monté sur le catafalque de Victor Noir, haranguant la foule, et sauvant toutes ces masses des embûches de la police. Ces entraînements d'enthousiasmes ébranlèrent tellement l'intelligence affaiblie du malheureux docteur que, d'halluciné qu'il était, il devint complètement fou. Et, un matin, on lisait dans les journaux de Paris:
Et Bicêtre ne rendit plus celui dont le tabac avait fini par faire un fou et un criminel! Citons encore un cas bien frappant d'hallucination, chez un officier supérieur commandant un corps d'armée au Tonkin. Pendant nos hostilités avec la Chine, sous le ministère Ferry, une nouvelle vint jeter l'émoi dans toute la France. — Nos troupes ont essuyé une grande défaite à Lang-Son; elles sont en pleine déroute, abandonnant leur matériel, même le trésor qu'il a fallu jeter à l'eau pour qu'il ne tombât pas au pouvoir de l'ennemi. Et la dépêche suivante disait que toute cette débâcle, peu conforme au caractère français, n'avait été que l'effet d'unepanique; le commandant ayant fait sonner la retraite parce que, dans son imagination maladive, il avait vu s'avancer contre lui des armées chinoises qui n'existaient pas. [Plus d'hallucination en anglais]. Le malheureux officier, après une action si singulière, a subi enquête sur enquête sans qu'on ait pu ni le condamner ni l'absoudre; et, sa mort survenant, son dernier juge fut l'autopsie, qui constata chez lui un ramollissement et une atrophie du cerveau dus au tabac dont il faisait un excessif usage, et ne le rendaient plus maître de ses sensations et de ses actes. Les sens de l'odorat et du goût, qui tiennent plus à la vie de nutrition qu'aux relations extérieures, sont aussi susceptibles d'hallucination, sous l'influencû stupéfiante de la nicotine. Et la preuve la plus proche et la plus évidente que l'on puisse donner de cette assertion, est le changement rapide qui s'opère chez les consommateurs de tabac eux-mêmes. Ils finis-  (pp 283-289) passe; Menesclou a dormi sur ce cadavre; et le matin, quand ses parents sont sortis pour leurs occupations journalières, il allume le fourneau, coupe l'enfant par morceaux et va faire disparaître par le feu les traces de son crime. Mais les os qui craquent sous le couperet, le bruissement et l'odeur de la chair qui brûle, attirent l'attention des voisins; on force la porte; on voit Menesclou le cigare à la bouche, en manches de chemise, un tablier de cuisine devant lui; il attisait dans son poêle les entrailles et la tête de la pauvre petite. On a trouvé, en différents endroits de l'appartement, plus de quarante morceaux du corps de l'enfant; le monstre avait dans ses poches les deux bras de sa victime. Ce qui démontre chez ce misérable combien l'aliénation du sens moral coïncidait avec la perversion de ses instincts, c'est que pendant qu'il savait qu'on le soupçonnait du plus monstrueux des crimes, par les recherches réitérées que l'on faisait dans son appartement, il poétisait et rimait, et semblait faire à sa conscience l'aveu de son forfait. Sous l'impression de tout ce qu'il venait de commettre d'horreurs, il écrivait sur son carnet ces quatre vers:
C'est quand le crime est achevé, quand la passion est assouvie, quand le misérable ne devrait plus avoir qu'une pensée: se soustraire au châtiment, qu'il se dénonce lui-même en quatre lignes rimées, où il avoue sa double atrocité. La science et la justice ne devraient-elles pas reconnaître par ces anomalies que ces dégénérés n'ont pas leur libre arbitre et qu'ils agissent fatalement sous l'influence perversive du nicotisme; comme l'homme ivre qui devient criminel sous l'influence de l'alcool. Avec cette différence que l'ivresse nicotique, par les altérations profondes qu'elle cause à l'organisme, est constitutionnelle et persistante, tandis que l'ivresse alcoolique attaque plus superficiellement notre vitalité et n'est que passa gere. A l'autopsie, on trouva le cerveau de Menesclou tellement ramolli, que les docteurs ont déclaré que si l'on avait retardé de huit jours son supplice, la mort subite l'en aurait dispensé. EFFETS DE LA NICOTINE SUR L'INTELLECT. Nous venons de passer en revue les différentes variétés d'aberration des sens, sous l'influence narcotique du tabac. Si ces délires sont limités autant que le sont nos organes affectés aux facultés sensitives, il n'en est pas de même des délires de nos facultés intellectuelles et morales. Ils sont infinis, comme elles; ils n'ont pas de limite, dans l'état de perfection de l'organisme nerveux qui préside à leur manifestation.
On le voit, Fairet, ce médecin aliéniste qui écrivait au commencement de notre siècle, avait été frappé du grand rôle que jouait l'usage des narcotiques dans la production des diverses folies qu'il constatait déjà de son temps. Et pourtant, l'adoption du tabac n'était encore qu'une rare exception dans nos habitudes. Le discrédit bien mérité qui le frappait généralement en avait refoulé l'usage dans les classes les moins cultivées de la société, dont l'organisme nerveux était loin d'être aussi impressionnable aux effets des narcotiques que le système plus développé et plus sensible de gens que l'éducation et le travail intellectuel ont élevés aux degrés supérieurs de la perfection humanitaire. Aujourd'hui, bas-fonds et sommet de notre société, tout est envahi par l'épidémie de la passion. L'humanité se modifie en mal, par la continuité du narcotisme, comme les races se modifient par le climat. Aussi, est-ce en vain que la civilisation et les progrès nous éclairent. L'instruction, les arts, la religion, la morale, cultivent notre enfance; nous arrivons à la puberté avec tous les germes des qualités physiques et intellectuelles qui nous permettraient, par leur développement, d'atteindre à l'apogée de notre existence d'hommes. Mais, à l'entrée de la carrière, l'ignorance du mal, le démon de la tentation, la contagion de l'exemple, nous livrent, sans expérience, à la séduction du tabac. Alors toutes ces énergies, qui naissaient de notre jeune organisme, comme des rayons de lumière et de vie, tous ces enthousiasmes pour le beau, le grand, le vrai, qui créent l'art, la littérature et la science, tout languit et s'étiole dans les lourdes vapeurs du narcotisme. Il ne nous laisse plus au cerveau que l'engourdissement, l'impuissance ou le délire; la sécheresse au cœur. Suivez, dans les écoles d'enseignement supérieur, ces jeunes collégiens de dix-huit ans, qui ont conquis avec facilité et avec  (pp 294-301) EFFETS DE LA NICOTINE SUR NOS APTITUDES D'ORDRE SECONDAIRE. La nicotine, qui, avant de détériorer et de tuer l'organisme, stérilise nos pensées, fait aussi sentir ses effets dépressifs sur les facultés moins élevées de notre intellect, telles que les aptitudes mécaniques, industrielles et commerciales, par lesquelles l'homme manifeste ses hautes prérogatives, et progresse dans la civilisation et le bien-être. L'homme ne doit pas seulement à son intelligence sa supériorité dans la création, il la doit surtout a sa main. Et, si le cerveau est le support de la pensée, la main est le support du travail et de l'art. Supposez l'homme, avec toute son intelligence, sans sa main, vous en faites la plus misérable de toutes les créatures. A quoi lui servirait, par exemple, de rêver, dans son idéal, les plus belles scènes du monde, s'il n'avait pas dans ses doigts la puissance de les réaliser et de les faire vivre par le pinceau et le burin? A quoi lui servirait aussi d'avoir une idée du temps, s'il ne pouvait le mesurer, dans ses fractions les plus inappréciables, à l'aide du mécanisme de l'horlogerie, que crée sa main en façonnant les métaux? Depuis la montagne qu'il émiette, le vaisseau qu'il construit, l'acier qu'il forge, le diamant qu'il taille, toute la valeur matérielle de l'homme est dans sa main. Elle est le complément essentiel de son génie, qui, sans elle, serait stérile. Elle est sa puissance créatrice, qui, peut-être, le rapproche le plus de Dieu, dont elle semble continuer les œuvres, en transformant la matière par l'architecture, la métallurgie, la chimie, etc. Aussi, la main est le plus privilégié de tous nos organes dans la répartition du fluide nerveux ou du principe de vie. Elle est le siège d'un de nos sens les plus importants, le sens du toucher, ce qui la met en communication intime avec le cerveau, à qui elle rapporte toutes ses sensations et dont elle reçoit tous ses commandements et toutes ses facultés d'agir. L'élément nerveux joue donc, dans les fonctions de la main, un des principaux rôles. C'est de lui qu'elle reçoit sa force, son agilité, sa précision, en un mot, tout ce qui constitue son génie. Elle a, avec le centre de vie, les sympathies les plus étroites. Elle est forte dans les élans du courage; elle tremble dans la colère; elle se paralyse dans la peur. Et c'est dans le désordre de ses mouvements, dans ses soubresauts, que la médecine puise les indications les plus précises sur les maladies du cerveau. Aussi, dans le nicotisme, qui affecte surtout l'encéphale, la main perd-elle, commr l'intellect, ses qualités les plus précieuses. Elle a, comme lui, ses hallucinations et ses délires, et alors elle gâte tout ce qu'elle touche; elle fait sa besogne avec lenteur, et elle la fait mal. Et, si l'on suit avec attention les jeunes fumeurs dans leur apprentissage aux écoles d'arts et métiers ou dans l'atelier, où ils n'ont à faire qu'un travail d'imitation, on voit combien ils sont lents à apprendre. Ils sont lourds, embarrassés en maniant les outils du travail. Tout ce qui sort de leurs mains manque de la propreté, de la netteté, du fini auxquels on reconnaît le parfait artisan. C'est pourquoi les bons ouvriers deviennent de plus en plus rares dans beaucoup de professions; et les mauvais produits qui encombrent nos industries, et qu'on appelle les camelotes, sont moins dus à la modicité des prix du travail qu'au manque de capacité de la main qui les fait. Ah! si l'on pouvait compter tous ces pauvres artisans dont la nicotine engourdit ou fait trembler la main, le nombre en serait sans limite. Il en est qui sont toujours aussi peu expérimentés qu'au sortir de l'apprentissage, dont, pour mieux dire, ils ne sortent jamais. D'autres, au contraire, qui étaient arrivés au dernier fini de leur profession, perdent insensiblement toutes leurs aptitudes. Et tous ces déshérités de l'industrie, tous ces invalides avant le temps, courent d'atelier en atelier, cherchant, pour leur existence et celle de leur famille, un travail qui leur devient de jour en jour plus difficile, qui leur est toujours in suffisamment payé quand on les emploie; car ils portent fatalement en eux, partout où ils se présentent, cette incapacité, cette indolence, cette lenteur, qui ne leur permettent plus d'être debons ouvriers. Cette décadence d'un ordre tout spécial se rencontre surtout chez les ouvriers des métiers délicats et de précision, tels que l'horlogerie, la bijouterie, la ciselure, la gravure, la lithographie, la typographie, etc., toutes professions où il faut de la mobilité, en même temps qu'une grande sûreté dans la main, qui ne doit, pour l'aisance et la perfection dans le travail, ni trembler, ni hésiter; et qui toujours tremble et hésite sous l'influence de cette maladie spéciale: le delirium tremens, si fréquente chez les consommateurs de tabac. [Plus en anglais].
Or, la nicotine les engourdit toutes les deux. Le génie du commerce consiste aussi dans l'ordre, le jugement, l'esprit spéculatif, qui sont autant de facultés émanant de l'intellect. Et la nicotine, en jetant le trouble dans les fonctions du cerveau, dégrade en nous les aptitudes commerciales, de la même manière qu'elle ne nous permet pasde devenir orateurs, poètes, penseurs, artistes. Aussi n'est-it rien de plus fréquent que d'entendre dire du plus grand nombre de ceux qui ruinent par leurs faillites, si fréquentes de nos jours, le crédit et les intérêts du commerce:
ACTION PERVERSIVE DE LA NICOTINE SUR LE SENS MORAL. Le sens moral, qui est le couronnement de toutes les perfections humaines, l'émanation la plus subtile de notre organisme, et que l'on pourrait appeler la manifestation par excellence de l'âme, n'est pas exempt, lui non plus, des atteintes perversives du tabac. Le sens moral est cette faculté qu'a l'homme de distinguer le bien du mal; elle le porte a aimer l'un et à détester l'autre. C'est du sens moral que découlent toutes nos qualités sociables: la justice, la douceur, la clémence, la charité. Sa maxime est:
Si le sens moral existait chez tous les hommes, tel qu'il se révèle ou tel qu'on le conçoit dans la perfection du type, l'ordre et la paix rég-neraient sur la terre. Le premier fils de l'homme, Caïn, n'eût pas tué son frère Abel, et n'eût pas transmis à sa descendance les sombres instincts du meurtre. Mais, dans tout ce qui est humain, régularité et désordre sont bien voisins l'un de l'autre; et le sens moral qui est entre toutes nos perfections, innées ou acquises, la plus fragile, la plus changeante, est celle qui se modifie le plus facilement sous l'influence de tout agent perturbateur du cerveau. Voyez, par exemple, la colère, qui ne résulte pourtant que d'une impression passagère de l'âme; elle étouffe, quand elle éclate, toutes les inspirations du sens moral. Elle fait, en un instant, de l'homme le plus honnête, le plus sage, le plus calme, un insensé, un insulteur, un meurtrier. Et si, remontant aux causes de perturbations matérielles extérieures, à l'ivresse alcoolique, par exemple, nous cherchons l'effet qu'elle produit sur le sens moral, nous voyons qu'elle le paralyse et l'enchaîne à un tel point que l'homme vire, n'ayant plus conscience de lui-même, de sa dignité, de ses devoirs, s'abaisse jusqu'aux dernières limites de la dégradation et du crime. Or, qu'est-ce que le narcotisme du tabac, sinon l'ivresse lente, continue, chronique qui, agissant sur tous les centres nerveux à la fois, doit produire des perturbations inévitables dans le sens moral, comme elle en produit dans toutes nos autres facultés sensitives? Ivresse spéciale, qui ne manifeste pas instantanément ses effets démoralisateurs, parce que l'homme ne pourrait la pousser jusqu'aux limites extrêmes où elle l'égare, sans s'exposer à la mort, par un empoisonnement subit. D'ailleurs, en même temps qu'elle jette le désordre dans le sens moral, elle paralyse toute action musculaire; et le bras serait impuissant a servir l'instinct qui le pousse à la perpétration du crime. On le voit, c'est le contraire de ce qui se passe dans l'intoxication alcoolique, où la force musculaire se maintient et s'exalte, à mesure que la raison disparait dans les vapeurs de l'ivresse. Si l'ivresse narcotique est moins démonstrative, moins tapageuse dans ses effets que l'ivresse alcoolique, elle n'en est pas moins profondément désorganisatrice et démoralisante. Ce que l'une fait par intermittence et par accès, l'autre le fait par lenteur et continuité. L'ivresse narcotique, ou nicotineuse, assombrit le caractère de l'homme; elle fane la fraîcheur de sa jeunesse, en intervertissant en lui, par une sorte d'aberration permanente, toutes les inspirations du sens moral. [Plus en anglais, par Edison]. Elle substitue, par exemple, la haine à l'amour, l'égoïsme à la générosité, la rancune à la clémence. Elle égare la raison dans le discernement du bien et du mal, et fait que, dans ses caprices, elle prend souvent l'un pour l'autre. La pathologie moderne, qui enregistre toutes ces anomalies inconnues autrefois [p 346], les désigne sous le nom de névrosisme, état nerveux, névropathie protéiforme. C'est un état maladif général, indéterminé, nerveux, caractérisé par des troubles les plus variés dans l'intelligence, la sensibilité organique, le mouvement. Le névrosisme est moins aigu que chronique. Il varie entre l'agacement nerveux, qui en est le premier symptôme, jusqu'aux désordres fonctionnels les plus nombreux et les plus graves. C'est l'inquiétude et l'impatience morale, la fatigue de tout, l'indifférence pour tout; ce sont les étouffements, les palpitations, le hoquet, la toux nerveuse, les hallucinations, l'insomnie, les soubresauts, la frayeur. Ils font du malheureux nicotiné, non seulement un hypocondriaque, mais encore un hystérique; car il a tout le cortège des symptômes qui constituent cet état maladif qui n'appartient qu'à la femme, et qui s'appelle aussi, chez elle, crises de nerfs, vapeurs. Cet état de malaise, les consommateurs de tabac le dépeignent parfaitement eux-mêmes. Quand on leur pose cette question: «Pourquoi fumez-vous?» Ils vous répondent presque tous: «Je fume pour me distraire.» D'autres vous diront: «Je fume pour me délasser.» Ils sentent donc l'ennui et la fatigue, ces jeunes gens, ces hommes mûrs, qui sont sous la domination du tabac? S'ennuyer et être fatigué, quand on est en plein épanouissement de la jeunesse! S'ennuyer et être fatigué, dans la société d'une jeune femme que l'on a choisie pour compagnie de sa vie!—car on fume dans l'intimité du ménage . . .—S'ennuyer et se fatiguer, quand on a sous le bras une charmante jeune fille, à qui l'on parle d'union et d'avenir . . .— car on fume, quand on promène dans le monde sa fiancée . . .—S'ennuyer et se fatiguer partout et toujours, au milieu de la vie, où l'homme a bien plus de satisfaction que de misères! . . . Non! ce n'est pas là un état normal . . . Ce sont les symptômes d'une maladie physique et morale [abulia]. De là naissent les bizarreries de caractère, les monomanies, les folies lucides, dont on trouve les types les plus variés et les plus originaux parmi les fumeurs. C'est à cette catégorie de dégénérés que s'adresse le docteur [Ulysse] Trélat [1795-1879], dans son Traité de la folie lucide [Paris: A. Delahaye, 1861], page 7, quand il dit:
Partout, l'attention des médecins s'attache aujourd'hui à constater ces maladies d'un ordre tout nouveau. Le docteur Weir Mitchell, dans sa clinique sur les maladies nerveuses, dont il est spécialement chargé à l'hôpital de Philadelphie, reconnaît que ces affections, que ne mentionnent pas assez les traités de pathologie, deviennent de plus en plus fréquentes; et que, contrairement à ce qui devrait exister, d'après la différence de constitution entre les deux sexes, elles sont infiniment plus nombreuses et plus graves chez l'homme que chez la femme. Et, comme nous, il n'hésite pas à en attribuer la cause la plus directe aux effets du tabac, dont les dames américaines ont assez de bon goût et de raison pour ne pas user, sous aucune forme.
Aimer la vie, se cramponner à toutes ses aspérités, à toutes ses amertumes, plutôt que mourir, c'est la loi naturelle. Et le suicide ne se concevrait que dans ces moments suprêmes de l'existence où l'homme, pousse par un sentiment d'honneur, cède au besoin de mourir pour se soustraire à une honte ou à une infamie. Le suicide s'expliquerait encore chez ces êtres à esprit faible qui, manquant de courage pour supporter des déceptions dans leurs affections ou des ruines dans leurs intérêts matériels, aiment mieux ne pas être que de souffrir. C'étaient là les causes ordinaires et presque justifiables du suicide qui venait assez rarement, autrefois, nous rappeler les faiblesses d'esprit et les défaillances morales de notre pauvre humanité. Mais sous l'age du tabac, l'homme engourdi dans la vie semble insensible à ses jouissances. Tout lui pèse, tout l'ennuie. Sans affection pour quoi que ce soit, il tombe dans l'hypocondrie, le découragement, l'apathie. Il ne tient plus à rien, pas même à lui; la seule chose au monde qu'il aimait, son tabac, le dégoûte, et, un beau jour, sans raison aucune, souvent quand il a tout ce que tant d'autres lui envieraient pour les rendre heureux: la famille, le rang, la fortune, il se tue! Cherchez pourquoi! On serait tenté de croire qu'il a cédé à une impulsion de la nature et de sa conscience, qui lui ont dit:
Car c'est là que recourent ces malheureux pour eu finir avec la vie. Et les statistiques nous montrent que le nombre des suicides, depuis 1830 jusqu'à nos jours, a suivi la progression toujours ascendante de la consommation du tabac. Il est à remarquer que généralement ces pauvres maniaques mettent de l'ostentation dans le crime qu'ils commettent sui eux-mêmes, et visent à l'effet dans leur fin tragique. Comme les suicidés vulgaires, ils ne se cachent pas, par sen- timent de la honte qu'ils éprouvent à commettre un acte bas, que la morale et la dignité humaine réprouvent. Ils cherchent, au contraire, après leur mort, à exciter la curiosité ou les émotions publiques, comme s'ils avaient fait, en se tuant, quelque chose de grand, de beau. J'ai reçu, à Paris, au mois d'août 1870, les confidences d'un de ces malheureux nicotines que tourmente sans cesse le mauvais génie du suicide, avant qu'ils ne succombent à ses sinistres conseils. C'était un capitaine de la marine marchande, grand fumeur, comme sont généralement ces messieurs, et que j'avais beaucoup connu en Amérique.
Il n'y avait pas huit jours que j'avais appris l'histoire de mon capitaine, que je viens de raconter, qu'un matin, en entrant dans la rue de Rivoli, par la rue de Castiglione, je me trouvai en face d'un pendu. Le malheureux, pour mieux se donner en spectacle, avait choisi, pour s'accrocher, un des barreaux de la porte de fer du jardin des Tuileries qui fait face à la colonne Vendôme. La foule formait cercle autour de ce lugubre spectacle, pendant qu'on attendait la justice pour faire ce qu'on appelle administrativement «la levée du corps». C'était un monsieur en toilette recherchée, à beau linge, à bijoux, bien ganté. Il pouvait avoir de trente à trente-cinq [30-35] ans.
Il avait été si prompt à s'exécuter, au point du jour, que les factionnaires de la terrasse des Tuileries ne l'ont aperçu que quand il était sans vie. L'enquête que la justice fit sur les lieux constata qu'il s'était bien volontairement donné la mort. A côté de son chapeau, sur le perron de la grille, était un cigare à moitié fumé. Il avait en portefeuille des sommes importantes qui constataient qu'il ne s'était pas tué par dénûment. Son porte-cigares était garni de fins havanes qu'il devait consommer largement, à en juger par ses dents rares, écornées et noircies en forme de clous de girofle. Il avait, du reste, en lui tous les signes apparents du nicotisme.
Non, ce malheureux n'avait pas usé les jouissances de la vie, qui sont infinies autant qu'inépuisables. A peine peut-être en avait-il effleuré quelques-unes; car toujours, pour celui qui n'a pas déchu dans la faculté de sentir, à côté d'une douleur, il y a une joie; à côté d'un dégoût, un désir; à côté d'une déception, une espérance. Ce qu'il avait usé, ou plutôt ce qu'il avait dégradé en lui par le narcotisme de tous les jours, c'est le centre nerveux, d'où émane son impressionnabilité. Et, de même que le paralysé des yeux ne sent pas la lumière, qui pourtant l'inonde, de même le narcotisé du tabac s'agite comme un automate insensible au milieu des scènes les plus animées, les plus enivrantes de la nature et de la vie. Il n'en jouit pas. C'est là qu'il faut aller chercher la vraie cause du plus grand nombre des suicides. Cette folie nous envahit comme une épidémie. On se suicide de toutes parts, dans toutes les classes sociales. Qu'on ne dise pas que c'est par imitation. Si l'on fume, par exemple, le plus souvent, pour imiter les autres, on ne se pend pas pour avoir entendu dire qu'un autre s'est pendu. L'instinct de notre conservation nous interdit, cette copie fantaisiste. C'est par similitude d'état maladif, par similitude d'aberration du sens moral, provenant d'une même cause, que tous ces insensés qui se tuent sont poussés fatalement au même but.
On lit dans l'Électeur du Finistère:
Dans les journaux de Paris, on lit:
Et M. A. L..., so tirant un coup de pistolet au cœur, à la salle d'attente de Lyon, parce qu'une de ces mêmes dames, qui partait pour Marseille, n'était pas disposée à lui donner un moment d'entretien? On va dire peut-être que ces deux cas rentrent dans les lois naturelles qui régissent les suicides, les désespoirs d'amour. Non, ce n'est pas de l'amour qu'éprouvaient ces jeunes hommes pour des femmes qui n'échangent leurs faveurs, cent fois fanées, que contre de l'or, et qui jettent à la porte, l'un après l'autre, leurs protecteurs quand elles les ont ruinés. Ils se tuaient par aberration de leur sens moral, ou de leur faculté d'aimer, dégradés par le narcotisme. Ils n'aimaient pas plus ces courtisanes que cet autre halluciné n'aimait le cadavre pour lequel il va cependant se noyer.
Voilà comment passent journellement devant la curiosité publique de longues files de suicidés, sans que l'on puisse s'expliquer pourquoi autant de gens se tuent. Du reste, si l'on en parle beaucoup, on s'en émeut fort peu; parce qu'il entre dans les croyances générales que, la vie n'appartenant qu'à celui qui en jouit, il est libre d'en disposer au gré de ses caprices ou de ses folies. Mais les lois morales et les religions ont moins d'indulgence. Elles proclament que l'homme appartient à l'humanité, à la société, à la famille, avant de s'appartenir à lui-même, et elles réprouvent, avec raison, tout attentat qu'il peut faire contre sa vie. Si la dégénérescence, par la cause fatale que nous insistons a signaler, le narcotisme du système nerveux, n'était pas à l'ordre de notre siècle, ces idées qu'enseignent la morale et la religion contre le suicide, germeraient dans nos cœurs. Elles élèveraient le courage de l'homme que l'adversité ou les déceptions dégoûtent de la vie; et cette manie bête de se détruire disparaîtrait de nos habitudes, comme en aura bientôt disparu le duel, ce suicide à deux, qui devient de jour en jour moins fréquent. Mais la manie grandit dans les mêmes proportions que l'habitude vicieuse d'où elle tire sa cause : l'usage du tabac. Et les statistiques nous enseignent que la moyenne annuelle des suicides qui, pour la France, était, de 1825 à 1830, de 1.739, arrivait graduellement au chiffre de 4.157 pour 1871. Dans la statistique criminelle de la France pour 1872, on lit, dans un paragraphe du rapport du Ministre de la justice:
Dans ce chiffre effrayant de suicides, il n'est tenu compte que de ceux qui ont eu la mort pour résultat. Il n'est pas fait mention des tentatives infructueuses de se détruire, qui sont au moins aussi fréquentes que les suicides réels. On remarquera qu'a l'inverse des statistiques des autres siècles, le suicide est quatre fois aussi fréquent chez l'homme que chez la femme; parce que la femme ne s'adonne pas, comme l'homme, a l'ivresse narcotique qui pousse au dégoût de la vie. De même, on ne saurait expliquer autrement que par la dégradation nicotineuse, agissant comme cause première, une bonne partie de ces suicides vag'uement attribués à la débauche, à l'inconduite, à l'ivrognerie, aux souffrances physiques, aux maladies cérébrales; et de tous ceux dont les raisons n'ont pu être expliquées.
En effet, ces nervures ne sont autre chose que la réunion des gros troncs vasculaires dans lesquels circulent les sucs vénéneux de la plante. Ce sont eux qui résistent le plus à la dessiccation, quand les feuilles sont séparées de la tige. Et, à mesure que la feuille se fane et se resserre, ces liquides refluent vers les troncs, où ils se cristallisent en forme d'extrait fortement chargé de nicotine. Voyez-vous un pauvre conscrit arrivant de sa campagne, où il n'a jamais connu le tabac? Sa nouvelle position le rend naturellement enclin à la mélancolie: il est triste, rêveur. Un ancien s'en aperçoit et l'accoste:
Et le conscrit fume sa première pipe, que suivent, de jour en jour, les autres. De triste qu'il était, il devient naturellement malade, par l'effet du tabac, qui lui bouleverse l'estomac et lui ôte l'appétit. Ces premières atteintes d'une indisposition dont il est loin de soupçonner la cause, car il suppose que la ration de tabac qu'on lui donne est aussi nécessaire à sa santé que la ration d'aliment, le jettent dans une appréhension profonde. Il craint de tomber malade loin de sa famille; l'idée de l'hôpital lui fait peur. Et, sous l'empire de ces causes morales, autant que par le narcotisme du tabac, ses forces nerveuses s'affaissent. Il tombe dans les langueurs qui mènent rapidement aux affections typhoïdes, auxquelles succombent tant de jeunes soldats, dans la première année de leur arrivée au corps. Si la force physique résiste, la force morale souvent succombera: car, loin de dissiper la mélancolie, les vapeurs narcotiques du tabac poussent à la tristesse, à l'hypocondrie. Alors, le jeune conscrit, qui cherche la distraction dans la fumée de sa pipe, s'ennuie partout, se dégoûte de tout. Il n'y a plus pour lui ni présent, ni avenir. Il ne se rend pas compte que, dans la position toute transitoire et temporaire dans la- quelle il se trouve, il ne manque de rien; qu'il est bien habillé, bien nourri, bien logé, bien chauffé, et qu'en échange de tout ce bien-être que lui donne l'État, on ne lui demande qu'un peu d'activité, qui ne va jamais jusqu'à la fatigue; car on tient surtout à le préserver des maladies. Il ne se dit pas en lui-même, si parfois cette position l'attriste:
Non, rien ne saurait le sortir de sa mélancolie, et, comme tous les rêveurs que la perversion du sens moral, sous l'influence du tabac, pousse au suicide, il se tue. C'est ainsi qu'en pleine paix, quand le sort du soldat est plus doux qu'il n'a jamais été, les cas de suicide dans l'armée sont si fréquents qu'ils ont motivé la Circulaire suivante, du 13 février 1873, du ministre de la guerre, le général Cissey, aux Chefs de corps des divisions militaires:
Plus tard, pour compléter l'intention du Ministre et flétrir aux yeux de l'armée l'acte du suicide, le général Espivent de Villeboisnet a ordonné que tout homme sous les drapeaux, coupable de s'être donné volontairement la mort, serait inhumé la nuit, sans bruit, et sans que les derniers honneurs militaires et religieux lui fussent rendus. Les généraux commandant les divisions militaires de la France ont été invités, par ordre supérieur, à prendre une mesure semblable, et à la porter à la connaissance de leurs troupes. Et si l'on se suicide autant dans l'armée, là où cette folie devrait avoir le moins de raison d'être, n'est-ce pas surtout parce qu'on y consomme d'immenses quantités de tabac? LE TABAC POUSSE AU CRIME. Ces destructeurs de leur existence, par le suicide, qui sont dans la société une douloureuse anomalie, ne sont pas des ennemis contre lesquels elle ait à se g'arder. Il se tuent sans taire de mal a personne, et, tout ce que l'on peut faire pour eux, c'est de les plaindre et de les absoudre, car leur mort les punit assez de leurs faiblesses.
C'est par ces déshérités des qualités humaines que revient au XIXe siècle la honte de confesser que, malgré la civilisation et ses progrès par l'éducation, la morale, la religion, les arts, le commerce et l'industrie, le flot de la criminalité monte, monte toujours, et dépasse les niveaux des temps les plus mauvais du moyen âge. Ces constatations, ce sont les statistiques qui nous les fournissent, ce sont les fonctionnaires de la justice qui nous les révèlent. Le 15 janvier 1844, Donon-Gadot, banquier, fut assassiné par son fils, dans la petite ville de Pontoise (Seine-et-Oise). C'est dans ce procès si tristement célèbre qu'un magistrat vint effrayer la conscience publique par cette épouvantable révélation:
Considéré dans la société antique comme un crime inouï, le parricide n'était pas même prévu par les législations de la Grèce et de Rome, qui ne voulaient pas croire à sa possibilité. Souvenirs judiciaires: L'Histoire, 16 juin 1870. En mars 1870, M. Emile Oilivier, dans son rapport à l'Empereur sur le compte général de l'administration de la justice criminelle, concluait ainsi:
Le rapport du Ministre de la justice constate un fait qui frappe tout le monde et que tout le monde déplore: c'est la succession sans relâche de ces grands crimes où l'homme, obéissant aux mêmes penchants que la bête fauve, tue pour le plaisir de tuer, s'abat de toute la cruauté de ses instincts sur la société, comme sur une proie, et, repu de meurtre, vient cyniquement dire à la justice.
Demandez-lui pourquoi il a commis ces crimes; le plus souvent il n'en connaît pas la cause, ou il cherche à la découvrir dans les raisons les plus futiles. Il est comme ces malheureux dont nous venons de parler, qui se suicident sans savoir pour quel motif ils le font. C'est au point que la justice, qui, pour baser ses arrêts, remonte toujours au mobile des crimes; souvent n'y trouvant pas de causes réelles, déroge à sa sévérité contre des criminels qu'elle ne peut pourtant pas absoudre comme des fous; car, à part leur penchant fatal pour le meurtre, par dépravation de leur sens moral, ils jouissent de toute la lucidité de leur esprit. La spécialité de ces criminels, d'origine toute moderne, semblerait donc attendre de la société et de nos codes une classification et une législation exceptionnelles, pour punir et réprimer leur perversité. Mais, au lieu de punir, no vaudrait-il pas mieux réformer et prévenir? Et c'est là que la société, au lieu de ne voir dans ce g'enre de criminels qu'une innovation, qu'une anomalie,. devrait remonter à la cause toute exceptionnelle de ce mal. Et c'est aussi là qu'elle pourrait se demander, comme ce magistrat, dans le procès Donon-Cadot:
Dans le rapport dont nous venons de parler, le Ministre de la justice, envisageant ces causes comme d'essence purement morale, fait, pour en fermer l'abîme, un appel à l'éducation delà famille, aux conseils de la religion, à la vulgarisation des bons exemples, par l'abnégation, l'amour, le dévouement, par tout ce qui constitue la vertu; et il semble désespérer de la punition comme moyen préventif. Mais notre jeunesse se nourrit abondamment de tout ce qu& conseille le Ministre, depuis déjà des siècles. Ces crimes, d'ail- leurs, ne viennent pas essentiellement du manque d'éducation ou de l'ignorance, car ils surgissent également de tous les milieux de la société. Ce n'est donc pas dans l'ordre moral qu'il faut en rechercher les causes; c'est plus bas qu'il faut descendre pour les trouver. Il faut les étudier dans l'ordre physiologique. L'ordre physiologique repose sur le corps, comme l'ordre moral repose sur l'âme. Dans nos mœurs et nos institutions, nous subordonnons trop la matière à l'âme, nous négligeons trop le corps pour cultiver l'esprit. Je sais bien que l'administration s'occupe beaucoup d'hygiène publique; mais, absorbée dans les généralités, elle est souvent indifférente dans les détails les plus importants. Elle veille sur l'enfance; elle institue les crèches, les salles d'asile, les orphelinats, pour ceux à qui pourraient manquer les soins de la famille. Elle a une législation (loi de 1841, loi du 10 mai 1874) pour protéger les petits travailleurs contre la dureté ou la cupidité des patrons qui seraient tentés d'abuser de leurs forces physiques. J'ai vu, tout récemment, qu'une ordonnance de police défendait aux cafetiers de recevoir chez eux des jeunes gens au-dessous de dix-huit ans. L'Assemblée nationale vient de faire une loi qui punit l'ivresse; des mesures de police ferment, à certaines heures du soir, les débits de liqueurs: tout cela est très moralisateur, sans doute; mais, malgré tout, le niveau moral ne paraît pas monter. Pourquoi? C'est que l'administration, toute soigneuse quelle est de préserver l'enfance et la jeunesse contre les écueils sur lesquels elles pourraient se heurter, ne les écarte de Carybde que pour les laisser naufrager sur Scylla. L'écueil où l'enfance et la jeunesse se perdent, c'est le débit de tabac. Quand les cabarets et les cafés se ferment, lui ne cesse d'attirer les passants aux feux presque sinistres de sa lanterne rouge. Il est toujours ouvert, à toutes les heures et à la clientèle de tous les àges. C'est là que, trop souvent, l'enfant vient apporter à l'État, en échange du plus violent de tous les poisons, le sou que la charité lui a donne pour acheter du pain. Soyons juste pourtant dans notre blâme, et disons qu'il est des administrations assez convaincues do l'effet destructeur du tabac sur la jeunesse, pour en interdire rigoureusement l'usage dans les établissements d'enfants qu'elles dirigent. Il y a quelque temps, j'allai à Brest pour m'embarquer pour l'Amérique. Mon premier désir, en arrivant dans ce port, que je n'avais pas vu depuis près de quarante ans, fut d'aller visiter l'hôpital Saint-Louis, où j'avais commencé mes études médicales et où j'allais chercher des souvenirs de jeunesse. L'hôpital de la marine avait disparu de son ancien emplacement, qui est aujourd'hui affecté à une institution toute spéciale. Dans les cours où se promenaient autrefois les malades s'élève un navire tout armé, tout gréé, destiné à l'instruction de plusieurs centaines d'enfants: les Pupilles de la marine, qui occupent tout ce vaste local, transformé en école navale. Plusieurs de ces enfants m'abordèrent en me demandant de leur donner du tabac.
Si l'on est si soigneux, dans cet établissement, d'empêcher le tabac de flétrir la jeunesse de ces enfants, c'est que l'on comprend l'intérêt qu'il y a, pour l'État qui les élève, d'en faire des hommes capables de le servir. Pourquoi alors ne pas appliquer cette mesure salutaire à tous les enfants de la France, qui sont, eux aussi, comme les Pupilles de la marine, destinés a devenir un jour les défenseurs de leur pays, qui a tout intérêt à ne pas les voir s'abâtardir par le narcotisme? Autrefois, de rares entants se cachaient pour fumer. Il semblait qu'ils avaient la conscience qu'ils faisaient une action honteuse. Et aujourd'hui, vous les voyez par groupes dans les carrefours, dans les rues, dans les établissements publics. Ils ont de huit à douze ans [8-12], et joutent, comme par un apprentissage, à qui supportera le plus crânement la nausée narcotique du tabac. A seize ans, ils sont passes maîtres: ils fument dans la compagnie des hommes et affichent prétentieusement leur brevet de virilité par l'élégance avec laquelle ils manient indistinctement la cigarette, le cigare et la pipe, sans même reculer devant la chique. Aussi, quels beaux hommes, quels robustes gaillards ça fera! A l'age de la vie où l'appélit est le plus développé, où les forces digestives ont besoin de toute leur énergie pour fournir au corps, par l'aliment, les éléments de sa croissance, le tabac apporte sa perturbation narcotique dans l'organisme. C'est là le sinistre inconnu que les législateurs et les moralistes recherchent pour expliquer tant d'anomalies sociales qui nous débordent. Alors, en effet, commencent les désordres physiologiques dont nous avons parlé, et qui sont le prélude et la cause la plus prochaine des désordres moraux. Le jeune fumeur perd l'appétit, par conséquent il s'alimente moins. Il est délicat, ses goûts sont capricieux, il ne mange pas du tout; il se force plutôt qu'il ne satisfait un désir. Quand il a mangé, soit par l'engourdissement de l'estomac, soit par l'absence de sucs salivaires que les expectorations abondantes ont enlevés aux aliments, il tombe dans un état plus ou moins complet de dyspepsie, et, sa nutrition devenant insuffisante et imparfaite, il éprouve un temps d'arrêt dans sa croissance. Le voilà donc déjà dégénéré dans sa forme, et c'est là une des causes les plus puissantes de l'abaissement de la taille des hommes dans notre société moderne. La dégénérescence physique entraînerait, toute seule, la dégénérescence morale, car c'est là une loi naturelle: quand l'homme déchoit dans l'un de ses deux éléments, corps ou esprit, il baisse aussi fatalement dans l'autre. Cette vérité trouve sa démonstration dans les idiots, les crétins, les infirmes. Mais l'action du tabac, qui influe si fâcheusement sur la croissance du corps, a une influence bien plus directe et plus rapide sur le système nerveux. Dans ces jeunes organisations si impressionnables, le narcotisme engourdit, dans ses lourdes vapeurs, les facultés de l'intellect, et toute la vie, corps et esprit, tombent en langueur. Les malheureux enfants le sentent bien. Ils sont sans forces et sans énergie; la fièvre d'intoxication les abat et les altère, et, pour étancher leur soif et remonter leur vigueur, ils courent à la buvette, qu'elle s'appelle café, cabaret, caveau, estaminet, peu importe. Et là, les consommations qu'ils préfèrent sont les breuvages alcooliques. Ils sont, en effet, l'antidote, le contrepoison du tabac. Et aussitôt qu'ils se désaltèrent dans ces boissons ardentes, ils sentent qu'elles leur font du bien, qu'elles les fortifient. C'est ainsi que l'habitude de fumer mène au besoin de boire, qui devient bientôt un plaisir. Voilà donc ces adolescents dominés par deux passions, dont l'une pousse nécessairement à l'autre, car c'est presque un axiome: Tout fumeur est buveur. Ils passent de longues heures de leur existence dans un état passif, expérimentant dans leur organisme, comme dans une cornue, les effets de deux poisons qui semblent s'atténuer sans jamais se neutraliser l'un par l'autre. Ils passent alternativement du narcotisme du tabac à l'ivresse de l'alcool. Les deux adversaires, dans ce duel, nicotine et alcool, ne succombent jamais, car on prend bon soin de les renouveler quand ils s'épuisent. Ce qui est ravagé dans cette lutte de tous les jours, de tous les instants, comme le sont tous les champs de bataille, c'est l'organisme, qui se trouve dévasté par les deux poisons, quand ces adolescents se sont faits hommes, si toutefois ils y arrivent, car la mortalité est grande dans cette transition sous un pareil régime. A quelque classe sociale qu'appartiennent ces jeunes sujets voués à l'habitude du tabac, déchus dans leurs qualités physiques comme dans leurs facultés intellectuelles et morales, ils perdent successivement toutes leurs énergies: ardeur au travail, amour pour l'étude s'évanouissent en eux. Ils n'ont pas cette ambition innée chez tout adolescent qui entre dans la vie, de s'y créer une position, un rang, par une profession mécanique, artistique ou intellectuelle. Dans rengourdissement de leur organisme, ils deviennent incapables de toute application sérieuse. Ce qu'ils recherchent, c'est le repos et la rêverie vague, sans but, qui sont les deux manifestations du narcotisme. S'ils sont assez favorisés pour avoir une fortune patrimoniale tout acquise, ils la dissipent ou la gèrent mal; et, s'ils n'en ont pas, ils sont incapables de trouver en eux-mêmes les moyens de pourvoir honorablement à leur existence. C'est alors que ces frelons de la ruche humaine, qui se sont toujours tenus à l'écart du travail, réveillés par le sentiment du besoin, veulent avoir, eux aussi, parmi les heureux de ce monde, un rang qu'ils n'ont pas su conquérir en se rendant utiles. Ils se posent en déclassés, en incompris, en déshérités par l'injustice ou le mauvais fonctionnement des institutions sociales; et, de parasites qu'ils étaient de la société, ils en deviennent les ennemis. C'est dans ces cerveaux fermés aux idées justes, et où fermentent encore quelques forces intellectuelles en délire, que prennent naissance, dans la confusion du bien et du mal, toutes ces théories subversives de l'ordre social dans ses bases matérielles et morales. Beaucoup d'entre ces rêveurs excentriques attendent du triomphe de leurs idées une position meilleure. Ceux-là ne sont dangereux que par l'ascendant qu'ils prennent sur des masses d'aussi dégénérés qu'eux, qu'ils égarent. D'autres, moins platoniques dans leurs aspirations, sont tourmentés du démon de la convoitise: tout ce qu'ils voient aux autres leur fait envie; ils veulent, par tous les moyens, s'en rendre maîtres et jouir. C'est de cette catégorie de dégénérés que sortent les vagabonds, les escrocs, les voleurs, les faussaires, les assassins, qui, de nos jours, viennent si largement apporter leur tribut à ce que l'on appelle le flot toujours montant de la criminalité. Dans ces natures, qui sont, pour la société qui les produit, une humiliation et un danger, il n'a fallu souvent que quelques années de l'effet dégradant du tabac sur leur organisme pour stériliser et détruire tout ce que la civilisation, l'éducation de famille, la morale de l'Église, l'enseignement de l'école, avaient jeté de germes de qualités humaines dans des âmes primitivement pures, et pour les abaisser, par dégénérescence, aux plus mauvais instincts dos âges de barbarie: la rapine et le meurtre. Comme type de la première catégorie de ces dégénérés, on peut citer Ferré, dit le Petit-Sergent, devenu le délégué de la sûreté générale de la Commune, dans les folies révolutionnaires de 1871, et qui finit sa triste existence par une exécution militaire aux buttes de Satory.
C'est un parfait modèle de nicotine précoce. Sa taille est rabougrie, son teint est terreux, son œil hagard. Il marche a la mort comme un halluciné, tirant avidement les longues bouffées narcotiques de son cigare, qui ne tombe de sa bouche que quand les balles l'ont frappé. La Gazette de Paris trace de Ferré le portrait suivant:
Combien ne pourrait-on pas citer do ces misérables qui, dans nos troubles civils de cette époque douloureuse, cherchèrent à couvrir de raisons politiques les crimes les plus odieux de droit commun? En marchant à la mort, devant les pelotons d'exécution militaire, ne semblent-ils pas tous narguer la justice des hommes, en jetant à sa face les bouffées de leur tabac? La pipe à la bouche, ils demandent à l'ivresse qu'elle leur donne une contenance devant le supplice, comme ils y puisaient, dans le passé, l'entraînement et la férocité pour commettre leurs crimes.
Je trouve, dans mes souvenirs, un de ces nicotines féroces qui tuent pour les motifs les plus frivoles, pour les intérêts les plus insignifiants. C'était vers 1842. J'avais pour voisin de campagne, dans la banlieue de Toulon, au quartier de Malbousquet, une famille de pauvres gens, du nom de Ferrandin, gagnant leur vie par le travail des champs. Je remarquai un jour leur jeune fils, de seize a dix-huit ans, fumant, avec tout le chic d'un vieux matelot, une belle pipe en terre rouge, montée sur un long tuyau élastique, roulé autour de son bras, en forme de serpent.
L'enfant devint homme, usant de plus en plus du procédé économique qu'il avait trouvé pour se dispenser d'apporter son impôt à la Régie. Mais, à mesure que la passion du tabac le gagnait, elle le détachait de l'habitude du travail. Elle pervertit en lui toutes les qualités humaines; il devint bête fauve. II vint un temps qu'on ne parlait plus, aux environs de Toulon, que de vols et de meurtres. On assassinait dans les maisons de campagne, on assassinait sur les grandes routes. La police était aux abois; la terreur était partout; on n'osait plus sortir lorsque tombait la nuit. Un matin, cette sinistre nouvelle courut comme un glas de mort dans les populations consternées:
Une jeune fille de dix-huit [18] ans, l'unique enfant de la famille, avait échappé à ce carnage, comme par une volonté de la Providence, pour apporter la lumière dans ces grands crimes, où les auteurs se cachent et se dérobent au châtiment. Toute la famille avait été, la veille, passer la soirée chez des voisins, à quelques centaines de pas de distance. La jeune fille y avait une amie de son âge; et, quand l'heure de se retirer arriva, elle dit à sa mère:
Et la pauvre enfant qui, dans quelques heures, allait être orpheline, donnait un dernier baiser à sa mère, en lui disant:
En effet, la jeune fille fut, le matin, la première éveillée du quartier, et rentrait, toute joyeuse, à la maison paternelle. Elle en était tout près, et le chien qu'elle appelait ne venait pas à sa rencontre; sa vieille grand'mère, toujours si matinale, n'avait pas encore ouvert la croisée de sa chambre donnant sur le jardin, pour se réchauffer, selon ses habitudes, aux premiers rayons du soleil levant. Devant ce silence inaccoutumé, la pauvre enfant se sent tout à coup saisie d'un pressentiment sinistre. Elle appelle son père, sa mère, sa grand'mère; aucune voix ne répond. Elle frappe à la porte, qui cède à la moindre impulsion qu'elle lui donne. Un nuage de fumée sort de l'appartement, et l'aveugle; une odeur de chair brûlée la suffoque. Elle court, affolée de terreur, à la maison voisine; le quartier s'éveille, on accourt; la justice arrive, elle trouve trois cadavres jetés sur un monceau de meubles, le tout à demi consumé; le feu qu'on y avait mis s'étant éteint de lui-même, dans sa propre fumée. Sur ces cadavres est un bâton souillé du sang et des cervelles des crânes qu'il a brisés; le feu l'a respecté. C'est par lui qu'a été commis ce grand crime; c'est lui qui va dénoncer l'assassin.
On va dans les chênes verts, que montre la jeune fille; on y trouve la branche fraîchement coupée qui ressort de la terre, on porte sur ce tronc le bâton ensanglanté. . . C'était bien la tige qui en avait été détachée. Ce jour-là, j'étais dans ma résidence de Malbousquet, qui dominait les jardins de Castigneau, où vivait, dans une petite maison isolée, la famille Ferrandin. Je voyais des gendarmes à cheval galoper dans la plaine et prenant position, comme pour une arrestation importante. Je descendis pour m'informer de ce que c'était; et je vis défiler devant moi la force armée de la justice, conduisant Ferrandin.
cria la foule, qui l'accompagnait au lieu du crime où on allait faire sa confrontation avec les victimes. La justice avait mis la main sur un grand criminel; car des pièces de conviction trouvées à son domicile attestaient qu'il devait être l'auteur de beaucoup d'autres meurtres. La société allait enfin être vengée de tous les méfaits d'unpareil monstre; et chacun se remettait des terreurs que tant de crimes impunis avaient causées, quand, tout à coup, la nuit, on entend partout dire en ville:
Et c'était bien vrai; Ferrandin avait repris sa liberté. Après la confrontation sur le lieu du crime, le cortège judiciaire, procureur du roi en tête, défilait, à la tombée de la nuit, dans un étroit chemin que bordent des champs de vigne. On ramenait triomphalement, à Toulon, l'accusé, pour l'écrouer à la maison d'arrêt. Ferrandin marchait entre deux gendarmes qui le tenaient par les bras; ses poignets étaient garrottés. C'est alors que, de toute la force de son désespoir et de sa colère, il lance à chacun de ses gardiens un vigoureux coup de coude dans les flancs. Les gardiens roulent par terre, et, pendant qu'on cherche a les secourir, car on les croit assassinés, il s'élance et disparaît dans les vignes, sans qu'on puisse retrouver ses traces dans l'obscurité. La force armée battit, pendant plusieurs jours, la campagne ou le prisonnier avait disparu. Tous les gardes champêtres, toutes les polices, tous les parquets des départements voissins étaient en mouvement, et Ferrandin restait toujours libre. Quatre ou cinq jours après son évasion, un chasseur vint, tout tremblant, rapporter au parquet de Toulon qu'à deux liueues de la ville il venait d'être désarmé de son fusil et de ses munitions, par un individu qui l'avait menacé de mort, s'il faisait des révélations. A ce trait d'audace, on reconnut Ferrandin. Cette nouvelle se répandit bientôt dans les villages, qui s armèrent. La place de Toulon fournit, en soldats de toutes armes, plusieurs milliers d'hommes de renfort On organisa une battue en grand, comme pour une chasse à la bête fauve. Plus de six mille hommes, soldats, citoyens armés ou curieux, enveloppèrent d'une vaste ceinture le terrée ou l'on supposait que se cachait l'évadé. Ce cercle immense se resserra sur son centre, par un mouvement d'ensemble. Ferrandin, qui avait choisi pour retraite un petit mamelon boisé d'où il découvrait tout ce qui se passait autour de lui, sans ètre aperçu, se vit cerné par une ligne de baïonnettes, au travers desquelles il ne pouvait espérer se frayer un passage Dans une situation si pressée, tout criminel ordinaire se serait rendu à discrétion à la force de la loi; ou bien se faisant justice a lui-même, aurait tourné contre sa poitrine le fusil qu'il tenait à la main, pour se soustraire à la honte du châtiment qui l'attendait. Mais cette bête fauve, forcé dans son repaire, n était pas encore assez repue de meurtres; il lui fallait toujours du sang. Un officier de police l'approche et lui dit, avec douceur:
L'officier fait un pas, et Ferrandin, d'un coup de son fusil, le tue. Il avait encore un coup de son arme chargé. Son fusil à l'épaule, il allait tuer un autre officier de police qui l'approchait pour le saisir, quand un paysan lui lâcha, en pleine figure, un coup de feu à gros plomb, qui l'aveugla. La bête est abattue; la chasse au meurtrier est finie; et toute l'expédition, consternée du résultat, rentre en ville, à la nuit tombante, ramenant, sur une même carriole de campagne, Ferrandin blessé à mort, étendu à côté du cadavre de l'officier de police, sa dernière victime, qu'il vient d'assassiner. Ferrandin mourut quelques jours après des suites de sa blessure. Il conserva assez long-temps sa connaissance pour faire des aveux et se repentir, s'il lui était resté un peu de sentiments humains. Mais il persévéra dans le plus complet mutisme; les pièces de conviction trouvées chez lui l'ont fait reconnaître coupable de sept assassinats. L'opinion publique le chargeait de bien d'autres. Il tuait au hasard, sans savoir ce qu'une mort d'homme lui rapporterait. Il n'a pas retiré cent francs des sept assassinats qu'on a pu véritablement lui attribuer. Voilà où ont conduit cet homme les bouts de cigares des officiers, qu'il ramassait quand il était enfant. . . Il commença à douze ans sa vie de fumeur et de désœuvré; à vingt-quatre ans, le tabac, pervertissant en lui tous les sentiments qui constituent l'homme, l'avait abaissé, par dégénérescence morale, jusqu'à l'état de monstre. Quelques-uns de ces misérables, moins dégradés dans leur intelligence que dans leur sens moral, savent mettre la férocité de leurs instincts à l'usage de conceptions diaboliques, dont le but est toujours la vie large, aisée, dans l'ivresse, et sans travail, en s'appropriant le bien d'autrui par le meurtre. Dans cette catégorie de dégénérés ressort Troppmann, qui, à vingt [20] ans, rêvait la vie libre de l'Amérique, loin des gendarmes, en y emportant une fortune et un nom qu'il volait à toute une famille, le père, la mère et six enfants, qu'il assassina en trois temps, à plusieurs jours d'intervalle. C'est une des conceptions criminelles les plus larges et les plus monstrueuses que jamais dégradation humaine ait pu tramer. Troppmann vivait en relations de bonne amitié dans le sein d'une honnête famille de Roubaix, la famille Kinck, qui possédait quelques biens. Pour s'emparer de ces biens, il les engagea à venir avec lui en Amérique, où il leur serait facile d'arriver promptement à la fortune par le travail. Ce projet arrêté, il se défit d'abord du père, dans une promenade au bois de Watwiller, où il l'avait conduit. Il le tua avec l'acide prussique, poison presque aussi meurtrier que la nicotine, puis il l'enfouit sous terre. Il se rendit alors à Paris, écrivit à Mme Kinck une lettre où il contrefit la signature de son mari, et qui engageait la malheureuse d'envoyer d'abord son fils aîné, puis de venir les rejoindre avec ses autres enfants, pour leur voyage en Amérique, qui était tout arrêté. L'aîné des fils arrive; Troppmann va à sa rencontre; et, sous prétexte de le conduire à l'hôtel où il trouvera son père, il l'égaré, le soir, dans un quartier isolé de Paris, à Pantin, l'assassine dans un champ et le cache sous terre. Les deux hommes de la famille dont il avait le plus à craindre la résistance dans l'accomplissement de ses projets, étaient morts; et la femme et les cinq enfants se rendaient à l'appel du mari et du père. Troppmann va, comme il avait déjà fait pour le fils aîné, les attendre à la gare; et la nuit il les conduit dans ce même champ de Pantin, où il tue la mère d'abord et les cinq enfants ensuite! . . . . . Il tasse ces six cadavres dans un même trou, les couvre d'un peu de terre et se sauve pour s'embarquer au Havre, emportant avec lui des papiers et des titres avec lesquels il se proposait de se substituer à Kinck et d'absorber plus tard tout l'avoir de cette famille, qu'il avait si horriblement anéantie. Voici, d'après les journaux d'alors, le signalement très exact de Troppmann:
Il y avait dans ce dégénéré tant de la bête fauve qu'au moment où il allait recevoir le châtiment suprême de tous ses crimes, sur l'échafaud, le 19 janvier 1870, se débattant comme un loup pris dans un piège, il mordit l'exécuteur Hendrich, un colosse, qui lui brisa les reins pour lui faire lâcher prise, et le jeta à demi mort sous le couperet, qui l'acheva. Quand on analyse les détails de ces grands crimes, on voit bien que tous ces meurtriers excentriques sont dépossédés du sens humain, et qu'ils agissent par une impulsion qu'on ne peut qualifier que de folie. En effet, tout est désordre dans leurs actes sanguinaires. Ils ne se contentent pas de tuer; comme les bêtes fauves, au rang desquelles la dégradation narcotique les abaisse, ils assouvissent encore sur leurs victimes une rage. Ils déchirent, ils mutilent sans nécessité, par instinct féroce. [Plus, des animaux.] C'est le cas de Garrel, garçon boucher, condamné à la peine de mort par la cour d'assises de la Marne et exécuté à Reims, le 19 janvier 1873. Garrel, après avoir entraîné sa maîtresse dans un bois, lui avait ouvert le ventre pour y mettre la tête de la malheureuse, qu'il avait détachée du tronc. Après avoir commis cette horreur, il a dû, comme un insensé, la contempler avec satisfaction et rire aux éclats de l'originalité du tableau. Pour en finir avec toutes ces abominations, suivons dans les cours d'assises ces dépossédés du sens moral que leur perversité pousse à morceler les corps de leurs victimes, pour mieux arriver à dissimuler leurs crimes. Parmi tant de dépeceurs de femmes qui ensanglantent si souvent les annales judiciaires, voyez ce Barré, âgé de vingt- cinq [25] ans, ce Lebiez, âgé de vingt-quatre; l'un clerc de notaire, l'autre étudiant en médecine! . . . Ils assassinent de concert, à Paris, pour la voler, une malheureuse crémière de là rue Paradis-Poissonnière, la femme Gillet. Ils la tuent, l'un avec un marteau, l'autre avec un stylet, rue Hautefeuille, chez Barré qui lui fait apporter dans sa chambre pour quatre sous de lait. Puis le coup fait, l'instruction nous les montre fumant tranquillement leur pipe en face de ce cadavre, pour trouver dans leur imagination diabolique les moyens les plus pratiques de s'en débarrasser. Ils séparent d'abord les membres de leur victime, dont ils forment deux paquets qu'ils portent dans un garni de la rue Poliveau, où ils ont loué une chambre et où ils ne reparaissent plus. Ils tassent ensuite, par morceaux, la tête et le tronc dans une malle que Barré expédie au chemin de fer, comme bagages, pour Le Mans. Puis, la sinistre besogne terminée, ces deux monstres continuent, comme si rien n'était, leur vie de paresse et de débauche, gaspillant gaiement dans les estaminets l'argent de la crémière. Aux jours de l'expiation, ils sont devant la justice d'une assurance et d'un cynisme qui feraient croire qu'ils n'ont pas la conscience de l'énormité de leur crime. Ils simulent devant les magistrats la scène de l'assassinat et, quand ils ont terminé cette lugubre pantomime, Barré, regardant son complice, lui dit:
Lebiez, haussant les épaules, lui répond:
esprit et leur cœur, ont-ils pu devenir en quelques années des hommes si pervers? Non! . . . Jamais la justice n'aurait tranché ces deux têtes, si le tabac que Barré et Lehiez ont commencé à fumer au lycée d'Angers, effaçant peu à peu leurs aspirations naturelles pour l'étude, le travail et le bien, ne les avait fourvoyés plus tard dans les estaminets de Paris, où le nicotisme, pervertissant leur sens moral et desséchant leur cœur, a fini par détruire en eux tout sentiment humain. La justice a fait son œuvre! . . . Toutes ces têtes coupées inspireront-elles la terreur? Arrêteront-elles par la crainte du châtiment les Billoir, les Vitalis, les Louchard, les Barré, les Lebiez, les Prévost, avenir dans cette voie du crime que nous vovons s'élarg-ir tous les jours devant nous? Non!. . . car la raison, renseignement et l'exemple n'ont pas plus de pouvoir sur l'aliéné du sens moral qu'il n'en ont sur l'aliéné de l'intelligence. Et c'est à la cause la plus directe de cette double aliénation: le tabac, que la société doit s'en prendre pour toutes ces anomalies qui l'affligent et la déshonorent. C'est là qu'est tout le mystère! . . . Car quand, de l'échafaud, les corps de ces criminels arrivent à l'amphithéâtre, les physiologistes, les psychologistes ont beau chercher dans leur cerveau et dans les replis les plus profonds de leurs org-anes, ils ne rencontrent rien, aucune conformation vicieuse qui ait pu être la cause irrésistible et fatale de leurs penchants au meurtre. Mais ce qui ressort invariablement de toute enquête, c'est que ces criminels étaient de grands consommateurs de tabac.
LE TABAC CAUSE DE LA FOLIE. Ces monstruosités, qui sont l'effet du narcotisme chez les individus dont il a perverti le sons moral, ne sont pourtant qu'une exception restreinte dans la grande loi de la dégénérescence de l'homme sous l'influence du tabac. Ces maniaques du suicide et du meurtre n'ont été dégradés que dans une partie de leurs qualités affectives. Chez eux, l'intelligence a peu souffert. Et tant que ces meurtriers ont pu cacher leurs crimes, rien dans leurs rapports avec le monde n'aurait pu faire croire à leur perversité. Mais l'intoxication du tabac ne s'arrête pas à faire des monomanes, des originaux, des excentriques, des monstres. Quand son action est plus profonde, plus continue sur le système nerveux, suivant l'impressionnabilité des sujets, suivant leur idiosyncrasie ou leur disposition d'esprit, elle fait des fous. La folie est une des plus grandes plaies, du moins une des plus apparentes, que l'usage du tabac ait ouverte dans nos sociétés modernes. Les mille infirmités qu'il cause dans notre organisme n'atteignent que l'individu sur lequel elles se sont développées. Quel que soit l'organe qui ait été ruiné par le nicotisme, l'estomac, le poumon, le cœur, la vessie, le malade, à bout de résistance, meurt, et tout est fini. Car il a été seul à endurer des maux qu'il s'est volontairement attirés. Mais l'aliéné est sans conscience de son abaissement et de ses misères. Il ne s'appartient plus à lui-même; ce n'est, pas lui qui souffre. Il est devenu la douleur de sa famille, le fardeau de la société, dont il affecte péniblement le regard par l'exhibition de tant de dégradation humaine, et dont il compromet la sûreté par le déchaînement de toutes les mauvaises passions, que l'intelligence et la raison ne dominent plus, chez ces malheureux dégénérés.
Ces mémos croyances ont provalu dans les époques d'ignorance et de superstition du christianisme. Seulement, au lieu des mauvais génies, on fit intervenir, pour expliquer la folie, le démon; Satan, cette unité qui règne dans l'enfer, substituée à la pluralité des esprits malfaiteurs, comme l'unité de Dieu, au ciel, a été substituée au polythéisme. Sous l'impulsion de ces croyances, le traitement de la folie consistait surtout en certaines pratiques religieuses dans lesquelles entraient l'eau bénite, les signes de croix et les prières, pour produire ce qu'on appelle en théologie l'exorcisme; c'est-à-dire l'expulsion du démon et le retour de l'âme dans le corps de la créature, qu'elle avait abandonnée pour faire place à Satan. Alors, l'aliéné avait des égards qu'on ne lui accorde plus aujourd'hui. Il était quelque chose de vénéré dans la famille; on avait pour lui le respect du malheur. Car on le considérait comme l'esclave du démon, attendant tous les jours sa délivrance d'une faveur toute céleste. Le nombre en était d'ailleurs si restreint, qu'on les laissait errer en liberté au milieu du monde. Seulement les fous violents ou dangereux étaient reçus dans les hospices, où un quartier spécial leur était affecté. Mais la quantité de ces malheureux grandit tellement, sous une influence toute moderne (qu'on ne saurait chercher ailleurs que dans l'usage du tabac), que la société s'en émut et sentit le besoin de prendre des mesures, tant dans l'intérêt de ces tristes créatures, que pour soustraire aux regards les tableaux affligeants de leur déchéance dans l'humanité. En juin 1838 parut une loi sur le traitement des aliénés, portant que chaque département devait avoir un établissement public spécial destiné à recevoir et soigner ces malheureux, ou traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre. Alors les départements se concertèrent ensemble et se divisèrent par groupes; chaque groupe de quatre à cinq départements, par exemple, et dont l'un bâtissait l'établissement et recevait, moyennant une indemnité convenue, les aliénés des autres départements qui composaient le groupe. Cette disposition fonctionna ainsi pendant quelques années; mais la clientèle de ces asiles prit des proportions si rapides, que leur insuffisance permit à une foule d'établissements privés de s'établir à côté d'eux. On lit dans la Statistique officielle des aliénés, publiée en 1866, page 13:
(1) 1870-38.248 — 1880-46.912 — 1890-56.965. E. DECROIX. En 1866, l'administration, frappée du chiffre toujours croissant des aliénés dans les établissements qu'elle pouvait recenser, fit un relevé général, dans toute la France, des victimes de l'aliénation, et elle en constata, au domicile des familles, 18.734, qui, joints aux 31.927 traités dans les asiles, donnent un total de 50.726. A la page 17 de la même Statistique, on lit:
ont été séparés en 1856 et 1861. Voici les chiffres constatés à ces époques:
On voit, par ces chiffres, que la presque totalité des idiots-crétins reste au sein de la famille, et qu'au contraire la plus grande partie des fous sont renfermés dans les établissements spéciaux. D'après la même Statistique, page 23, le nombre total des individus admis chaque année dans les établissements d'aliénés a suivi, à partir de 1835, la marche progressive ci-après:
Ainsi, depuis 1835, le nombre des admissions annuelles sauf quelques oscillations, n'a cessé d'accroître. Si l'on compare 1835 à 1860, on trouve, pour cette dernière année, un accroissement de 6.838, ou de 173 °/o. Tous ces aliénés sont traités dans 97 établissements existant en France, à la fin de 1861. Un appartenant à l'État, 37 dé partementaux; 19 appartenant aux hospices, et 42 établissements privés. Depuis 1861, chaque année a vu s'élever des établissements nouveaux; et aujourd'hui il n'est peut-être pas un seul département qui n'ait le sien lui appartenant en propre. C'est ainsi, par exemple, que le petit département du Var vient d'en construire un immense à Pierrefeu, qui ne tardera pas à être insuffisant pour la nombreuse clientèle qui vient lui demander un asile. Ceux qui s'attristent à l'idée de tant de misères humaines cachées, comme dans autant de prisons, derrière les murailles de ces établissements, grillés de fer, comme s'ils contenaient des criminels ou des bêtes fauves, ne sont pas sans se demander parfois d'où peut venir un accroissement si rapide et si régulier de la folie: qui fait qu'en 1870, par exemple, le nombre des aliénés est quatre fois plus grand qu'il n'était en 1830. Eh bien, de quelque côté qu'ils en cherchent la cause, ils ne pourront la trouver que dans la consommation du tabac, qui grandit avec la même régularité et dans les mêmes proportions que le nombre des fous. C'est ce que démontre le tableau suivant, de la statistique du produit net des tabacs de la Régie. Le tabac a produit en: 1
Devant des rapports si frappants, entre la cause présumée et l'effet, on est d'autant plus obligé d'admettre que le tabac doit être l'origine du plus grand nombre des cas de folie, que, tandis que son usage s'étendait, les causes, en quelque sorte primitives et naturelles de cette affection ont considérablement
diminué, par le progrès de nos institutions et par la transformation de nos mœurs. La folie a deux sources naturelles qui l'ont constamment engendrée: Les lésions organiques ne sont pas, de nos jours, plus fréquentes qu'elles ne l'étaient dans l'ancien temps. Elles devraient, au contraire, l'être bien moins, par les progrès qu'ont faits la chirurgie et la médecine, qui ont plus de moyens qu'autrefois de remédier aux commotions du cerveau, par suite de coups et blessures, de même qu'aux congestions et aux inflammations de cet organe, par suite de maladies. Quant aux causes morales, les plus fréquentes étaient les déceptions dans les affections, l'insuccès, les revers dans les affaires d'intérêt. Or, peut-on dire qu'aujourd'hui le cœur des hommes est plus sensible qu'autrefois à l'amour et à la jalousie, par exemple, qui sont les plus grands perturbateurs des intelligences, même les plus fortes? Assurément non! Il y aurait, au contraire, dans notre époque, une tiédeur bien marquée pour les convoitises des hommes à l'égard des femmes. On se marie peu; et le célibat s'infiltre, dé plus en plus, dans nos mœurs. L'amour diminuant, la jalousie, qui en est la conséquence, doit diminuer aussi; et, par rapport à ces deux causes qui s'affaiblissent, la folie, qui en émane si souvent, devrait avoir une marche décroissante parmi nous. Mais les statistiques nous démontrent combien il est loin d'en être ainsi. Sous le rapport des intérêts matériels, des affaires proprement dites, les sociétés modernes sont beaucoup plus favorisées qu'elles ne l'étaient autrefois. L'abolition des privilèges et des castes, l'égalité des droits de tous les citoyens à participer au bien-être général et aux affaires publiques, suivant leurs capacités ou leur mérite personnel, ont fait disparaître de parmi nous un grand nombre de souffrances matérielles et morales d'où, bien souvent, devait naître la folie.  (pp 352-365) A mon passade dans cette ancienne colonie française, en 1875, les établissements d'aliénés des grandes villes, Kingston, Montréal, Québec, étaient tellement encombrés, qu'il fallait recourir aux prisons pour pouvoir donner asile à tant de malneureuses créatures, réduites a cet abaissement par l'usage du tabac devenu le passe-temps le plus recherché par toutes ces populations, hommes et femmes, que le froid tient sans travail et consignées auprès du feu pendant six mois de l'année. En France, nous mettons volontiers sur le compte de l'absinthe, pour qui nous avons une faiblesse trop marquée, toutes tes dégradations de notre organisme. C'est là une grande erreur qui ressort de ce fait: aux États-Unis on connaît à peine ce breuvage, et l'on y compte peut-être plus d'aliénés que chez nous, par la seule raison qu'on y fume tout autant et que l'on y chique davantage. Si l'alcoolisme était la cause de la folie, chez l'homme, la France, qui est un des pays où l'on compte le plus d'aliénés, serait celui où l'on devrait en rencontrer le moins, car elle est la plus sobre de toutes les nations, s'il faut en croire la Tribune médicale, à qui nous empruntons les réflexions suivantes:
De toutes ces observations, il résulte qu'il ne faut pas attribuer à l'alcoolisme cette plaie de la folie qui nous envahit de plus en plus, parcelle raison surtout qu'avant l'extension de l'usage du tabac, on buvait beaucoup, et qu'il y avait fort peu de fous. La cause la plus vraie, la plus énergique de ce fléau, c'est donc le tabac. Et si l'alcoolisme pouvait jouer un rôle quelconque dans cette dégradation de notre organisme et, par suite, dans l'a baissement des sociétés modernes, il reviendrait encore au tabac une grande part de ce mal causé par l'alcool, car c'est tabac qui pousse aux liqueurs fortes, comme antidote de se effets toxiques. [Plus, en anglais]. Ainsi que nous l'avons plusieurs fois démontré: on devient buveur parce qu'on est fumeur. Nous insistons à bien établir ici le rôle que joue réellement l'alcool dans les dégénérescences humaines, parce que les fanatiques du tabac ou les intéressés à nier ses propriétés dégradantes sont généralement portés à attribuer à l'alcoolisme, et à lui seulement, tous les effets démoralisateurs qui ne viennent pourtant que du nicotisme. Si c'était l'alcool, et non le tabac, qui pervertit le sens moral d'une nation ou d'une race, est-ce que l'Allemagne, par exemple, serait jamais devenue, dans moins d'un siècle, le peuple le plus immoral et le plus dégradé de l'Europe? L'Allemand est en général très sobre d'alcool. Il étanche soif que lui donne sa pipe, toujours pendante à ses lèvres, dans sa petite tisane nationale d'orge et de houblon, son lager bier, dont il faudrait distiller bien des chopes pour en extraire des quantités d'esprit suffisantes pour le griser. Et pourtant ce peuple dégénère, et tombe dans un abîme d'immoralité dont il s'effraie lui-même. Auxjours de l'invasion, nous avons vu toute cette race allemande, sans dignité militaire, sans esprit chevaleresque, qui font le mérite et la gloire d'une nation victorieuse, se ruer sm la France comme des bandes de malfaiteurs. L'histoire dira ce qu'ils ont été chez nous. Écoutons-les dire eux-mêmes ce qu'ils sont aujourd'hui chez eux, après qu'ils ont quitté notre pays, repus de nos richesses. Vous verrez que ces puritains qui trouvent à la France tant de vices, diront qu'ils se sont corrompus à notre contact, comme s'ils ne l'étaient pas avant, quand ils sont venus chez nous pour nous moraliser, comme le déclamaient alors leurs pamphlétaires,  (pp 368-371)
Voilà donc l'élite de la population allemande qui confesse enfin et qui découvre aux yeux du monde les plaies hideuses, l'immoralité profonde de cette Allemagne, jadis si fière de ses vertus, comme nous l'avons été des nôtres, et qui n'échappe pas plus que nous, pas plus que n'échapperont les sociétés envahies par le tabac, à l'action dégénératrice et démoralisante du nicotisme. LE TABAC EN CAUSANT
Nous avons passé en revue les ellets du tabac sur l'individu adonné à son usage; nous avons vu quelle grande variété de désordres il apporte dans l'organisme, et la multiplicité des êtres qui s'en trouvent plus ou moins affectés ne saurait avoir que des conséquences funestes sur la société en général. Car si tout consommateur de tabac soutire par un dérangement quelconque apporté dans sa constitution, par l'eiïet du poison qu'il absorbe journellement, il perd de sa perfection dans son individualité, et, appelé à se continuer dans l'espèce par la génération, il ne saurait donner naissance qu'à des êtres imparfaits comme lui. C'est ainsi que, de la dégénérescence de l'individu, découle fatalement la dégénérescence de l'espèce. Il est dans la nature deux lois fondamentales qui régissent la vie universelle. La première fait que les êtres parfaits dans leurs types augmentent en nombre par la reproduction. La seconde veille à la conservation de l'intégrité de ces types, à quelque règne qu'ils appartiennent, animaux ou végétaux. Par cette loi, tout être dégénéré qui se reproduit donne naissance à de plus dégradés que lui, jusqu'à ce qu'à une génération très rapprochée, ces êtres déclassés soient frappés de stérilité et s'éteignent, arrêtant ainsi leur tendance vers la monstruosité, dans laquelle se perdraient, sans cela, tous les types créés. Dans l'espèce humaine, ces extinctions par stérilité, quand elles sont nombreuses, ont pour effet immédiat l'arrêt ou la diminution dans l'accroissement de la population. De sorte que, dans toute société où ces deux faits seront constatés, on pourra dire, avec certitude, que cette société dégénéré. Or, en France, où le bien-être matériel, qui devrait être la source de la fécondité des peuples, s'accroît de jour en jour, la statistique, depuis plus d'un demi-siècle, nous démontre successivement que la population augmente peu, qu'elle ne croît plus, qu'elle diminue. L'arrêt et la décroissance du chiffre de notre population ont pour point de départ: 1° La rareté des mariages; 2° La stérilité plus ou moins grande de ces mariages: 3° La mortalité des enfants; 4° L'abaissement du terme moyen de la vie, du jour de lit naissance à la mort. 1° En traitant de l'action du tabac ou de la Priapée sur le sens génital (page 194), nous avons exposé les vraies causes de la rareté des mariages et de leur stérilité, que l'on ne peut attribuer qu'a l'indifférence que les fumeurs ou les chiqueurs éprouvent pour la société des femmes. La nicotine, qui engourdit les facultés de l'homme, abaisse nécessairement le diapason normal de sa force vitale et le tient à l'état constant de valétudinaire, ne vivant qu'avec une partie de ses énergies, puisque l'autre s'use dans la lutte incessante de neutralisation du poison du tabac qu'il absorbe journellement. Et ce valétudinaire, quel que soit l'organe ou le système qui se trouve affecté chez lui, est triste, mélancolique, hypo- condriaque, solitaire, découragé, égoïste. Il n'a pas de ces aspirations, de ces besoins innés dans une organisation normale et saine qui le poussent au but le plus marqué, le plus naturel de l'existence: sa continuité par la génération. Les troubles nerveux qu'il éprouve, et dont il ne se rend pas compte, viennent souvent aussi le faire désespérer, à la fleur de l'âge, de pouvoir avancer longtemps dans la vie. Que faire alors d'une famille qu'il ne se sent pas assez de courage, assez de forces physiques et morales pour supporter; qui sera malheureuse, s'il vient a lui manquer avant le temps? Et toutes ces réflexions d'une âme défiante d'elle-même et égoïste dominant ses facultés d'aimer, déprimées par la nicotine, le poussent décidément à préférer le célibat au mariage. 2° Et, s'il se marie, l'action dépressive du tabac sur ses sens et son organisme génital le rendra indifférent et tiède dans ses manifestations érotiques, d'abord. Et, ensuite, l'influence stupéfiante et meurtrière de la nicotine sur l'animalcule spermatique, qui doit être le germe de sa progéniture, ne lui laissera que des chances bien limitées de fécondité. S'il est jeune, avant que le tabac ait produit dans sa constitution des ravages trop profonds, il pourra réussir à avoir un commencement de famille. Mais, à mesure qu'il avancera en âge, quand il arrivera à l'apogée de sa puissance reproductive, c'est alors qu'il deviendra de plus en plus impropre à avoir de la progéniture. Et, contrairement à ce qui se produirait si sa constitution n'avait pas été appauvrie, les enfants qu'il procréera à l'âge où il devrait posséder toute sa virilité, seront bien inférieurs en force physique et en santé à ceux qu'il aura eus quand il sortait à peine de l'adolescence, mais alors que le tabac ne faisait que commencer à le dégrader. Ce fait est confirmé par la Statistique de France, année 1861, 2e série, tome X, page 21, où on lit:
 (pp 376397) en préserver, selon l'opinion erronée de beaucoup de croyants. Devant des causes si nombreuses de mortalité chez les adultes, faut-il s'étonner si le terme moyen de l'existence baisse son niveau dans notre siècle, et si la population de notre pays, au lieu de s'accroître régulièrement, comme elle l'a toujours fait jusqu'à nous, suit rapidement une progression descendante? Il est regrettable, sans doute, pour un pays dont l'agglomération de la population fait toujours la puissance et la prospérité, de compter par centaines de mille la diminution annuelle de ses habitants. Quand ce malheur vient de ces fléaux sur lesquels la volonté de l'homme ne peut rien: les famines, les épidémies, les guerres, on s'en console, dans la certitude de temps meilleurs. Car toutes ces calamités ne sont pas durables; et, quand elles ont passé sur un peuple, la marche ascendante de sa reproduction, momentanément arrêtée, reprend bientôt son essor et comble les vides. Mais quand la diminution de la population vient de l'abaissement dans la longévité individuelle, par suite de causes permanentes, inhérentes à nos mœurs, et qui dégradent notre organisme, oh! alors le retour à l'agrandissement normal des époques précédentes est impossible, et la génération languira tant que dureront les accidents ou les vices qui en ont enrayé les progrès. D'après les statistiques de 1817 à 1853, la population, en France, n'a cessé de s'accroître. L'augmentation moyenne annuelle a été, pendant cette période de trente-sept ans, de 155.029 individus, ce qui correspond à la 213e partie de la population moyenne: 32.210.000 habitants. Si cette proportion d'accroissement se fût maintenue, la population doublerait en 148 ans; mais de 1830 à 1853, à mesure qu'augmentait la consommation du tabac, l'accroissement normal de la population a constamment diminué, d'année en année, et dans des proportions régulièrement progressives. Au point qu'en 1854, non seulement cet accroissement était devenu nul, mais encore le chiffre des naissances n'était plus que de 923.461, et celui des décès s'élevait à 992.779. Les décès l'emportaient sur les naissances de 69.318. C'est la première fois, depuis le commencement du siècle, que la population française a éprouvé une diminution, au lieu de s'accroître de 150.000, chiffre moyen de chaque année: ce qui porte a 220.000 environ le chiffre réel de l'abaissement pour 1854. Et, depuis cette époque, jusqu'en 1875, jamais la population n'a repris son mouvement ascendant primordial. Quand on consommait encore peu de tabac, avant 1830, un statisticien distingué, M. du Villars, dressait le tableau suivant:
C'était alors le plus exact que l'on eût sur les lois de la mortalité dans notre pays. Cette table a long-temps servi de base à tous les calculs de probabilité dans les contrats des tontines, ou assurances sur la vie. Aujourd'hui, tous ces chiffres doivent être bien modifiés, si l'on considère seulement combien deviennent de plus en plus rares, dans notre société, les enfants et les vieillards. [Plus, en anglais]. Dans cette table, on suppose un million d'enfants nés au même instant, et l'on indique quel est le nombre de ceux qui survivent après un an, après deux ans, trois ans, etc., jusqu'à cent dix ans, époque où tous ont cessé d'exister. Ainsi, l'on voit qu'à vingt et un [21] ans plus de la moitié sont morts, et qu'à l'âge de quarante-cinq ans, il n'en reste plus qu'un tiers à peu près. On peut, d'après ce tableau, déterminer le nombre d'années qu'une personne d'un âge donné vivra probablement. Par exemple, on voit qu'à l'âgé de vingt-cinq [25] ans le nombre des survivants est de 471.306, dont la moitié est de 235.683. Or, ce nombre exprime une quantité plus grande que celle de ceux qui vivent jusqu'à cinquante-huit ans, et plus petite que celle des individus qui vivent jusqu'à cinquante-sept ans; en sorte que la moyenne est entre cinquante-sept et cinquante-huit; c'est-à-dire qu'il y a un contre un à parier qu'un homme de vingt-cinq ans parviendra à cinquante-sept ans et demi. Enfin, au moyen de calculs un peu plus compliqués, le même tableau peut encore servir à déterminer la durée de la vie moyenne aux diverses époques de l'existence. Et les résultats auxquels on parvient sont tels, qu'à partir de la naissance la durée de la vie moyenne est de vingt-huit ans et neuf mois; qu'à cinq ans, elle est de quarante-trois ans environ, et qu'après cet âge elle diminue progressivement. [Encyclopédie méthodique, t. XIII, p. 200.) Et si l'on rapproche de ce tableau la mortalité minimum des nouveau-nés, qui est de 50 p. 100, de un jour à un an, comme l'a révélé M. de Dalmas à la séance de la Chambre des députés du 5 février 1870, dont nous avons parlé plus haut, on verra qu'avant 1830, ère funeste de l'invasion définitive du tabac dans nos habitudes, la mort mettait plus de vingt ans pour nous enlever les enfants qu'elle nous prend aujourd'hui dans leur première année. Alors, la moyenne de l'existence pour la moitié de notre population, qui s'éteint la première, était de dix ans; avec l'effrayante mortalité d^aujourd'hui, elle n'est plus que de six mois. Il y a cent ans, la mortalité des enfants placés dans les plus mauvaises conditions de soins, chez les éleveuses et les nourrices, était un prodige de succès, comparativement aux résultats qu'elle enregistre aujourd'hui. D'après la Gazette d'agriculture de 1778, n° 20, les états tenus par les bureaux de recommanderesses, à Paris, portent que, de 1771 à 1776 inclusivement, il a été placé à la campagne, année commune, 9.581 enfants, c'est-à-dire à peu près la moitié des enfants nés à Paris, sans compter ceux qui ont été placés directement par les familles, et que, sur ce nombre, il est mort chez les nourrices environ le tiers, soit trente-trois pour cent, de la naissance, à deux ans. Et l'on sait que pour les enfants la deuxième année est au moins aussi critique que la première; ce qui reporterait à dix-sept pour cent la mortalité de la première année. Quelle disproportion effrayante de dix-sept pour cent d'alors, à cinquante pour cent d'aujourd'hui! Dans les autres âges, la vie se raccourcit tellement que les statistiques donnaient, sur un million d'individus, en:
Le tableau précédent, avant 1830, donnait en survivants: de 95 à 100 ans, 3.568; de 100 à 105 ans, 522; de 105 à 110 ans, 31. La statistique de 1877 établit que la France ne comptait à cette époque que 120 habitants au-dessus de 100 ans. Avant 1830, il y en avait 19.332. Ce n'est pas seulement en France que les vieillards tendent à disparaître, c'est dans toute l'Europe et l'Amérique, où règne en souverain le tabac.
Sur les trois cent millions dépopulation que compte l'Europe, les statistiques ne recensent que 12.831 vieillards au-dessus de 99 ans. En supposant les proportions égales pour toutes les nations, ça ferait pour la France 256, au lieu de 120 constatés en 1877. Si, de tous les pays de l'Europe, la France est aujourd'hui celui où la population se développe le plus lentement, cela tient à la quantité et surtout à la qualité toxique du tabac qu'elle consomme. La preuve de cette assertion ressort de la comparaison de la fécondité de nos départements avec le chiffre de leur consommation respective de tabac.
Ainsi, d'après la statistique, la mortalité des enfants, la rareté et la stérilité des mariages, la diminution de la population, la pauvreté du recrutement militaire atteignent leurs plus hauts degrés dans les départements qui donnent le plus de clients à la Régie: Pas-de-Calais, Nord, Seine, Bouches-du-Rhône. Les départements au contraire où la population a le plus de sève, maintient le mieux son nombre, dégénère le moins, sont ceux qui sont le moins envahis par le tabac: Aveyron, Tarn, Charente, Haute-Loire, Deux-Sèvres, Vendée. De pareils résultats, que nous démontre l'austère vérité des chiffres, sont bien dignes d'appeler sur cette g'rande calamité sociale l'attention des philanthropes, des moralistes, et surtout de ceux qui nous gouvernent. DÉGÉNÉRESCENCES HÉRÉDITAIRES La mortalité des enfants, tout effrayante qu'elle est par l'énormité de son chiffre, pourrait admettre quelque compensation si la jeune génération, qui a échappé à cette hécatombe de la première année, avait toutes les qualités physiques et morales requises pour continuer la marche humanitaire réservée à des types parfaits; mais c'est dans ces survivants que l'on s'afflige de découvrir tout ce qu'a de disgracieux la dégradation de l'homme, par voie d'hérédité. Tous ces descendants de nicotinés apportent avec eux les traces du péché originel qui a présidé à leur procréation. Frappés dans leur viabilité, comme ceux qui ont succombé avant eux, par l'influence d'un poison, quand ils étaient à l'état de germe dans l'organe paternel qui les créa, ils payent à la mort un lamentable tribut, avant d'avoir atteint leur septième année. Ceux qui échappent à cette seconde épuration donnent, avant d'arriver à la puberté, leur contingent inépuisable aux chiffres des statistiques de 1869, qui constatent qu'alors il existait en France: 39.933 idiots et crétins; 58.808 goitreux, 21.214 sourds-muets; 4.726 aveugles de naissance; sans compter les pieds bots. Et ces malheureux, presque tous victimes des erreurs  (pp 404-407) vent au dernier degré de la dégradation pour qu'ils restent frappés de stérilité, et conséquemment incapables de transmettre le type de leur dégénérescence.
D'après cette loi naturelle de la dégénérescence, qui fait qu'un être dégradé dans son type normal engendre toujours des êtres plus dégradés que lui, on doit comprendre avec quelle rapidité baisserait le niveau d'une société dans laquelle la cause efficiente de la dégradation agirait également et sans relâche sur les pères et sur les fils, dans la série descendante de leur génération. [Plus, en anglais, par le Dr Benjamin Brodie]. Prenons pour exemple de cause dégénératrice l'influence du climat. Supposons une société ou, si l'on veut, une tribu de race éthiopienne venant s'implanter au centre de la France, dans un climat bien tempéré. Sous le ciel de la France, beaucoup moins chaud que le ciel de Sénégambie, cette tribu dégénérera. Sa mortalité y sera d'abord plus grande que sous son climat naturel; sa fécondité y diminuera; les enfants s'y élèveront difficilement; au point qu'on pourrait affirmer qu'à la quatrième, ou à la cinquième génération, toute cette tribu, eût-elle été de cent mille habitants, aura disparu, passant, de père en fils, par des degrés plus marqués de dégradation, pour arriver à la stérilité et à l'anéantissement. C'est ce qui fait qu'en France, où la race noire jouit de toutes les prérogatives de la race blanche, où elle pourrait prospérer en liberté, par le travail, on ne voit pas une seule famille de couleur se perpétuer. En cette circonstance, qu'a-t-il fallu pour abâtardir d'abord, et pour éteindre ensuite, toute cette race pleine de vitalité et d'énergie? Un peu de chaleur en moins, comme un peu de chaleur en plus fait dégénérer la race blanche sous les climats tropicaux. Ce qu'un peu de chaleur, en plus ou en moins, par une action continue, accomplira toujours sur l'organisation humaine la mieux trempée, comment, à plus forte raison, un poison violent comme le tabac, qui agit avec la même persévérance, ne saurait-il le faire? C'est là qu'est le secret tant cherché de notre dégénérescence. Et, en supposant qu'une inspiration providentielle vienne à écarter le tabac de la bouche de tous les hommes, le mouvement de dégénérescence est tellement prononcé parmi nous que, longtemps encore, les générations à venir verront ce qui afflige en ce moment la nôtre. Ce qui persistera, surtout, c'est la dépression intellectuelle et morale dont îa jeunesse donne aujourd'hui l'exemple.  (pp 410-413) de la justice criminelle. Le vagabondage, le crime, les propensions à la débauche forment le triste bilan de leur exigence morale.
Après eux viennent les bandes non moins criminelles des Cravates vertes, d'Argenteuil; des Bonnets de coton, des Habits noirs; la bande de l'Assommoir qui ensanglanta Montreuil, dont les chefs, Abadie et Gilles, ont dix-neuf et seize ans. Farigoule, dit Passe-Partout, Claude ont quinze ans; Charton en a treize. Et l'on voit des femmes assez dégradées, elles aussi, pour s'affilier à toutes ces légions de vauriens. Le Constitutionnel donne sur ces malheureuses créatures des détails qui prouvent combien le nicotisme a dû contribuer a leur abaissement, et viennent confirmer ce fait que tout le monde peut constater dans la vie sociale: c'est que les descendants de consommateurs de tabac, quel que soit leur sexe, ont une passion pour ce narcotique bien plus exagérée et plus irrésistible qu'elle n'était chez leurs parents.
COMMENT LE TABAC Avec des éléments de dégénérescence aussi énergiques que le tabac, agissant sans relâche sur la plus grande partie de sa population, que deviendra un pays, quelque civilisé, quelque puissant qu'il ait été avant d'être soumis aux causes qui le dégradent dans son organisme vital? Demandons-le a l'Espagne, qui fut la première à sacrifier au dieu des sauvages d'Amérique, au grand Manitou-Petun, au tabac. Au commencement du XVIe siècle, après la découverte du Nouveau-Monde, l'Espagne était à l'apogée de sa grandeur. Ses flottes couvraient les mers; son commerce s'étendait sur tous les continents; ses armées victorieuses dictaient des lois au monde. Charles-Quint [1519-1556] avait réuni à sa couronne l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Artois et les Flandres. Il n'avait de rival sur la terre que François Ier [1515-1547], à qui il disputait l'Italie. La politique de François Ier était d'écarter les armées de Charles-Quint du territoire français. Il livrait toujours la bataille sur le terrain de son ennemi. C'est ainsi qu'en 1524, il franchit les Alpes à la tête de forces considérables, força l'armée de Charles-Quint, qui ne put tenir contre lui en rase campagne, à se retirer dans la forteresse de Pavie, où les Français la bloquèrent. Des renforts arrivant aux assiégés, le sort des armes changea. François 1er fut pris entre les feux de la place et ceux de la nouvelle armée. Il fut fait prisonnier et conduit à Madrid, après une défense héroïque où il eut son cheval tué sous lui, et brisa trois épées; c'est alors qu'il écrivit à sa mère ces mots, devenus le symbole légendaire de la valeur française:
Sous Charles-Quint [1519-1556] et Philippe II [1556-1598], pendant tout le XVIe siècle, l'Espagne régnait donc en souveraine. Et, pour maintenir ses conquêtes, elle tenait sur pied d'innombrables armées. Toute la nation n'était qu'un camp. L'usage du tabac, que les vaisseaux et les armées d'expédition du Nouveau-Monde apportaient de plus en plus à la métropole, se répandit bientôt au milieu de ces masses d'hommes livrés au désœuvrement de la vie de garnison. Et tous ces militaires, rentrant successivement dans leurs foyers, y familiarisèrent des habitudes dont ils ne pouvaient plus se passer; comme il est advenu pour nos campagnes, depuis les grands armements qu 'inaugura l'Empire. Mais, en Espagne, le caractère un peu frivole des femmes, au lieu de résister, comme ont fait nos Françaises, à l'invasion du tabac dans le sanctuaire de la famille, l'accueillit avec le même enthousiasme qu'il avait rencontré chez les hommes, et toute la nation fuma. Alors, de ce milieu de vapeurs narcotiques, enveloppant à la fois les deux sexes, et souillant le berceau des enfants, s'éleva comme un épais nuage d'obscurantisme qui voila peu à peu l'éclat dont brillait la nation. Elle dégénéra, comme si une atmosphère malsaine s'était soudainement substituée à son climat riche et fécond. Jamais peuple ne tomba dans la décadence avec une rapidité si grande. Quelques générations ont suffi pour tarir dans le sein des mères la source de vigueur physique, intellectuelle et morale qu'avaient ces envahisseurs du monde avant d'être envahis par le tabac. [Plus, en anglais].  (pp 418-421) tières et les portes des villes de la France à l'avalanche armée qui la ravagea, l'incendia, la démembra, la rançonna sans rencontrer de résistance. C'est alors que de toute l'Allemagne, délirante de ses victoires faciles, partit ce cri qui retentit si douloureusement au cœur de là France:
Cri que poussa aussi la vieille Angleterre, avec un accent de compassion et de pitié qui ressemblait beaucoup à la satisfaction qu'éprouve une envieuse devant les infortunes d'une amie, sa rivale. Et, dans le monde entier, il n'y avait qu'une opinion: c'est que la France était dégénérée... Et c'était vrai!. . . Le sens moral de la nation était tellement engourdi par le narcotisme chronique, que le tempérament français, par nature si ardent, si sensible au point d'honneur, si inflammable à l'idée du danger de la patrie, se débattit mollement dans des agitations stériles, sans entraînement, sans unité de but ni d'action. Ce fut presque un sauve-qui-peut, où chacun, devenu égoïste, comme on l'est toujours quand on est vieux, maladif, ou que l'on dégénère, prit pour amour de son pays ce qui n'était que les inspirations de l'esprit de parti. L'invasion était aussi, pour beaucoup, synonyme de restauration. Dans ce grand conflit d'intérêts personnels et de préférences dynastiques, qui dominaient trop souvent l'amour du pays, combien n'ont pas rêvé un nouveau 1815, espérant voir faire par l'ennemi commun, plutôt que de s'attacher à le combattre, ce qu'ils n'avaient pas le courage d'entreprendre par eux-mêmes: la restauration d'un trône, pour y asseoir le monarque de leur prédilection et de leurs rêves! Que l'on juge de quelle force physique et morale a été privée la nation, pour résister au choc imprévu qui la heurta, par la grande quantité d'invalides de toute sorte que faisait le tabac, parmi les dix millions de ses consommateurs journaliers répandus sur le territoire, dont elle attendait les secours qui n'arrivaient pas. Car combien de dêvastés par la plante narcotique ont dû sentir leur cerveau trop vide, leur poitrine trop essoufflée, leurs jambes trop amaigries, leurs bras trop faibles pour prendre le fusil et marcher vers l'ennemi, aux jours de l'invasion! Ce grand désintéressement, ce grand amour, qu'on appelle le patriotisme, n'existaient pas chez eux; le nicotisme qui les dominait avait éteint tout sentiment chevaleresque. L'instinct de la conservation, qui seul inspire les êtres faibles dans les dangers suprêmes, étouffait dans leur cœur le dévouement, l'enthousiasme; jusqu'à la voix de la conscience et du devoir, quand elle commande d'exposer sa vie pour sauver son pays. On sera peut-être tenté de croire qu'il y a de l'erreur ou de l'exagération à chercher, dans une cause en apparence si éloignée, l'action du tabac, une raison principale de notre chute, en 1870. Alors, pour appuyer notre assertion de quelques faits moins contestables, nous rappellerons ce qui se passe de nos jours, dans nos armées actives, qui sont l'élite de nos populations, sous les rapports de la santé et de la force physique. Il est un fait hors de doute: c'est que les militaires, officiers et soldats, sont les classes qui consomment le plus de tabac, par suite des habitudes oisives delà vie de garnison. Eh bien, des relevés officiels constatent que c'est parmi ces hommes bien organisés, bien soignés, dans les meilleures conditions pour vivre longtemps, que les maladies et la mortalité atteignent leur chiffre le plus élevé. Sous ce titre, Mortalité dans l'armée, on lit dans la Gazette médicale de 1859, page 346:
 (pp 424-433) COMMENT UNE SOCIÉTÉ PROSPÈRE
Après avoir exposé comment un pays dégénère, se dépeuple et s'abaisse sous l'influence du nicotisme, voyons comment grandit, se moralise et prospère une société qui ne sacrifie pas au dieu des Caraïbes [Petun].
Ils fuyaient devant les persécuteurs de leur religion naissante, et venaient, bien loin du monde, sous la conduite de leur pasteur Brigham-Young, poser les bases d'une civilisation en quelque sorte à part, sous la loi du prophète Joseph Smith, fondateur de cette nouvelle secte, qu'il appela les SAINTS DU DERNIER JOUR. Le grand prêtre Smith et beaucoup des siens venaient d'être massacres par une bande d'opposants à leur foi, sur les bords du Mississipi à Nauvoo, où s'étaient primitivement établis les fidèles. Son premier vicaire, Brigham-Young, prit alors le soin du troupeau. Il le conduisit pendant des centaines de lieues au milieu des déserts et vint camper, comme dans une terre promise, dans les belles vallées où s'enclave le lac Salé, véritable mer que les grands océans semblent avoir oubliée là, au sommet des montagnes, à une élévation de plus de 1.800 mètres, quand ils ont regagné leurs lits primitifs, après les cataclysmes qui ont bouleversé notre globe.
Cet accroissement si rapide, ils le doivent bien moins au zèle de leurs missionnaires, cherchant des prosélytes par tout le monde, qu'à la fécondité de leur génération. Ces nouveaux sectaires du christianisme cultivent avec foi toutes les vertus qu'enseigne l'Évangile. Et si, en vrais patriarches, ils admettent en principe la polygamie, ils la pratiquent fort peu; et dans la ville du lac Salé, leur capitale, qui compte plus de 30.000 habitants, on aurait peine à trouver 100 Mormons polygames. Cette liberté d'avoir plusieurs femmes légitimes que, dans les vieilles civilisations, on regarde comme une immoralité, comme un vice, les Mormons, eux, la considèrent comme une vertu. En se conformant au précepte de l'Évangile qui dit aux hommes de croître et de multiplier, ils veulent assurer à toute leur progéniture des droits égaux devant la loi, une place égale au foyer de la famille. Ils ne veulent pas que, parmi eux, il y ait un seul de ces enfants qui pullulent dans les sociétés qui se disent civilisées, qui ne connaissent le plus souvent ni leur père ni leur mère, qui sont venus au monde comme un bétail, dont l'État et la charité soignent imparfaitement l'enfance, et qui traînent toute leur vie une sorte de flétrissure attachée à leur qualification d'enfants naturels ou d'enfants trouvés. Chez les Mormons, il n'y a pas de bâtards; tout enfant y reçoit en naissant le nom de sa mère et de son père; il a droit à la vie de la famille, dans le nid maternel, comme l'oiseau des champs. Car si un Mormon épouse deux, trois, quatre femmes, il a autant de maisons et de ménages séparés que de familles; ses affections, son activité, ses biens appartiennent autant aux uns qu'aux autres. Que les moralistes décident si cette pratique de la civilisation mormonne blesse plus la dignité humaine et les bonnes mœurs que le spectacle que nous offrent nos sociétés vivant si facilement en dehors du mariage, et d'où sortent tant de pauvres créatures sans nom, sans famille et sans pain.
Un article de la loi du prophète leur dit:
Tous les Mormons observent religieusement ces deux commandements de la loi du prophète. Ils n'engourdissent pas leur virilité dans la fumée stérilisante du tabac, ni dans les vapeurs brûlantes de l'alcool; ils ne pervertissent pas par ces folles passions ou ces déplorables erreurs, comme on voudra les nommer, les lois naturelles de leur organisme; et leurs enfants naissent avec une vigueur originelle qui contraste, à leur grand avantage, avec la débilité native de la progéniture des sociétés qui s'étiolent dans le nicotisme.
criminels, des asiles pour leurs aliénés, des maisons de correction pour leurs jeunes vauriens de dégénérés, qu'ils n'ont pas, bâtissent des temples somptueux à la glorification du dieu qui veille sur leur prospérité. Ils vivent dans l'amour les uns des autres, dans la fraternité; ils se multiplient dans la perfection d'un beau type, mélange de toutes les nations. Ils prospèrent par le travail; et, véritable essaim d'abeilles, comme ils s'appellent eux-mêmes, ils répandent la fertilité, le commerce, la richesse, la vie dans de vastes contrées qui, il n'y a que quelques années encore, n'étaient que le désert. Et cette fécondité, cette concorde, cette prospérité, sans égales sur la terre, dureront tant que les Mormons ne se laisseront pas envahir par les deux vices capitaux des Gentils qui les entourent et les convoitent, sans pouvoir les pénétrer encore: le tabac et l'alcool, ces puissants dissolvants de toute société humaine.
C'est que toutes ces sectes de réformateurs créées par des cerveaux en délire, au milieu des vapeurs de l'estaminet, n'ont pas compris que le tabac et l'alcool, auxquels les adeptes sacrifiaient libéralement, étaient les ennemis irréconciliables de la santé des hommes et du travail, points de départ de toutes les prospérités et de toutes les grandeurs sociales. LE TABAC CAUSE D'UNE MALADIE NOUVELLE:
Si l'on prêtait une attention sérieuse à ces altérations du sang, si fréquentes chez les consommateurs de tabac, qui determinent sur leur peau, et principalement sur les parties le plus exposées à l'air, cette teinte gris-plomb qui caractérise le faciès des nicotines, et qui a beaucoup d'analogie avec le premier degré de la cyanose cholérique, on arriverait, nous croyons, à découvrir la vraie cause d'une maladie nouvelle, mystérieuse dans son apparition, qui semble coïncider avec les progrès de l'envahissement du tabac: la Pellagre.
Mais l'éruption n'était là qu'un symptôme, et le vrai caractère de la maladie résidait dans une cachexie générale, où dominaient les désordres du système nerveux cérébro-spinal. Les sujets qui en sont atteints éprouvent d'abord des lassitudes et des douleurs profondes dans le dos et dans les lom- bes; elles sont bientôt suivies de faiblesse, de tremblement des membres inférieurs avec hésitation dans les mouvements. Les malades tombent ensuite dans l'apathie et une tristesse profonde. Ils ont des tendances au suicide et des tendances pour le meurtre. Dans une période plus avancée, apparaît la manie, qu'on appelle alors folie pellagreuse; puis la démence paralytique et la mort, qui n'arrive souvent qu'après de longues années de tout ce cortège de souffrances. Le docteur Roussel, en 1842 et 1843, fut le premier qui appela l'attention de la France sur cette étrange maladie, qui étendait ses ravages en Lombardie, en Espagne et sur divers points de notre pays, particulièrement dans les départements du Sud-Ouest et dans la Champagne. L'Académie s'en émut et proposa l'histoire de la Pellagre comme sujet d'un prix de médecine à décerner en 1864. Cet appel, fait par notre aréopage de la science, eut pour effet de grouper toutes les observations des médecins sur ce nouvel ennemi de nos sociétés modernes. Et il ressort de cette grande enquête:  (pp 440-443) au cou, aux aisselles, dégénérant en abcès toujours lents à tarir et difficiles à cicatriser; par des suintements chroniques de matière ichoreuse sur la peau, surtout aux jambes, dont les. chairs parfois se décomposent et donnent naissance à des ulcères le plus souvent incurables. Émonctoires naturels par où le nicotine se purge de toutes les impuretés de son sang, que Jacques Ier, roi d'Angleterre [1603-1625], considérait si judicieusement comme affecté de scurvy (cachexie, scorbut), dans son livre contre le tabac, dont nous avons déjà parlé [p 107]. Quand la cachexie est profonde, elle détermine fréquemment, comme chez les scrofuleux, des abcès par congestion dans les intervalles des aponévroses, au périnée, dans le voisinage du péritoine, de la plèvre, et dans les cavités des médiastins. On trouve les premiers degrés de la transmission pellagreuse héréditaire, dans ce grand nombre d'enfants procréés par des consommateurs de tabac et qui, dans les premières années après la naissance, sont affectes de maladies squameuses de la peau, plus ou moins étendues. Si elles ne tuent pas les petits malades, elles restent à l'état latent dans sa constitution, comme le germe de la phtisie, pour se développer de nouveau et grandir dans sa descendance.
De génération en génération, le vice constitutionnel primitif grandit par l'exposition des descendants aux mêmes causes qui ont fait déchoir leurs ancêtres, jusqu'à ce que, par un excès de dégradation, ils arrivent à la stérilité et à l'anéantissement. Que faire pour conjurer une calamité si grande? Vouer les nicotinés, autant que possible, au célibat, en leur fermant l'entrée, par alliance, dans les familles saines, comme on le fait généralement pour tous les prétendants au mariage frappés de vices organiques transmissibles par la génération. LA RAISON SE LIGUE CONTRE LE TABAC. Espérons que ces mesures de rigueur ne seront pas nécessaires, maintenant surtout que, de tous côtés, on est frappa du mal que cause à l'humanité le grand coupable que nous accusons devant le bon sens et la raison publics. Si nous étions seul à lutter contre des habitudes si invétérées, et qui sont, comme tout ce qui est défaut, chères à ceux qui les cultivent, nous aurions peu de chance de rappeler au sentiment de leur conservation ces consommateurs de tabac qui, comme les amoureux, se suicident par passion. Mais, dans ce danger public, les philanthropes s'unissent pour éclairer des lumières de la vérité toutes ces foules ignorantes entraînées vers la dégénérescence sans qu'elles s'en doutent, par la folle habitude de s'adonner au tabac. On compte aujourd'hui par légions les adversaires de cette plante Protée qui, comme l'ivraie, semble mettre à se reproduire toute la persistance que l'on emploie pour l'arracher. En 1853, une première association s'est formée, à Londres, pour ouvrir, contre ce séduisant ennemi, une campagne d'opposition semblable à celle où il fut si près de succomber définitivement au XVIIe siècle. Cette idée trouva chez nous des imitateurs. En 1868, une Association française contre l'abus du tabac  (pp 446-455) tution par deux puissants destructeurs de la force physique: la diète et le narcotisme; il perd la chair, le muscle, qui sont l'élément essentiel de la force physique résistante et durable. Dans notre administration militaire, où l'on se pique d'être excellents observateurs de l'hygiène du soldat, je suis bien sûr qu'il n'est jamais entré dans l'idée de personne de signaler tous ces abus qui ont pour source le tabac. On exclut de la cantine, comme insalubres, les liqueurs dont l'usage serait plutôt utile au soldat, qui n'a, pour arroser la soupe et le pain bis de la caserne, que l'eau plus ou moins pure de la fontaine de la cour. Mais, en revanche, on lui donne toute facilité de dépenser son argent en achetant du tabac, dont l'usage est plus pernicieux que toutes les boissons du monde; car la contre-partie du tabac est toujours l'alcool. [Plus en anglais]. L'administration, pour le pousser à la consommation de sa plante privilégiée, va même jusqu'à faire en sa faveur des réductions sur les prix qu'elle a établis pour ses autres clients. Cette sorte d'attention, toute exceptionnelle pour les militaires, ne semble-t-elle pas dire au jeune conscrit arrivant de sa famille où on l'a souvent dissuadé de se livrer au tabac:
Et le conscrit qui, dans sa débonnaireté, croit un peu tout ça, fume et chique la drogue que lui présente si paternellement son Gouvernement. Bientôt, le sou de poche ne suffisant pas à sa consommation, il demande à sa famille de se gêner pour lui fournir l'argent de son tabac; et l'on sait ce qui advient. La drogue ruine, une à une, toutes ses énergies, et l'État, qui a pris à la famille un homme sain, vigoureux, actif, travailleur, lui rendra un invalide, un paresseux toujours altéré, un fumeur et un buveur. COMMENT RÉGÉNÉRER LA FRANCE? De quelque côté qu'on se retourne, on n'entend plus parler que de régénérer la nation. La régénération est à l'ordre du jour. Admettre que nous sommes dégénérés est, en effet, le moins que l'on puisse faire, après qu'en 1870 et 1871 on a vu la France de Louis XIV, de 93, de Marengo, d'Austerlitz, d'Iéna, de Lutzen, comptant quarante millions d'habitants, riche comme jamais nation n'a pu l'être, ne trouver en elle-même d'autres moyens que l'abandon de deux de ses plus chères provinces et une rançon en or de plus de six milliards, pour se débarrasser de six cent mille Allemands qui l'ont envahie, qui l'ont saignée, qui l'ont incendiée, qui l'ont pillée à leur bon plaisir! Devant une chute si profonde, une humiliation si grande, nous avons cherché à nous consoler dans une espérance, dans un mot: la revanche! . . . Et pour la prendre, nous attendons de l'avenir que nous soyons régénérés, que nos fils soient plus puissants, par leurs vertus civiques et par leurs forces, que nous ne l'avons été nous-mêmes. Nous leur laissons l'héritage de nos défaites, de notre ruine, de nos fautes et de notre honte. Mais nous leur léguons aussi les causes de nos défaillances; nos tendances à la frivolité, par abaissement de notre intel-  (pp 458-515) vrait pas suffire pour faire rejeter de nos mœurs une habitude si frivole? Pour satisfaire un vrai caprice, une folle ivresse, pour se distraire par un jouet, une pipe et du tabac, voilà donc les sociétés européennes, la France en tête, comme type de la fashion, marchant vers toutes les dégradations avec une rapidité et un engouement que n'ont jamais connus les peuples primitifs, qui se sont également suicidés par le narcotisme.
L'opium a mis des siècles à faire descendre à un état voisin de la léthargie les peuples de l'Orient. La nicotine ne sera pas si longtemps à faire de l'Europe et de sa succursale, l'Amérique, une seconde Asie; car une livre de tabac est capable de tuer bien plus d'hommes que ne le feraient trente livres de pavots. Deux siècles se sont à peine écoulés depuis la connaissant généralisée du tabac, et déjà il a séduit plus de la moitié de ces classes faibles ou superstitieuses de l'humanité qui croient au merveilleux ou aiment à s'engourdir dans des sensations factices, au milieu d'un peu de fumée, plutôt que de s'épanouir dans l'activité salutaire de la vie au milieu d'un air pur. CE QUE FUMENT LES DIFFERENTS PEUPLES. Un savant anglais, Johnston, a essayé de faire la part de chaque pays dans la distribution des substances affectées à l'usage de fumer. D'après ses calculs, huit cent millions d'hommes, dans la population de l'univers, fument diverses sortes de tabac; quatre cent millions, l'opium et ses composés, trois cent millions, le cannabis et le hachisch; cent millions, le bétel; quarante millions la coca; sans compter ceux qui fument des substances moins actives ou inertes, telles que le fong-us, le houblon, le thé, l'anis, etc. L'habitude de fumer, quelle que soit la substance que l'on brûle au contact de la bouche, est née aux àges de barbarie de l'humanité, alors que l'homme n'avait, pour remplir l'activité à laquelle son organisation supérieure le convie, ni l'industrie, ni les arts, ni les sciences, ni tous ces passetemps que crée la civilisation. Fatigué de son inaction, il chercha quelque chose pour dis traire la monotonie de son existence; et, dans l'état borné de son entendement, il ne trouva rien de plus simple, de plus enfantin et de plus récréatif que de fumer. C'est dans cet état que vivent encore aujourd'hui les races les plus attardées vers la civilisation, les Cafres et les Hottentots par exemple, dont un célèbre écrivain, voyageur portugais, le  (pp 504-511) lait, quand elles en ont, a leur enfant; et pour assistera la lente agonie d'un pauvre petit être à qui elles n'auraient donné la vie que pour le voir mourir bientôt, par l'effet d'une alimentation insuffisante et contre nature. La France abonde en sociétés protectrices de l'enfance parmi lesquelles se pose au premier rang, par l'importance du but qu'elle se propose, la Société pour la propagation de l'allaitement maternel. Et ce qu'il y a de pénible à constater, d'après les statistiques, c'est que malgré tant de dévoùments et de sacrifices, la mortalité des enfants et la décroissance de la population suivent toujours leur marche progressive. Ah! si elles le pouvaient, ces Françaises, qui ont eu, les premières, l'idée de racheter par leur argent la libération anticipée de leur pays, que les hommes n'ont pas su défendre, et dont elles ont si profondément senti toutes les hontes; comme elles lui donneraient à l'avenir des défenseurs dignes d'elles! . . . Comme elles contraindraient leur sein et leurs mamelles à engendrer et à nourrir une génération robuste, capable de ressaisir virilement Fépée de la France, et de réhabiliter la nation dans son ancienne splendeur! Mais elles ne seront fortes, elles-mêmes, que quand les hommes qui les procréent auront retrouvé leur vigueur primitive. Et il faudra attendre longtemps; car les peuples sur la pente de la dégénérescence marchent vite; et il faut deux siècles de persévérance et de bonne volonté pour réparer le mal qu'aura fait un demi-siècle de mauvaises habitudes et d'erreurs. Si les femmes peuvent quelque chose dans ce grand problème de la régénération de la France, c'est en méditant bien tout ce que nous venons de dire du tabac, a qui nous ne craignons pas, encore une fois, d'attribuer le plus grand rôle dans notre décadence physique et morale actuelle. Qu'elles gravent profondément dans l'esprit de leurs enfants les dangers de son usage et la crainte de ses effets. Qu'elles leur disent sans cesse que, si elles se sont si souvent attristées sur leurs berceaux, si elles ont eu tant de peine à les sauver à la loi de mortalité qui ravage leur époque, si leur constitution est faible, si leur existence est menacée d'être courte et semée de défaillances et de maladies qui leur ôteront une grande part du bonheur de vivre, c'est la faute de leurs pères, qui ont détruit, par la plus fatale des erreurs, par la subtilité d'un poison, ce qu'il y avait de plus parfait et de plus pur dans leur organisme. Qu'elles leur disent bien surtout qu'ils sont frappés déjà de vices héréditaires, qu'ils ne corrigeront en eux, et qu'ils n'arrêteront dans leur descendance, que par les pratiques qui développent et fortifient le corps, rehaussent l'esprit, grandissent le cœur. Et si les fils écoutent leurs mères, quand elles leur enseigneront, dès l'enfance, toutes ces vérités; si le tabac ne souille pas leurs lèvres, il ne brisera plus l'essor de leur virilité. Et, dans notre beau pays de France, dont les institutions sociales, dont les cultures et le climat sont si favorables à la perfectibilité humaine, qu'ils ont élevée si haut chez nos ancêtres, la fécondité reviendra. Et la nation, régénérée dans ses qualités natives, qui font toute sa grandeur, reprendra la marche que la Providence lui a tracée dans l'avenir, sans crainte de nouvelles chutes, aux jours où il faudra qu'elle soit forte. E. D.
Bureaux, rue Saint-Benoît, 2Obis, Paris Après la lecture de l'ouvrage du Dr Depierris, il est impossible de n'être pas convaincu que l'habitude du tabac est une des plus grandes plaies sociales de notre époque. En effet, l'usage du tabac a pris de nos jours un développement très inquiétant au point de vue de l'hygiène et de la morale; il altère la santé, déprime l'intelligence, abaisse le niveau scientifique, porte atteinte au développement des organes et des fonctions. C'est pour élever une barrière contre son envahissement qu'a été fondée, à Paris, en 1877, la Société contre l'abus du Tabac. Cette Œuvre de bienfaisance intéresse tout à la fois:
interdit de fumer en certains services et à certaines heures;
Ajoutons que l'enfant à la mamelle a souvent à souffrir de la fumée que son père répand autour de son berceau, et que les enfants nés de parents atteints de nicotisme sont exposés à être affligés de certaines infirmités corporelles ou intellectuelles. Ajoutons encore que les fumeurs sont une menace permanente d'explosions de mines, d'incendies d'écuries, de magasins à fourrage, de forêts, etc. D'autre part, n'oublions pas que le tabagisme porte à l'alcoolisme, que l'abus du tabac occasionne bien des journées de traitement à domicile et dans les hôpitaux, et qu'en affectant environ 20.000 hectares de nos meilleures terres à la culture du tabac, on diminue par cela même notablement les ressources alimentaires des hommes et des animaux. La Société contre l'abus du Tabac combat activement le fléau. Dans cette tâche difficile, elle fait appel à toutes les personnes de cœur et de bonne volonté. Elle compte aussi sur le puissant concours des Dames, qui, au point de vue des relations sociales, ont le plus à souffrir de la funeste influence qu'exercent la pipe et le cigare. STATUTS Art. 3. — Toute personne, sans distinction de sexe, d'âge, de nationalité, de religion ou d'opinions politiques, peut en faire partie comme Membre titulaire, si elle est agréée par le Conseil. Art. 5. — Chaque membre paye une cotisation annuelle de 10 francs; elle est réduite à 5 francs pour les Ecclésiastiques de tous cultes reconnus, les Instituteurs et les Institutrices. — La cotisation peut être rachetée à perpétuité par une somme de 100 francs une fois payée. Art. 9. — La Société publie un journal paraissant tous les mois. I1 est envoyé à tous les sociétaires. Art. 28. — Tout membre nouvellement admis reçoit: une lettre d'admission, une carte de Sociétaire, les numéros du journal parus depuis le 1er janvier et un diplôme, après payement de la première cotisation. Nous prions les personnes qui approuvent notre OEuvre éminemment humanitaire et patriotique, de vouloir bien nous adresser leur adhésion comme membres de la Société.
CONTENUES DANS LE VOLUME
|

[In interim, pending completion of this site,
you can obtain this book via your local library.]
| Plus, à TCPG, en anglais |
| For U.S. Readers, Full Text at Cleveland (Ohio) Library |
Le Dr Abel Gy: L'Intoxication Par Le Tabac (1913) Le Dr Claude Bourdin, Le Tabac et les Prisonniers (1884) |
| Ed. Note: La dépopulation due au tabac affecte maintenant la Russie. Seulement 10% des années de l'adolescence, et 33% des nouveaux-nés sont sains. La tuberculose est effrénée. L'utilisation d'héroïne se produit parmi 4.000.000. Des couples russes, 20% sont dus stérile à l'alcoolisme, à l'abus de drogue, et à l'avortement. Dans un délai de six ans, on s'attend à ce qu'environ 5% de Russes aient l'infection par le HIV, un des épidémies d'HIV grandissantes les plus rapides du monde. Ce seul a pu ramener la population de la Russie à 77.000.000 par 2050 C.E. Ce serait le plus mauvais déclin de population n'importe où depuis le Plague.?"Russia du 1300 sur les cordes?" Parade, p 7 (15 Dec 2002), citant les données de ministère de la santé de la Russie.
Depopulation due to tobacco is now affecting Russia. Only 10% of the teens, and 33% of the newborns are healthy. Tuberculosis is rampant. Heroin use occurs among 4,000,000. Of Russian couples, 20% are infertile due to alcoholism, drug abuse, and abortion. Within six years, about 5% of Russians are expected to have HIV infection, one of the world's fastest growing HIV epidemics. This alone could reduce Russia's population to 77,000,000 by 2050 C.E. This would be the worst population decline anywhere since the 1300's Plague.—"Russia On the Ropes?" Parade, p 7 (15 Dec 2002), citing Russia's Health Ministry data. Tobacco killing in the millions led ton population reduction rather than normal increase: "Russia's population fell from 148.6 million in 1991, the year the Soviet Union collapsed, to 141.9 million in 2011, according to World Bank figures," says the article, "Putin signs law to curb smoking, tobacco sales in Russia" (Reuters, Monday 25 February 2013). |
| Homepage |
Graphic Credit
Skull of a Skeleton with Burning Cigarette
Vincent van Gogh, 1885-1886

 Et, pour finir par un grand trait toutes ces peintures de la pose à la fumée de tabac,
Et, pour finir par un grand trait toutes ces peintures de la pose à la fumée de tabac,